Les figures identitaires dans la littérature révèlent des récits souvent méconnus, comme celui de Leïla Sebbar. En explorant le tiraillement entre culture française et algérienne, cette recherche met en lumière des symboles de résistance et de quête identitaire, essentiels pour comprendre l’expérience de l’exil.
Les figures identitaires
Leïla Sebbar dans son roman Je ne parle pas la langue de mon père a cité des figures emblématiques, une musulmane et purement Algérienne représentant la femme combattante, l’héroïne patriotique qui a défendu l’Algérie et qui s’est sacrifiée pour l’Algérie, symbole de la résistance historique, elle est morte pour la cause algérienne afin de défendre son pays contre l’armée française de la conquête, aussi pour conserver sa culture algérienne. Comparée à une autre figure combattante chrétienne qui a défendu son pays à savoir la France contre l’occupation britannique, les deux personnages historiques Lalla Fathma N’Soumer et Jeanne d’Arc sont un symbole de dévouement et de sacrifice pour leur pays natal.
Une troisième figure emblématique est également citée dans le roman c’est Isabelle Eberhardt, cette occidentale qui a épousé la culture algérienne et s’est convertie à l’islam, fascinée par la culture de l’Orient, elle s’est mariée avec un Algérien, Isabelle a appris et aimé la langue des indigènes (l’arabe) la parle et l’écrit couramment, elle a sillonné le Sahara algérien et puis toutes les villes algériennes du nord jusqu’au sud El-Oued, Batna, Ténès, Aflou, Mascara, etc. Ainsi elle a même adopté l’habit des autochtones, elle porte toujours des vêtements masculins de cavaliers algériens.
Cette femme est une excellente écrivaine, ses récits attirent jusqu’à nos jours l’attention du publique on peut citer à titre d’exemple « Dans l’ombre chaude de l’islam », c’est une chose qui a causé chez notre écrivaine la curiosité pour se rapprocher de cette figure féminine puissante et aventureuse, mais également pour trouver son identité derrière ce personnage mythique.
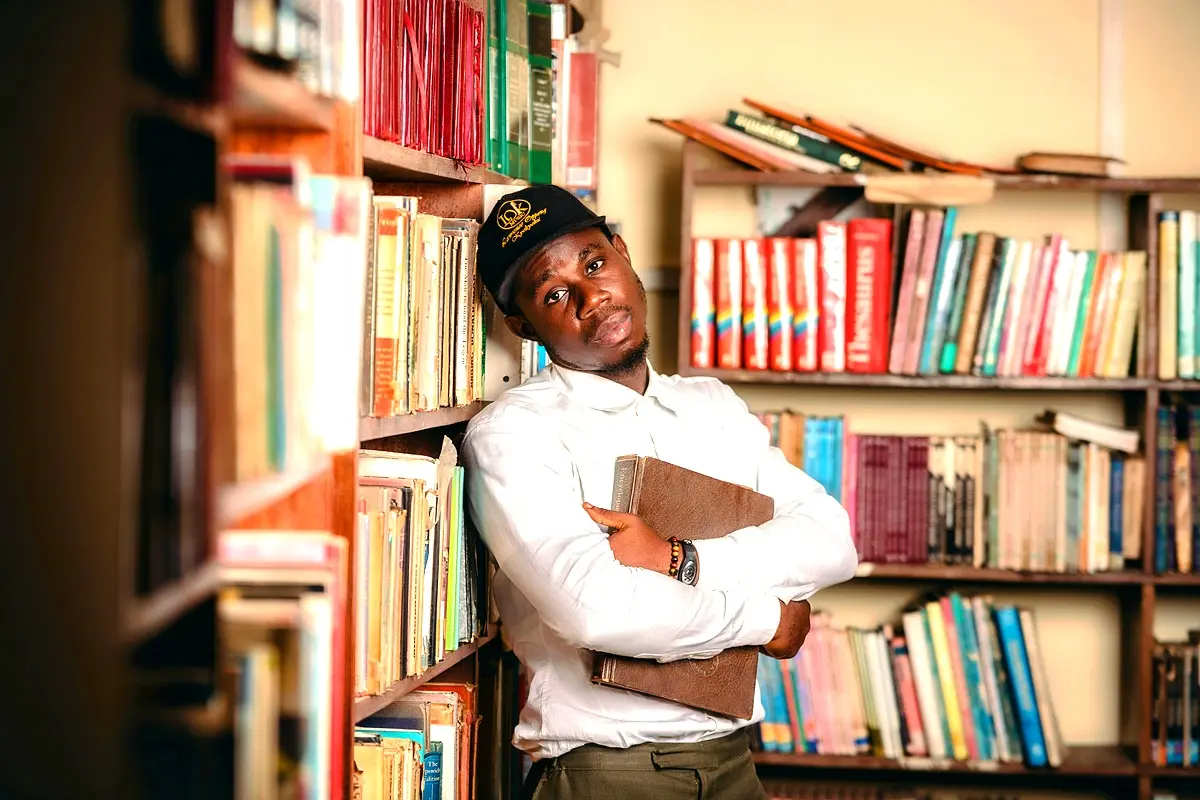
En outre, Leïla Sebbar est intéressée par la personnalité d’Isabelle Eberhardt, parce qu’elle a trouvé chez cette femme tout ce qu’est perdu et manqué en elle comme « l’exil heureux »61, en fait Isabelle n’a pas vécu l’amertume de l’exil dans l’Algérie malgré qu’elle est d’origine russe et qu’elle a grandi à Genève, donc l’Algérie n’est pas son pays natal, mais plutôt elle était chanceuse de vivre l’exil heureux en terre algérienne. De ce fait, elle vit dans une société algérienne, dans la religion musulmane du père Sebbar, dans la langue arabe, ainsi elle est rattachée avec le peuple algérien, avec les femmes du peuple de son père. Donc elle adopte facilement ce pays.
61GEYSS Roswitha, interview avec Leïla Sebbar : Bilinguisme littéraire « double identité » dans la littérature maghrébine féminine, Paris, Le 16 mai 2005.
On constate par la suite que cette figure identitaire est le porte-voix de notre romancière, grâce à Isabelle, Leïla Sebbar arrive à appréhender le peuple arabe ainsi elle parvient à s’attacher avec son père dans sa langue et sur ses terres. Notre écrivaine a écrit sur cette femme : « Isabelle Eberhardt une autre femme excentrique, celle-là je ne l’ai pas connue, on parle encore aujourd’hui dans les villes où elle est passée…d’abord on s’est méfié de cette femme seule, mademoiselle, sans mari ni père ni frère…Qu’est-ce qu’elle venait faire dans ce bled ? »62
Si les souvenirs et les événements algériens n’ont pas été transmis par les parents Sebbar, si l’histoire de la guerre de son pays, ses rites, ses coutumes, et ses légendes créatrices n’existent pas dans la mémoire réelle de notre romancière, la figure identitaire Isabelle Eberhardt admettra de transmettre ce blanc manquant de la filiation rompue dans la famille de Leïla Sebbar.
Il s’avère intéressant de signaler, que ces personnages féminins emblématiques sont cités dans le roman, parce que l’écrivaine se sent inférieure par rapport à ces personnages. Eux, ils ont combattu pour leur cause, ils ont résisté malgré les obstacles et les difficultés rencontrés. Certes, elles n’ont pas nié leurs origines, leurs langues et leurs coutumes, par contre notre écrivaine souffre parce qu’elle est tiraillée entre deux côtés. Pourtant son père connaît bien la langue arabe de son pays, ses origines et ses coutumes, sa fille ignore tout, et ce n’est qu’à travers ces figures combattantes que Leïla Sebbar essaie de se rapprocher à ses origines paternelles afin de trouver son identité perdue.
62 Op.cit. p.82
A travers ce chapitre nous avons essayé d’expliquer le problème de l’identité perdue de notre écrivaine dans son œuvre Je ne parle pas la langue de mon père qui nous révèle les difficultés identitaires de cette dernière. Les obstacles qu’à rencontrés Leïla dans sa mémoire réelle ont été résumés sur trois niveaux : religieux, culturel, et linguistique.
On a ajouté aussi un autre point celui de la présentation des trois figures identitaires qui soutiennent l’écrivaine pour se rapprocher de origines. Donc, c’est grâce à Isabelle Eberhardt, Lalla Fathma N’Soumer et Jeanne d’Arc que Leïla Sebbar tente de s’attacher à ses origines paternelles, ici, il y a en quelque sorte, une jalousie éprouvée de la part de l’écrivaine par rapport à ces trois femmes combattantes.
Concernant son identité linguistique, c’est le silence du père, ce père qui n’a pas transmis son histoire et la langue arabe à ses enfants, ils sont élevés à la française. En effet, pour notre romancière elle ne possède qu’une seule langue, la langue française, pour elle la langue arabe est méconnue, elle est absente et négligée elle ne l’a jamais parlée, ni écrite, ni comprise, elle reste toujours pour elle un rêve à atteindre.
Quant à la religion, nous avons trouvé que Leïla se voit comme une page blanche, elle n’a aucun penchement vers la religion suivie par ses parents, soit la religion islamique celle de son père ou bien la religion chrétienne celle de sa mère, parce que Dieu est absent dans sa vie, donc, son identité religieuse reste encore ambiguë.
Et enfin, son identité culturelle est déséquilibrée, elle a vécu un trouble identitaire, elle ne peut vivre sa part algérienne que dans la fiction, elle est bien évidemment algérienne, l’Algérie c’est son pays natal, elle a une double appartenance mais elle n’a qu’une seule culture c’est la culture française. Donc, notre héroïne dans son roman Je ne parle pas la langue de mon père, explique bel et bien sa nostalgie et son besoin de ses racines et de ses origines.
Conclusion
Arrivons à la fin de cet humble travail, nous nous proposons d’y ajouter un récapitulatif de notre analyse, ainsi de mettre en évidence la vie de notre romancière Leïla Sebbar qui se dévoile dans son roman Je ne parle pas la langue de mon père. Cette œuvre autobiographique dans laquelle, l’écrivaine relate une partie pénible de son enfance notamment l’histoire de son passé lointain qu’elle n’a pas pu l’oublier, car elle est conditionnée de son histoire familiale. Donc, dans cette autobiographie l’auteure éprouve un fort attachement et un profond sentiment de son pays natal.
L’analyse de notre corpus se fonde sur le problème identitaire qui est exposé sous plusieurs formes et sa relation étroite avec la souffrance de la nostalgie et de l’exil qui représentent le centre de notre travail. Dans la même œuvre une écriture que l’on pourrait nommée interculturelle où se présente les traces de deux cultures Française et algérienne, en prévenant le lecteur à jouer avec deux pôles totalement différents : en langue, traditions, habitudes et en religion.
L’analyse de Je ne parle pas la langue de mon père, nous a permis de deviner que Leïla Sebbar dans son roman, a utilisé un style particulier et unique pour parvenir à la définition de son problème identitaire entant qu’une écrivaine exilée et un fruit de mariage mixte, elle semble s’agiter entre deux rives : l’Algérie et la France, elle est considérée comme une citoyenne française, certes, mais sa part algérienne, arabe et musulmane c’est la principale cause qui l’a poussée à écrire. Elle déclare que cette partie est vivante en elle, et elle est située dans le côté de l’émotion incontrôlée.
Au cours du premier chapitre, notre analyse est basée sur l’écriture de l’exil qui se manifeste dans notre corpus, nous avons essayé de répondre à la question suivante : Comment Leïla Sebbar a pu changer cette souffrance d’écartement et d’éloignement de la terre natale et la rendre une source de création? Nous avons donc affirmé que l’exil, pour Sebbar est un endroit de l’écriture, il est une terre autonome où s’invente une littérature étrangère, où se réalise un univers qui mélange l’individuel et le social, où s’applique une vision d’un réel non transmis, compliqué, et souvent violent.
Ensuite, nous avons vu nécessaire d’aborder la notion de mariage mixte, en retenant que, pour Leïla Sebbar le métissage ne paraît pas positif car, sa famille vit dans une espèce d’exil linguistique, en effet, l’arabe est l’interdit de la colonie et la culture transmise vient de l’Europe. Donc, de ce fait, la langue sera la porteuse de culture et de traditions, c’est avec ce manque du verbe arabe notre écrivaine n’arrive pas à joindre sa famille paternelle, elle a un
certain écart vis-à-vis ses tantes et sa grand-mère, cela est indiqué dans les chapitres suivants :
« je ne parle pas la langue des sœurs de mon père » et « mon père ne m’a pas appris la langue de sa mère ». Donc, l’absence de la langue arabe a créé une fracture et une coupure dans l’identité de Sebbar.
Nous avons tenté, au cours du deuxième chapitre, de répondre à la question suivante: Comment se manifeste le déchirement identitaire dans le roman? Nous avons donc affirmé que le problème identitaire est largement exprimé dans le texte de Leïla Sebbar, ce chapitre comporte aussi à étudier l’identité perdue de l’écrivaine, en mettant l’accent sur son appartenance: linguistique, religieuse et culturelle.
En déduisant que son déracinement et son déchirement identitaire la met dans un état déséquilibré, donc Leïla Sebbar n’arrive pas à trouver sa place entre les différentes identités, elle se trouve exclue de la communauté arabe algérienne puisqu’elle ne maîtrise pas la langue arabe, et enfin, pour trouver une part de son identité algérienne Leïla Sebbar fait recours aux figures féminines combattantes, elle essaie de se rapprocher à ses origines paternelles afin de trouver son identité perdue.
Donc, nous pouvons dire après ce travail de recherche que la méconnaissance de la langue et l’écart vis-à-vis de la société a conduit à la découverte d’une nouvelle identité qui représente à cette femme la confiance et la quiétude. Notre travail affirme que l’étude de sujet de l’identité et l’exil peut s’élaborer sous de divers niveaux : linguistique, culturel, religieux, et de métissage et de mixité. En effet, Je ne parle pas la langue de mon père de Leïla Sebbar est une création littéraire d’enrichissement, elle se présente comme une source de fascination et d’inspiration aux lecteurs. Donc la lecture de cet ouvrage transmette aux lecteurs énormément de savoir et de plaisir.
Pour conclure ces propos, nous rappelons au lecteur que le phénomène de l’exil et la quête identitaire ont été appliqués moult fois, mais il serait toujours intéressant et enrichissant de continuer dans cette perspective et de voir par exemple d’autres procédés sur les œuvres de Leïla Sebbar. Ainsi la conclusion reste ouverte à d’autres itinéraires, et à d’autres recherches identitaires.
________________________
61 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles figures identitaires sont présentes dans le roman de Leïla Sebbar ?
Leïla Sebbar cite des figures emblématiques comme Lalla Fathma N’Soumer, Jeanne d’Arc et Isabelle Eberhardt, représentant des symboles de dévouement et de sacrifice pour leur pays.
Comment Isabelle Eberhardt influence-t-elle l’identité de Leïla Sebbar ?
Isabelle Eberhardt est une figure identitaire pour Leïla Sebbar, car elle incarne ce que Sebbar a perdu et manqué, et elle représente un ‘exil heureux’ en Algérie malgré ses origines russes.
Pourquoi Leïla Sebbar se sent-elle inférieure par rapport aux figures féminines de son roman ?
Leïla Sebbar se sent inférieure parce que ces personnages ont combattu pour leur cause et ont résisté aux obstacles, tandis qu’elle souffre d’un tiraillement entre deux cultures et identités.