La fiction et historicité dans l’art de perdre révèlent comment Alice Zeniter utilise habilement la narration pour combler les lacunes de l’histoire algérienne. Cette étude met en lumière des perspectives inédites sur les événements, transformant notre compréhension de la mémoire collective et de la littérature engagée.
Une intertextualité au service du récit :
« Oui, l’historicité du texte littéraire, c’est d’abord cela, son emballage, son enveloppe, peut- être commercial, mais qui est toujours une enveloppe intellectuelle et vice versa. »139
Comme nous l’avons précédemment affirmé, l’aventure d’écrivaine d’Alice Zeniter a commencé précocement, quand elle était plus jeune et écrivait ses passions et son caprice enfantin, une passion d’une telle ténacité que même la carrière de grande écrivaine ne dissipera pas : « Que j’écrive pour les adultes ou pour les enfants, je n’arrive pas vraiment à me représenter qui est le lecteur, donc je fais ce que je pense être bon » et elle a insisté : « Je pense que je suis encore énormément une enfant. » 140
Et c’est comme cela que nait L’Art de Perdre avec sa couverture du lion dessiné : « j’aime beaucoup l’écriture animalière et les animaux qui parlent ! Les histoires et les blagues avec des animaux… C’est un pan un peu débile de mon être – d’où le lion sur la couverture de L’Art de perdre (2017) »
Sans pour autant ignorer le fait que l’auteure vise ainsi à séduire une grande tranche du lectorat, que sont les collégiens et les artistes.
Alice Zeniter c’est aussi une amatrice d’art plastique, ce qui se reflète énormément dans son roman, dans certaines descriptions qui rendent le portrait figé : « Naïma trouve qu’il ressemble à Hemingway avec sa barbe blanche, sa moustache à la couleur légèrement répugnante et ses yeux noirs qui ne sourient pas – le sourire apparaît dans les plis autour des yeux, jamais dans un réchauffement de l’iris »141
De la photo de Messali Hadj qui représente la rébellion et la révolution, en passant par celles de l’Irlande dévastée, aux photos d’Ali et Hamid qui représentent les seules traces d’une histoire familiale… ce sont autant d’exemples qui servent à alimenter l’intrigue, et qui pourraient servir comme des documentations, la photographie constitue une sorte d’inspirations pour l’écrivaine :
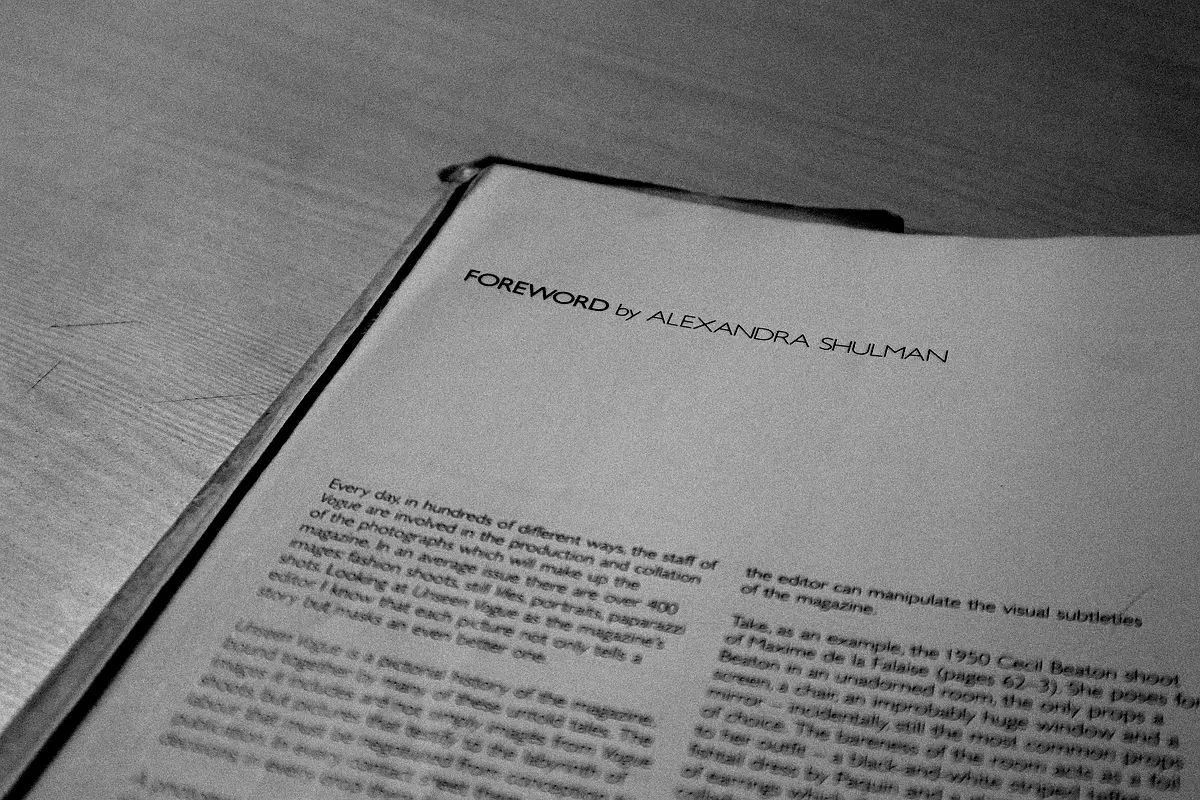
« Parfois j’ai le souvenir des mots agencés sur une page, c’est l’expérience de la lecture, mais parfois il y a une image que j’ai recréée, un homme qui marche seul dans le froid
139 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p.75.
140 Julia Vergely, Alice Zeniter : “Toute mon enfance j’ai lu de tout dans un joyeux bordel”, in Télérama, en ligne https://www.telerama.fr/enfants/alice-zeniter-quand-jecris-pour-les-enfants,-je-me-laisse-aller,-sans- snobisme,n6140266.php (consulté le 28/07/2020 à 02:00h)
141 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 466.
c’est Neige d’Orhan Pamuk, ce livre existe pour moi en une succession d’images. C’est une sorte de cinéma plus plastique. »142
La profession de scénariste et de metteur en scène ont aussi leur empreinte sur le style de l’écrivaine, d’abord les citations et les extraits tirés des films ne manquent pas dans le roman, toutefois la comparaison établie entre le départ d’Ali et sa famille et : « la scène de La Guerre des mondes où Tom Cruise et ses deux enfants tentent de monter à bord d’une navette fluviale dont les militaires défendent l’accès.
», 143 reste la plus signifiante. L’auteure accommode ainsi son style au cinéma, prêtant une immense importance aux représentations de la lumière et les couleurs comme dans cet extrait : « Il fait nuit, nuit totale, nuit dense, une de ces nuits qui ne permettent pas de dire si ce qui est là-haut, tout proche dans l’étendue noire, c’est le ciel obscurci ou le feuillage invisible des arbres.
Il fait nuit calme et profonde, et la petite voiture de Gilles avance sur les routes qui se déroulent, deux mètres par deux mètres, dans le rayon de ses phares. Soudain, un trou de lumière dans le tissu opaque : jaune, orange, rouge, qui déchirent la nuit de flammes et la percent d’étincelles »144
Conservant toujours les marques de mobilité et de visualité comme dans le chapitre du Milk Bar :
« Ali se relève, sonné. Sans même réfléchir, il part en courant. Il s’enfuit avant que n’arrive la police ou l’armée. Il ne veut pas être le basané trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il court aussi vite qu’il le peut. Il ne sait plus où il a laissé la voiture. Il est perdu. Il dépasse des groupes de gamins qui jouent pieds nus »145.
Cette approche opérée par Alice Zeniter est caractéristique du cinéma : « Le stylicien souligne que l’absence de limite temporelle donne l’impression d’un temps long voir suspendu ce qui transforme la scène en photographie ou en tableau vivant. »146
L’écrivaine prouve, tout au long du récit, une maitrise parfaite de la narration de faits supposés s’être déroulés dans l’Algérie actuelle ou même pendant la guerre, déployant des stéréotypes algériens en vigueur, des traditions et des comportements typiques, des informations
142 Claire Devarrieux, entretien avec Alice Zeniter, in Libération, en ligne https://next.liberation.fr/livres/2017/09/01/entretien-avec-alice-zeniter-enfant-j-ignorais-pourquoi-on-n-allait-pas- en-algerie_1593592. (consulté le 02/08/2020 à 13:50h)
143 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 525.
144 Ibid, p.334.
145 Ibid, p.111.
146 David Zemmour, Une syntaxe du sensible, Claude Simone et l’écriture de la perception, Paris, Presses universitaires de Paris Sorbonne, 2008, p.274.
géographiques et archéologiques de l’Algérie, ce qui est indispensable et indissociable du roman historique : « Le problème de l’historicité et de l’historisation est profondément lié au problème du savoir, de sa formation, de sa transmission, de son acquisition, de son enrichissement et de sa transformation »147
C’est toute une enquête vers le savoir dont Alice Zeniter, de son aveu même, doit à deux chercheurs les informations investies : « Pendant que j’étais en train de lire, il y avait des choses qui me sautaient aux yeux comme étant des matériaux de fiction. Par exemple, j’ai beaucoup lu les travaux de Pierre Bourdieu et d’Abdelmalek Sayad à la fois sur la fin de l’Algérie rurale et sur l’émigration. »148
En effet, cela se voit pertinemment dans L’Art de Perdre, l’auteure reprend tout ce qui concerne les structures sociales en Algérie, les modes de vie et notamment le repérage spatial des œuvres de Bourdieu :
« Implantés avec des densités très fortes en des régions de relief difficile, les Kabyles sont avant tout arboriculteurs. Leurs habitations se groupent en villages ; tournant le dos à l’extérieur, elles forment une sorte d’enceinte sans ouverture, aisée à défendre, et ouvrent sur des ruelles étroites et raboteuses. À l’entrée de l’agglomération où se trouvent les aires à battre, le grenier à fourrage, les meules et les presses rustiques destinées à la fabrication de l’huile, les sentiers se dédoublent afin que l’étranger qui n’y a pas affaire puisse passer son chemin sans entrer. »149
Etant donné qu’Ali travaille comme producteur d’huile, on pourrait distinguer ainsi certaines ressemblances avec cet extrait de L’Art de Perdre :
« Eux vivent un peu plus bas sur la crête, dans ce que les Français appellent de manière trompeuse le « centre » de cette succession de sept mechtas, des hameaux situés sur le fil de la roche, les uns après les autres, comme des perles éparses sur un collier trop long. En réalité, il n’y a pas de centre, pas de mitan autour duquel se seraient formées ces grappes de maisons, même la maigre route qui les relie n’est qu’une illusion : chaque mechta forme un petit monde à l’abri de ses arbres et de ses murs et l’administration française a fusionné
147 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p.80.
148 Claire Devarrieux, entretien avec Alice Zeniter, in Libération, en ligne https://next.liberation.fr/livres/2017/09/01/entretien-avec-alice-zeniter-enfant-j-ignorais-pourquoi-on-n-allait-pas- en-algerie_1593592(consulté le 02/08/2020 à 13:50h)
149 Bourdieu Pierre, Sociologie de L’Algérie, France, PUF, 2006, p.11.
ces univers minuscules en une circonscription administrative, un douar qui n’existe que pour elle. »
Quant aux périodisations des événements, les répercussions de la guerre et les enjeux des immigrations l’auteure semble s’inspirer énormément d’Abdelmalek Sayad: « Quand ils reviennent en vacances, c’est l’été, c’est la grande foule dans le village, c’est la joie partout, ce sont les noces. Avant de savoir, je pensais qu’en France aussi c’était tout le temps comme cela, que ce sont eux qui amenaient avec eux toute cette joie […] Non, qu’attendre des visages de la désolation ? Je me suis rendu compte que la joie n’était pas la leur, et que c’est même le contraire, ils viennent la retrouver au pays, quoi qu’ils en disent. »150
Si on reprend le dialogue qui se déroule entre Mohand et Ali et qu’on le compare avec celui d’Abdelmalek Sayad et l’émigrant, on se rendrait vite compte qu’il est d’une similarité évidente avec ce dernier, d’autant plus que l’interlocuteur dans les deux dialogues c’est Mohand : « Après quand ils reviennent, ils font les malins. Ils sortent l’argent en veux-tu en voilà. Ils font semblant d’avoir oublié comment ça marche au village et ils n’ont que la France à la bouche. Tu pourrais croire que là-bas, ils sont les rois. »151
L’auteure s’appuie sur ces deux œuvres afin de concevoir le monde référentiel du roman là où elle insufflait vie à ses personnages fictionnels.
Cependant, ce ne sont pas les seuls travaux qui l’inspirent et l’accompagnent pendant l’aventure scripturale ; les mythes ainsi semblent influencer l’écrivaine : « le fils de Laerte s’offre à nous, à chaque étape de son destin littéraire, avec une force de présence qui rend à lui faire quitter l’aura révérencielle dont jouissent, par exemple, Antigone ou Œdipe, pour le statut d’une personne à laquelle il devient possible de s’identifier. »152.
Quitter sa vie aisée pour s’aventurer dans une quête d’identification, n’est-ce pas le même périple qu’endurait Naïma :
« Je crois que chacun peut décider de ne pas être déterminé par le passé de sa famille et l’histoire de sa famille, mais que pour avoir la possibilité de refuser ce passé et cette histoire, pour dire ça
150 Sayad Abdelmalek, La Double Absence, France, Éditions du Seuil, 1999, p.19. in Jugurtha Bibliothèque en ligne https://jugurtha.noblogs.org/files/2018/02/La-Double-Absence-de-Abdelmalek-Sayad.pdf (consulté le 04/08/2020 à 00:40h)
151 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 381.
152 Pierre Brunel, Dictionnaire des Mythes littéraires, France, Éditions du Rocher, 1988, p.1401.
ne me concerne pas, je ne suis pas déterminé par ça, il faut y avoir accès, et en fait Naima n’a pas d’accès à ce passé et elle va devoir le conquérir, conquérir la connaissance sur ce passé »153
Ainsi, l’odyssée avec tout ce qu’elle porte d’exotisme, parait d’une similarité évidente avec le monde oriental aux yeux de l’écrivaine, elle tend même à tirer des exemples de l’un pour expliquer l’autre :
«Ils partagent ensemble l’asseksou, le repas traditionnel. Les plats de viandes et de couscous sont énormes, on ne peut les porter qu’à plusieurs et ils semblent sans fond malgré l’enthousiasme des mains et des mâchoires qui les attaquent.
Cette vignette-là, quand elle est racontée, paraît sortie de l’Odyssée. Elle rappelle le chant dans lequel les compagnons d’Ulysse profitent du sommeil de leur capitaine pour se servir dans le troupeau sacré d’Hélios. »154
Alice Zeniter s’ingénie alors à mettre les valeurs rapportées par les mythes en adéquation avec les réalités de ses personnages, en nous conviant ainsi à des lectures actives, à déchiffrer les allusions et les moralités dissimilées entre les lignes de l’œuvre.
Alice Zeniter semble aussi influencée par deux romans, le premier c’est l’Histoire sans Fin155 de Michael Ende, le roman qui a marqué sa vie. il raconte l’histoire d’un petit enfant isolé et rejeté, Bastian un enfant qui souffre l’intimidation des enfants du quartier, un jour il dérobe un livre de la librairie, un livre très particulier qui le projette dans un monde fantastique là où l’enfant se trouve contraint de combattre le néant qui dévore son monde imaginaire , tout comme Alice Zeniter se trouve contrainte de sauver son histoire du silence de l’Histoire, un trait qui pourrait lier les deux :
« ce livre il me plaisait surtout parce qu’il raconte pourquoi on devient un écrivain, qu’au bout d’un moment être lecteur c’est un plaisir qui reste aussi immense, mais qu’à un moment donné on a envie de nous-même inventer les histoires, pour prolonger le plaisir de la lecture, et je pense que l’Histoire sans fin au milieu, voilà, au milieu d’une histoire absolument extraordinaire c’est un livre qui est fait pour créer des écrivains. »156
153 France 24, L’art de perdre, d’Alice Zeniter, in Youtube, vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=0E07LY1JeDE&t=152s (consulté le 04/08/2020 à 14:15h)
154 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.89.
155 https://www.babelio.com/livres/Ende-LHistoire-sans-fin/3818
156 La Grande Librairie, Le livre qui a changé votre vie, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=K9exoK4W4SY(consulté le 05/08/2020 à 03:14h)
D’ailleurs c’est ainsi que le roman s’ouvre sur la détresse de Naima : Naima s’isolait dans la maison pour que les des gueules de bois, qu’elle a tant subi, soient vide de tout. Mais après tant de méditation et d’isolement, Naima enfin et à un moment donné décide de faire son récit et son enquête refusant le silence et le mutisme.
Le deuxième roman c’est Le Monde selon Garp157 de John Irving. Récit qui traite de l’aventure de l’écriture de Jenny qui se bat pour le féminisme et son fils Garp qui voit que dans le monde c’est l’imagination qui règne, un roman qui aborde aussi le thème de la créativité littéraire ; Alice Zeniter s’inspire et se reconnait dans ce roman : « Je me reconnais énormément dans ce livre, sur ce que c’est le rapport à l’écriture, aussi parce que c’est un livre qui travaille énormément sur la question des ellipses. »158
En effet, la question du silence occupe une place prépondérante dans L’Art de Perdre, l’ellipse, la synthétisation et la réticence sont toujours présente dans les descriptions des scènes traumatiques.
Pour conclure, Alice Zeniter nous rappelle qu’un texte n’existe jamais tout seul, que le roman historique est impérativement une jonction d’autres textes, que l’un puise de l’autre afin d’assurer la transmission du savoir.
157 https://www.babelio.com/livres/Irving-Le-monde-selon-Garp/1780
158 Département des Côtes d’Armor, Ah, si j’étais… Alice Zeniter, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=aNxrfxbsRqA(consulté le 05/08/2020 à 15:30h)
________________________
139 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p.75. ↑
140 Julia Vergely, Alice Zeniter : “Toute mon enfance j’ai lu de tout dans un joyeux bordel”, in Télérama, en ligne https://www.telerama.fr/enfants/alice-zeniter-quand-jecris-pour-les-enfants,-je-me-laisse-aller,-sans- snobisme,n6140266.php (consulté le 28/07/2020 à 02:00h) ↑
141 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 466. ↑
142 Claire Devarrieux, entretien avec Alice Zeniter, in Libération, en ligne https://next.liberation.fr/livres/2017/09/01/entretien-avec-alice-zeniter-enfant-j-ignorais-pourquoi-on-n-allait-pas- en-algerie_1593592. (consulté le 02/08/2020 à 13:50h) ↑
143 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 525. ↑
146 David Zemmour, Une syntaxe du sensible, Claude Simone et l’écriture de la perception, Paris, Presses universitaires de Paris Sorbonne, 2008, p.274. ↑
147 Pierre Barberis, Le prince et le marchand, Paris, éditions Fayard, 1980, p.80. ↑
148 Claire Devarrieux, entretien avec Alice Zeniter, in Libération, en ligne https://next.liberation.fr/livres/2017/09/01/entretien-avec-alice-zeniter-enfant-j-ignorais-pourquoi-on-n-allait-pas- en-algerie_1593592(consulté le 02/08/2020 à 13:50h) ↑
149 Bourdieu Pierre, Sociologie de L’Algérie, France, PUF, 2006, p.11. ↑
150 Sayad Abdelmalek, La Double Absence, France, Éditions du Seuil, 1999, p.19. in Jugurtha Bibliothèque en ligne https://jugurtha.noblogs.org/files/2018/02/La-Double-Absence-de-Abdelmalek-Sayad.pdf (consulté le 04/08/2020 à 00:40h) ↑
151 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 381. ↑
152 Pierre Brunel, Dictionnaire des Mythes littéraires, France, Éditions du Rocher, 1988, p.1401. ↑
153 France 24, L’art de perdre, d’Alice Zeniter, in Youtube, vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=0E07LY1JeDE&t=152s (consulté le 04/08/2020 à 14:15h) ↑
154 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.89. ↑
155 https://www.babelio.com/livres/Ende-LHistoire-sans-fin/3818 ↑
156 La Grande Librairie, Le livre qui a changé votre vie, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=K9exoK4W4SY(consulté le 05/08/2020 à 03:14h) ↑
157 https://www.babelio.com/livres/Irving-Le-monde-selon-Garp/1780 ↑
158 Département des Côtes d’Armor, Ah, si j’étais… Alice Zeniter, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=aNxrfxbsRqA(consulté le 05/08/2020 à 15:30h) ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment Alice Zeniter utilise-t-elle la fiction dans ‘L’Art de Perdre’?
Alice Zeniter utilise la fiction pour combler les lacunes historiques et offrir une perspective alternative sur les événements.
Quelle est l’importance de l’intertextualité dans ‘L’Art de Perdre’?
L’intertextualité sert le récit en ajoutant une enveloppe intellectuelle au texte littéraire.
Comment le style d’Alice Zeniter est-il influencé par son expérience de scénariste?
Le style d’Alice Zeniter est influencé par son expérience de scénariste à travers l’utilisation de citations et d’extraits tirés des films, ainsi que par l’importance accordée aux représentations de la lumière et des couleurs.