Le dialogue et mémoire historique révèlent comment Alice Zeniter utilise la fiction pour combler les lacunes de l’Histoire. En explorant la transmission orale dans L’Art de Perdre, cette recherche met en lumière des perspectives inédites sur les événements algériens, transformant notre compréhension de la mémoire collective.
Dialogue entre Naima et Lalla :
Un élément important pour recouvrir les béances de mémoire et les mutismes de l’Histoire est la transmission orale ; cette dernière consiste souvent dans L’Art de Perdre aux lapsus qui échappent à Ali ou à Hamid, ou des dialogues qu’entretient Naima avec Lalla.
Si la transcription du discours oral risque de lui amputer ses particularités gestuelles et intonatives, l’auteure devrait fonder une logique susceptible de s’adapter avec cette situation nouvelle108.
L’auteure, afin d’assurer la crédibilité du dialogue, s’emploie à faire que l’on croie au contexte, elle réussit ce manœuvre en s’appuyant sur une réalité reconnue et préexistante, celle du racisme et de harcèlement que beaucoup de musulmans subissent systématiquement après tout acte de terrorisme, alors l’auteure convoque une référence connue et commune aux peuples algérien et français : « En descendant du RER pour se rendre chez Lalla quelques jours plus tard, Naïma voit sur un abribus comme un remugle des profondeurs d’Internet qui aurait ressurgi :
MORTS AUX MUSULMANS LA VALISE OU LE CERCUEIL
»109
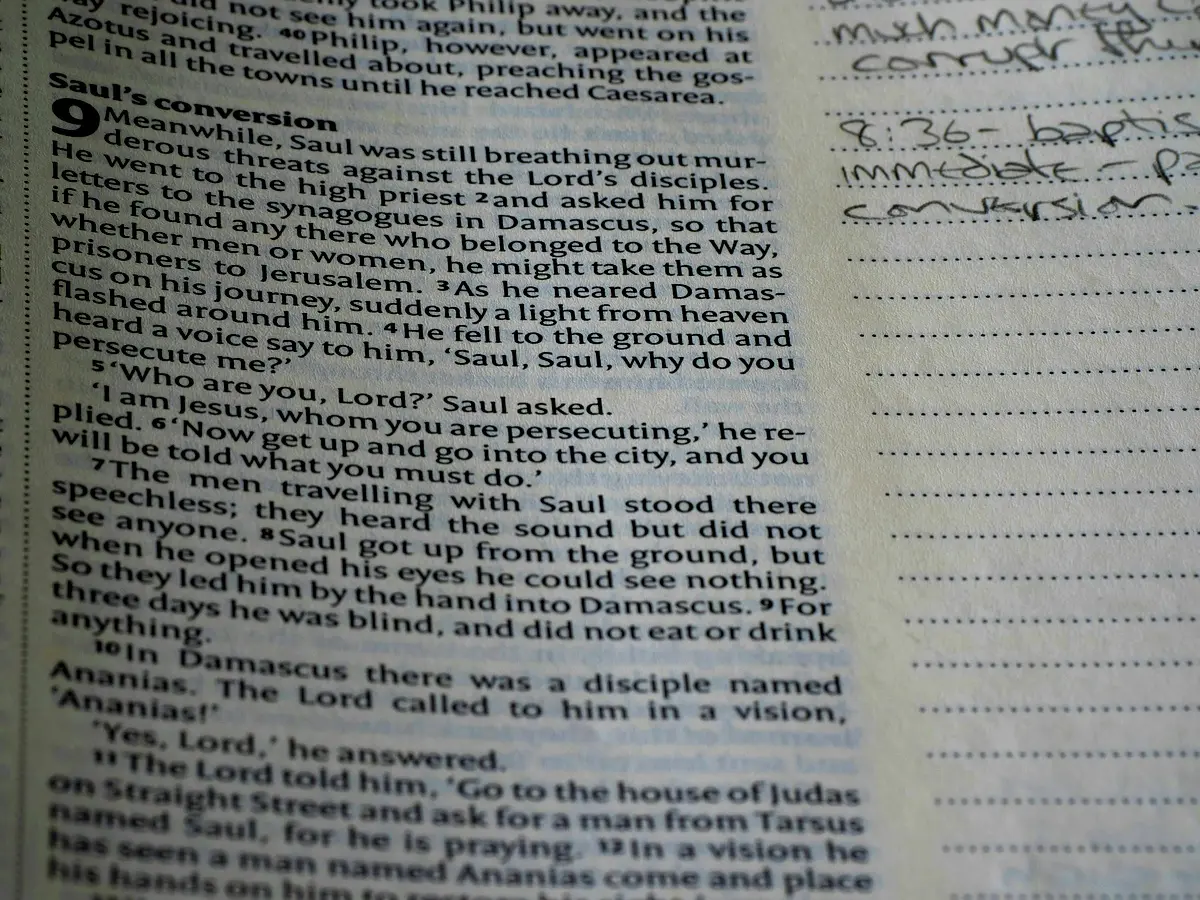
Cette dernière expression est ancrée profondément dans l’Histoire algérienne, la première occurrence était pendant la guerre de la libération, suite aux attentats perpétrés par l’OAS envers des citoyens algériens parmi lesquels le célèbre écrivain Mouloud Feraoun110, et elle est apparu aussi pendant l’exode de la communauté pied-noir, cette thématique a été traitée méticuleusement dans le roman Alger la noire de Maurice Attia111 qui y consacre tout un chapitre sous le titre « la valise et le cercueil ». C’est ainsi que l’auteure remet en cause l’impunité des Européens, en nous faisant remarquer que même si les époques et les circonstances diffèrent, les idéologies restent intactes.
De plus, l’auteure matérialise le contexte en se référant à de faux témoignages, une idée qui est conçue et présentée comme vraie, mais qui n’existe pas réellement : « Quand elle en
108 Odile Riondet, Paul Ricœur : le texte, le récit et l’Histoire, in BBF, en ligne https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf- 2008-02-0006-001(consulté le 10/08/2020 à 23:00h)
109 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 513.
110 Zerrouky Hassane, oas « La valise ou le cercueil », in l’Humanité, en ligne https://www.humanite.fr/node/314732(consulté le 11/08/2020 à 00:40)
111 Maurice Attia, Alger la Noire, France, Babel Noir, 2005, p. 06.
parle à Céline, celle-ci lui apprend que, la veille, la salle de prières de la ville a été retrouvée barricadée de lard et de tranches de jambon. »112
En s’appuyant toujours sur le statut fictionnel, l’auteure se permet de créer un faux témoignage113, ce qui donne un effet de réel sans pour autant leurrer et abuser de la perception des lecteurs, vu qu’elle dénote toujours la fiction dans la narration et ne la donne pas comme fait attesté : l’imitation de la démarche documentaire n’est qu’une passage vers une réalité générale celle du racisme, pour ainsi garder un rapport éthique avec l’Histoire.
Partant de ce référent114 selon lequel le racisme envahit les médias Européens après tout incident, Lalla explique ses convictions auprès de ses auditeurs Naima et Céline :
« — Le racisme est d’une bêtise crasse, gronde Lalla en direction de sa compagne.
Ne me dis pas que ça te surprend. Il est la forme avilie et dégradée de la lutte des classes, il est l’impasse idiote de la révolte. »115
Le discours de Lalla est marqué par l’oralité et par la colère qui se reflètent dans le langage familier comme dans la communication réelle, ainsi des expressions comme : « Et d’un geste de la main, il désigne les petits pavillons du 77 qui lui paraissent crever d’ennui les uns à côté des autres »116 permettant de faire référence immédiat au concret. En déployant ses arguments, les interlocuteurs restent muets, ce qui lui permet de développer des tirades sans interruption :
« — Bien sûr que oui, tonne Lalla, encore et toujours ! C’est exactement ça le problème : on vous a fait croire à vous, les plus jeunes, que ces mots-là étaient creux, poussiéreux, dépassés. Plus personne ne veut en parler parce que ce n’est plus sexy, la lutte des classes.
Et en guise de modernité, de glamour politique, qu’est-ce qu’on vous a proposé – et pire, qu’est-ce que vous avez accepté ? Le retour de l’ethnique. […]. Ils nous montrent Fadela Amara, Rachida Dati, Najat Vallaud-Belkacem au gouvernement. Mais la peau brune, le nom arabe, ça ne suffit pas. Bien sûr, c’est beau qu’elles aient pu réussir avec ça – ça n’était pas gagné – mais c’est aussi tout le problème : elles ont réussi.
Elles n’ont aucune légitimité à parler des ratés…. »117
112 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 513.
113 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p. 50.
114 RÉFÉRENT : la situation à laquelle renvoie le message. En ligne https://www.sfu.ca/fren270/semiologie/page2_2.html
115 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 513.
116 Ibid, p. 514.
117 Ibid, p. 513.
En utilisant le pronom « vous » Lalla inclut aussi les interlocuteurs par ses propos et crée un contact avec eux, parce que finalement son discours n’a de sens qu’avec les impacts sur les auditeurs, ceux qui lui étaient paru comme des ignorants de son discours sur le racisme, et qui le contraignent, afin de pouvoir transmettre son point de vue, à donner des exemples, d’éclaircir, de s’interroger sur les phénomènes sociaux et d’éprouver le déplaisir.
C’est tout un processus pour affecter la transmission des idées, voire de l’Histoire, et de dénoncer implicitement les idéologies racistes, face à ses auditeurs circonspects, muets, accusés de prendre la mauvaise voie et n’avoir aucune raison, vu le silence régnant sur leur position et qui leur vaudrait de véritables remontrances, ce qu’affirmera Naima par la suite, après avoir eu le courage d’exposer son point de vue :
« Elle se dit qu’il est difficile d’en vouloir au vieil homme pour de nombreuses raisons. Tout d’abord parce qu’il dispose déjà d’une cohorte d’ennemis, officiels et prestigieux, à qui il doit son exil et auprès de qui Naïma ferait pâle figure. Ensuite parce qu’il se pourrait très bien qu’il ait raison. »118
Il est en effet possible que la position de Naima et Céline soit d’un égarement flagrant, cependant, l’auteure insinue qu’il ne saurait pas être question de voir l’Histoire d’une seule et unique trajectoire, mais avec les pluralités des voix et les points de vue, et qu’il s’agit d’emblée d’observer la manière selon laquelle l’Histoire s’institue et se fait divulguer.
Mise en abyme :
Après avoir terminé son travail et obtenu des réponses liées à son histoire familiale en Algérie, Naima rentre chez elle en France pour disposer les derniers préparatifs pour la rétrospective de Lalla, cela implique un texte qui présente les travaux du peintre.
Nous nous intéresserons à ce texte vu qu’il est écrit par la porte-parole de l’auteure dans le dernier chapitre, donc il reflète et rappelle, plus ou moins, les mystères de l’écriture fictionnelle de l’Histoire :
118 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, Ibid, p. 516.
« L’œuvre de Lalla est empreinte d’une violence enfantine, mais « enfantine » n’est pas à prendre ici comme un qualificatif qui atténuerait la violence. Au contraire, il s’agit du stade auquel la violence est la plus terrible parce qu’elle ne peut prendre aucun sens. On voit revenir dans ses travaux diverses figures qui surgissent à la fois de l’Histoire de l’Algérie et des cauchemars d’un enfant : l’homme-feu et l’homme-fer, des morceaux de corps, de cordes et de barrières »119
Tout d’abord, Naima souligne l’impossibilité de donner sens à la violence et la cruauté de la guerre, et comme le peintre elle s’y prend à divers procédés d’esthétisation pour en donner une autre réalité plus perceptible : c’est à travers l’opacité que nais le sens. Ainsi elle nous fait remarquer que l’Histoire est vécue comme une expérience plurielle dont rien ne puisse échapper, bien qu’il soit à chacun sa vision et sa manière de transmission ce qu’on voit par la suite : « À cet endroit du texte, elle efface une phrase : Lorsqu’il les dessine, Lalla paraît créer comme on explose, comme on meurt. »120
L’écriture de l’Histoire passe par des tâtonnements, des hésitations entre des choix narratifs et esthétiques qui dépendent de la subjectivité de l’écrivain.
Ensuite, Naima nous propose de sortir du cadre de la guerre, de l’inhabituel et de l’inattendu et voir le sens de l’Histoire dans une image plus familière, et d’éprouver une autre expérience esthétique et sensorielle121 : « Mais dans d’autres séries de dessins, on trouve des visages amicaux, des portes entrouvertes, des esquisses d’animaux qui s’enroulent autour des ruines antiques caressées par une nature lourde de présents. »122
On peut constater que Naima prend en considération de minces détails, tout comme le peintre, afin d’assurer le caractère visuel et nous donner l’impression de faire voir la réalité par la vision, ce qui donne une impression de vraisemblance et de vivacité.
En dernier lieu, le texte nous rappelle que la restitution de l’Histoire se fait en superposant le passé et le présent, et que l’Histoire se fonde sur des possibilités, alors rien n’est absolu :
« Ce que nous disent plus de cinquante ans de dessins et de peintures, c’est qu’un pays n’est jamais une seule chose à la fois : il est souvenirs tendres de l’enfance tout autant que guerre civile, il est peuple comme il est tribus, campagnes et villes, vagues d’immigration et
119 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 602.
120 Ibid.
121 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p. 285.
122 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 602.
d’émigration, il est son passé, son présent et son futur, il est ce qui est advenu et la somme de ses possibilités. »123
En ce qui concerne la concrétisation de cet extrait de mise en abyme, il est facilement remarquable que l’auteure confie à Naïma, sa porte-parole, certains secrets de l’écriture littéraire de l’Histoire qu’on a déjà eu la chance de découvrir par l’analyse ; cette mise en abyme nous renseigne sur la manière dont l’Histoire est écrit, une tradition souvent présente dans les romans historiques et un facteur destiné à assurer la transparence du texte124 qui insinue que l’Histoire prendre sens dans la sphère d’esthétique.
123Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit , p. 603.
124Lucien Dallenbach, La mise en abyme, Encyclopédie Universalis2016.
________________________
108 Odile Riondet, Paul Ricœur : le texte, le récit et l’Histoire, in BBF, en ligne https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf- 2008-02-0006-001(consulté le 10/08/2020 à 23:00h) ↑
109 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 513. ↑
110 Zerrouky Hassane, oas « La valise ou le cercueil », in l’Humanité, en ligne https://www.humanite.fr/node/314732(consulté le 11/08/2020 à 00:40) ↑
111 Maurice Attia, Alger la Noire, France, Babel Noir, 2005, p. 06. ↑
112 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 513. ↑
113 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p. 50. ↑
114 RÉFÉRENT : la situation à laquelle renvoie le message. En ligne https://www.sfu.ca/fren270/semiologie/page2_2.html ↑
115 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 513. ↑
118 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, Ibid, p. 516. ↑
119 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 602. ↑
121 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p. 285. ↑
122 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 602. ↑
123 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit , p. 603. ↑
124 Lucien Dallenbach, La mise en abyme, Encyclopédie Universalis2016. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment le dialogue contribue-t-il à la mémoire historique dans ‘L’Art de Perdre’?
Un élément important pour recouvrir les béances de mémoire et les mutismes de l’Histoire est la transmission orale, souvent présente dans L’Art de Perdre à travers les dialogues entre Naima et Lalla.
Quelle est l’importance du racisme dans le roman ‘L’Art de Perdre’?
L’auteure remet en cause l’impunité des Européens en soulignant que même si les époques et les circonstances diffèrent, les idéologies restent intactes, notamment à travers des références au racisme et au harcèlement que subissent les musulmans.
Comment Alice Zeniter utilise-t-elle la fiction pour traiter des événements historiques?
Alice Zeniter utilise des faux témoignages et des éléments fictionnels pour créer un effet de réel, tout en gardant un rapport éthique avec l’Histoire, en dénotant toujours la fiction dans la narration.