La déroutinisation culturelle au Congo révèle des mécanismes de défense insoupçonnés dans la communication interculturelle. Cette recherche innovante met en lumière comment les interactions multiculturelles redéfinissent les repères socioculturels, offrant des perspectives essentielles pour comprendre les dynamiques contemporaines.
- Communications généralisées et contextualités situationnelles de la « déroutinisation »
- Description de cas
- Communications généralisées et contextualités situationnelles de la « déroutinisation »
Pour comprendre comment les acteurs sociaux congolais produisent la « déroutinisation » dans un contexte multiculturel, les sujets enquêtés ont été appelés à tour de rôle à discuter autour du thème ci-après : « la cohabitation avec des gens d’autres provinces vous a fait perdre vos repères et codes habituels ».
Les données recueillies de ces échanges peuvent être résumées comme suit455 :
- Bandundu : Jamais la cohabitation avec des ressortissants d’autres provinces ne nous a fait perdre les repères et codes habituels, puisque nous sommes jaloux de notre culture, c’est pour cette raison que nous la conservons.
- Bas-Congo : Souvent, il est observé que les Bakongo perdent aussi leurs codes culturels. Cela arrive, par exemple, lors de la cohabitation avec les Equatoriens. Ceux-ci leur ont permis de s’ouvrir et d’être francs plutôt que réservés et rancuniers. Aujourd’hui, des Bakongo parlent d’autres langues (Lingala, Swahili et Tshiluba).
- Equateur : Très souvent nous perdons nos repères et codes culturels par la rencontre avec d’autres. Actuellement, nous commençons à imiter les Kinois dans leurs habitudes langagières, vestimentaires et alimentaires. Par rapport au langage, aujourd’hui, on prononce « kwanga » au lieu de « ngwaka », en français c’est le « Chikwange ».
Dans l’habillement, les jeunes filles sont devenues indécentes avec le port de maillot de corps, de pantalon et mini-jupe. Pour le régime alimentaire, les autochtones s’habituent actuellement à prendre du thé le matin à la place de la nourriture, à manger le « fufu » à la place de la chikwange.
Dans la construction, au village Yakoma, les autochtones abandonnent petit à petit les maisons en « hutte sans chambre » au profit des constructions modernes. Actuellement, on voit des maisons confortables avec un salon et des chambres, des maisons construites en briques cuites avec des tôles à la place des maisons en terre battue et en paille (appelé Ndele en langue locale).
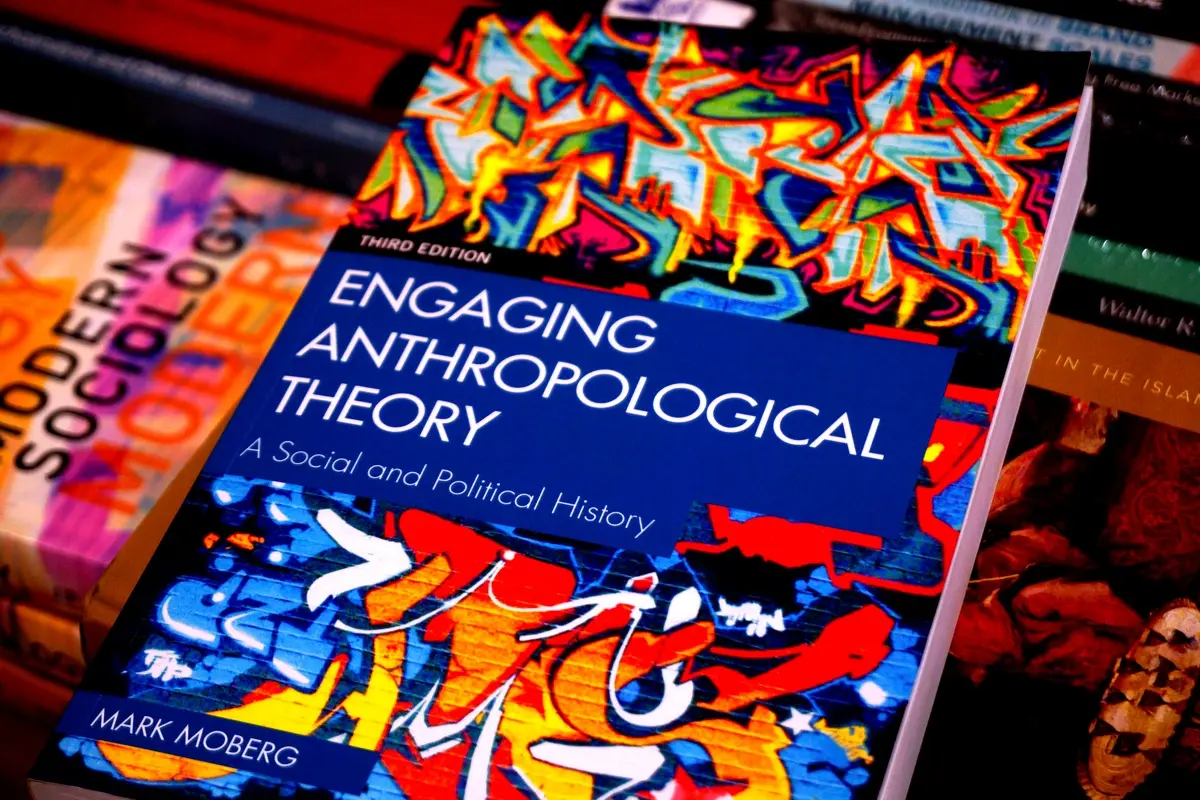
- Kasaï Occidental : Très souvent nous perdons nos repères culturels avec les autres, surtout devant les Kinois. Comme exemple quand je suis à Kinshasa, je me sens obligé de parler le français comme je ne maîtrise pas le lingala de peur que les Kinois ne se moquent de moi. Ici à Kinshasa nous sommes obligés de manger à la maison, ce qui n’est pas le cas chez nous. Quand je vais à l’église à Kinshasa, tout le monde chante en Lingala que je ne maîtrise pas, je me sens dépaysé.
- Kasaï Oriental : Très souvent nous perdons nos repères et codes culturels par la rencontre avec d’autres et surtout avec les médias audiovisuels. Actuellement, les jeunes imitent les Kinois dans leur habillement, par exemple le port de maillot de corps, de pantalon et mini-jupe.
- Katanga : Souvent il nous arrive de constater que les Katangais perdent leurs repères culturels au profit des habitudes venant d’ailleurs, surtout de Kinshasa et du Kasaï, comme l’indécence dans l’accoutrement (porter des mini-jupes), le percing des oreilles en excès, le marché ambulant, l’impolitesse devant les aînés, …
- Kinshasa : Rarement nous perdons notre culture au détriment de celles des ressortissants d’autres provinces ; bien au contraire, ce sont eux qui perdent les leurs. A l’intérieur du pays, ils s’habillent décemment, mais quand ils arrivent à Kinshasa, ils préfèrent se comporter comme des Kinois avec des habits collants et trop transparents. Ils cherchent à teinter leur peau en appliquant des laits de beauté éclaircissants. Malgré ces efforts, ils sont toujours villageois, ils ne deviendront jamais Kinois.
- Maniema : Très souvent il nous arrive de constater que chaque province a sa culture, mais certaines provinces ne savent pas valoriser les leurs. Comme exemple, après la guerre de Libération de l’année 1997, suite à l’arrivée des gens venant d’ailleurs (militaires et civils), les jeunes filles de notre province étaient emportées par leurs influences, par exemple elles ont commencé à porter des pantalons, des mini-jupes et à se prostituer.
- Nord-Kivu : Quelquefois il nous arrive de perdre nos repères culturels suite à la cohabitation avec les autres. Cette cohabitation nous a amenés à acquérir la culture de la violence importée, du reste, de la race nilotique. Selon cette culture, la vie humaine est semblable à celle de l’animal, la mort est vide.
- Province Orientale, Très souvent, dans notre province, on salue tout le monde sans distinction de sexe et sans arrière-pensée. Mais à Kinshasa, quand une femme a l’habitude de saluer un homme, ce dernier a tendance à croire qu’elle est tombe amoureuse de lui. En outre, un étranger chez nous est considéré comme quelqu’un qui est devenu inconscient, mais civilisé chez nous traduit en swahili : « mushenzi kavaangaa kandja kwetu, kasilimuka ».
- Sud-Kivu : Très souvent, nous n’adoptons pas les habitudes d’ailleurs. Bien au contraire, ce sont les venants qui nous imitent, par exemple le refus de manger les chenilles ou d’accepter que la famille étrangère, kasaïenne par exemple, prenne en charge notre fille engrossée. (codes culturels des Kasaïens).
Toutes ces données sont analysées en termes d’éléments communicationnels (généralisés et contextuels) dans le paragraphe qui suit en fonction de « tableau panoramique de dépouillement » (voir le tableau n°08) et de la « grille d’analyse » (voir tableau n°09).
- Analyse des éléments communicationnels (généralisés et contextuels)
Il nous importe ici de dégager les éléments de la communication généralisée et de la contextualité situationnelle à partir des discours (réactions) des sujets enquêtés décrits ci-haut. Le tableau panoramique n°28 résume les éléments de cette analyse.
Tableau n°28 : Tableau panoramique du mécanisme de déroutinisation
| Tableau n°28 : Tableau panoramique du mécanisme de déroutinisation | |
|---|---|
| Province | Fréquence de déroutinisation |
| Bandundu | Jamais |
| Bas-Congo | Souvent |
| Equateur | Très souvent |
| Kasaï Occidental | Très souvent |
| Kasaï Oriental | Très souvent |
| Katanga | Souvent |
| Kinshasa | Rarement |
| Maniema | Très souvent |
| Nord-Kivu | Quelquefois |
| Province Orientale | Très souvent |
| Sud-Kivu | Très souvent |
Le tableau n°28 révèle les éléments pertinents ci-après :
- six provinces ne pratiquent pas la « déroutinisation » (soit 55 %), il s’agit de : Bas-Congo, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga et Maniema. Ces provinces développent des valeurs positives à l’égard des autres culturels, notamment : le sentiment d’acceptation, la confiance et l’altruisme.
- cinq provinces pratiquent ce mécanisme (soit 45 %), il s’agit de : Bandundu, Kinshasa, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu. Ces provinces développent des valeurs négatives vis-à-vis des autres culturels, comme le sentiment de rejet, de méfiance et la tendance égocentrique.
________________________
455 Données recueillies lors des entretiens avec les étudiants des premières années de graduat (A et B) de l’IFASIC », du 09 au 30 avril 2013. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment la cohabitation avec d’autres provinces affecte-t-elle la culture au Congo?
Les enquêtes montrent que la cohabitation avec des ressortissants d’autres provinces peut entraîner une perte de repères et de codes culturels, comme observé chez les Bakongo et les habitants de l’Équateur.
Quels changements culturels sont observés chez les jeunes au Congo?
Les jeunes au Congo imitent souvent les Kinois dans leur habillement, adoptant des styles vestimentaires indécents comme le port de maillots de corps et de mini-jupes.
Pourquoi certains Congolais se sentent-ils dépaysés à Kinshasa?
Certains Congolais se sentent dépaysés à Kinshasa en raison de la nécessité de s’adapter à des codes culturels différents, comme parler le français ou chanter en Lingala, qu’ils ne maîtrisent pas.