Les défis et solutions identitaires sont au cœur de l’œuvre de Leïla Sebbar, révélant comment la religion façonne notre identité. Cette recherche met en lumière des contradictions fascinantes entre culture et appartenance, offrant des perspectives nouvelles sur la quête identitaire dans un contexte d’exil.
La religion élément primordiale
La religion occupe une part plus au moins importante dans la construction de notre identité. Il existe un rapport entre la culture et la religion. La notion de culture est déterminée par un ensemble de rites qui se pratiquent au nom d’une appartenance religieuse. L’identité religieuse est constructive d’une identité propre à chaque personne.
Beaucoup d’écrivains maghrébins dans leurs écrits évoquent leurs religions, soit à travers les croyances, les rites, les coutumes et aussi les expressions religieuses que l’écrivain introduit dans l’ensemble de ses écrits, sans oublier les fêtes et les cérémonies religieuses qui laissent apparaitre une part de son identité à travers sa religion.
Notre projet pose un problème identitaire et aussi religieux. Leïla Sebbar dans son roman : Je ne parle pas la langue de mon père, cite les femmes voilées, le prophète, le Ramadan, la prière, le Coran, le pèlerinage à la Mecque, l’église, la circoncision des garçons… Dans notre présent travail, notre romancière dans son roman de caractère autobiographique Je ne parle pas la langue de mon père, évoque qu’elle a été élevée dans la maison de l’école où se présente deux religions : l’Islam ; la religion de son père et de ses ancêtres du côté paternel et le christianisme ; la religion de sa mère et de ses ancêtres du côté maternel. Elle n’arrive pas à s’identifier en matière de la religion.
Dans la maison d’école Dieu est absent, il n’existe pas dans la vie de notre romancière, dans la bibliothèque familiale il n’y avait rien, ni Coran ni Bible. Dieu ne cohabite pas la maison d’école, elle déclare : « Analphabète en Dieu, en religion, rites et dogmes, je ne savais rien de la ferveur de ces femmes en blanc, ni de la ferveur de la mère et des sœurs de mon père. ».54
Elle rajoute dans un autre extrait qu’elle n’avait pas des relations avec les enfants chrétiens qui suivent des cours de catéchisme par les sœurs : « nous ne parlions pas de la vie de Jésus. Je ne suis jamais entrée dans l’église du village. Je trouvais jolies les petites filles de ma classe en communiantes, je ne les enviais pas, je n’ai pas mangé à leur table après la cérémonie, on ne m’invite pas. » 55 . Cet extrait vient de perfectionner l’absence de Dieu dans sa vie, son déchirement et son trouble identitaire.
Le père de Leïla explique bel et bien son attachement à l’Islam et à sa culture surtout dans le domaine religieux, mais il n’a jamais parlé de l’Islam et de prophète dans la maison notamment avec ses enfants. Ses enfants ne croient ni à Dieu ni au Christ. Ils sont peut-être athées.
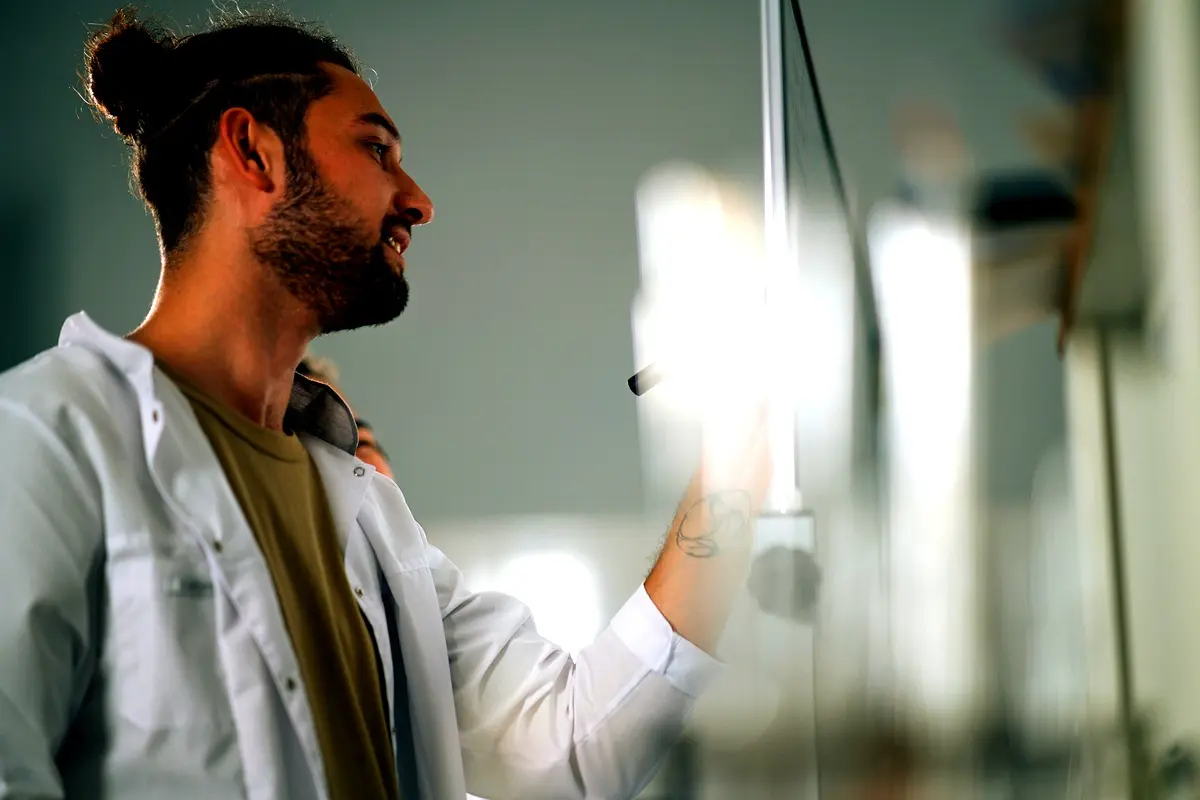
Le père et la mère de Leïla sont des instituteurs à l’école laïc, dans leur maison Dieu est écarté, il n’y avait aucune parole de Dieu parce que ces parents ont eu la pudeur de ne pas exiger la religion. Leïla lit tout le temps, dans les livres que ses parents l’offrent, dans ses livres rien ne manque, la vie, l’amour, les légendes d’Athènes, les sciences, les lettres, la France.
L’Algérie n’existe pas, il n’y avait pas de contes arabes, berbères et les Mille et une nuit. Dieu et la vie du prophète Mahomet sont négligés, et encore pas de saint et de sainte de l’histoire chrétienne. Notre protagoniste a vécu une vie très douloureuse, elle est séparée de tout : de l’arabe la langue du Coran, de sa culture d’origine, et même de Dieu, elle dit : « Dieu ne me regarde pas, je ne l’entends pas, je ne lui parle pas.
Qui m’aurait appris ? (…) ce que je ne le connais pas ne manque pas.»56Donc dans la maison de Leïla, la langue arabe et la religion sont étrangères, c’est le silence de la langue et le déracinement qui ont poussé l’écrivaine de publier ce roman autobiographique.
Leïla reçoit les ordres de la morale laïque et républicaine. Elle a le comportement des musulmans mais elle n’ jamais suivait les devoirs et les principes de la religion quel que soit islamique ou bien chrétienne. Elle écoute les cloches de l’église, le chant du muezzin ses appels à la prière, mais elle n’a jamais possédés questions et elle n’a jamais cherché la signification de ses voix étrange pour elle parce que Dieu n’existe pas dans sa vie:
« Je suis une fille modèle, obéissante, serviable, modeste. Je ne vole pas je, je suis sage mais je ne crains pas Dieu, je ne prie pas Dieu. C’est que la prière ? Je l’ignore encore. Je ne suis pas menteuse, je ne fais pas de colère, j’ai pitié les enfants pauvres, il y en a beaucoup dans l’Algérie coloniale. »57
Dans le passage suivant, l’écrivaine parle de l’islamité de son père et son respect à sa religion. Son père était comme tous les musulmans arabes, il croit à Dieu, il fait la prière, son nom déjà le qualifie, Sebbar qui signifie le patient, le quatre-vingt-dix-neuvième nom d’Allah. Il a visité le lieu saint de la Mecque pour faire le pèlerinage qui est le cinquième pilier de l’Islam.
Elle rajoute que son père raconte au fils de Fatima plus qu’à sa femme et à ses enfants, malgré que le fils de Fatima voulait le tuer sous prétexte qu’il est communiste, ne croyant pas en Dieu ! Leïla cite l’histoire de la servante Agar et son fils Ismaël. Le père lui raconte l’histoire de la pierre d’Abraham qui existe au pays de la Mecque. « Il existe, paraît-il, au pays de la Mecque, une pierre d’Abraham, avec l’empreinte de ses pieds et de ses orteils. Les pèlerins répandent l’eau du Zemzem, le puits de la servante Agar, tu la connais, nous la connaissons, nous, les musulmans… »58
Les Arabes qui sont exilés en France et malgré leur distance de leur pays d’origine, leur fréquentation des gens qui appartiennent à d’autre religion et qui croient à un autre Dieu. Ils ont protégé et gardé leur Islam qui identifie leur appartenance religieuse. Le fils de Fatima était aussi exilé, il a appris la langue arabe et le Coran en France, au pays de l’ennemi : « Il a suivi des cours intensifs, dans une autre école, dans la langue de sa mère, qu’il ne reconnaît pas tout à fait. Il est heureux, il apprend vite, il lit le Coran, il ne rate pas une heure d’enseignement religieux »59
Dans un autre passage, le père de Leïla raconte au fils de Fatima l’histoire de la gandoura exposée dans un musée à Lyon, lorsqu’il fait son premier voyage en France avec des jeunes maîtres indigènes où ils ont visité presque toutes les grandes villes de France :
« Gandoura de Mohammed … On était sidéré, dans un musée français, la gandoura du Prophète…On l’a regardée longtemps, avec beaucoup de respect, c’était un objet sacré, bien sûr, pas une relique, et nous n’étions pas des idolâtres… »60
________________________
54 SEBBAR, Leïla, L’Arabe comme un chant secret, Paris, Bleu autour, 2007, p.173 ↑
58 SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père. Paris, Julliard, 2003, p.120 ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels défis identitaires Leïla Sebbar aborde-t-elle dans son roman ?
Leïla Sebbar aborde des défis identitaires liés à la double appartenance culturelle et linguistique, ainsi qu’à la séparation de la langue arabe et de sa culture d’origine.
Comment la religion influence-t-elle l’identité dans l’œuvre de Sebbar ?
La religion joue un rôle primordial dans la construction de l’identité, mais dans le roman, Leïla Sebbar évoque une absence de Dieu et de pratiques religieuses dans sa vie, ce qui contribue à son déracinement identitaire.
Quelle est la quête identitaire de Leïla Sebbar dans ‘Je ne parle pas la langue de mon père’ ?
La quête identitaire de Leïla Sebbar se manifeste par son tiraillement entre les cultures française et algérienne, ainsi que par son rapport complexe à la langue et à la religion.