Les défis de la photographie documentaire révèlent des vérités cachées sur l’occupation américaine d’Haïti (1915-1920). Cette étude met en lumière comment les images, au-delà de leur fonction initiale, façonnent notre compréhension des dynamiques sociopolitiques de l’époque.
CADRE CONCEPTUEL – Approches sémiologiques
- Le concept de « sémiologie »
Le terme sémiologie peut être défini en première approche comme la théorie ou la science des signes86. Les vocables de « sémiologie » et de « sémiotique » sont souvent aujourd’hui employés indifféremment dans un grand nombre de situation. Toutefois, en janvier 1969, le comité
85 (Charles – Olivier Carbonelle 1981, p 5)
86 (“Approche Sémiologique – Approche_semiologique.pdf” 2015)
international qui a fondé l’ « Association internationale de sémiotique» a accepté le terme de
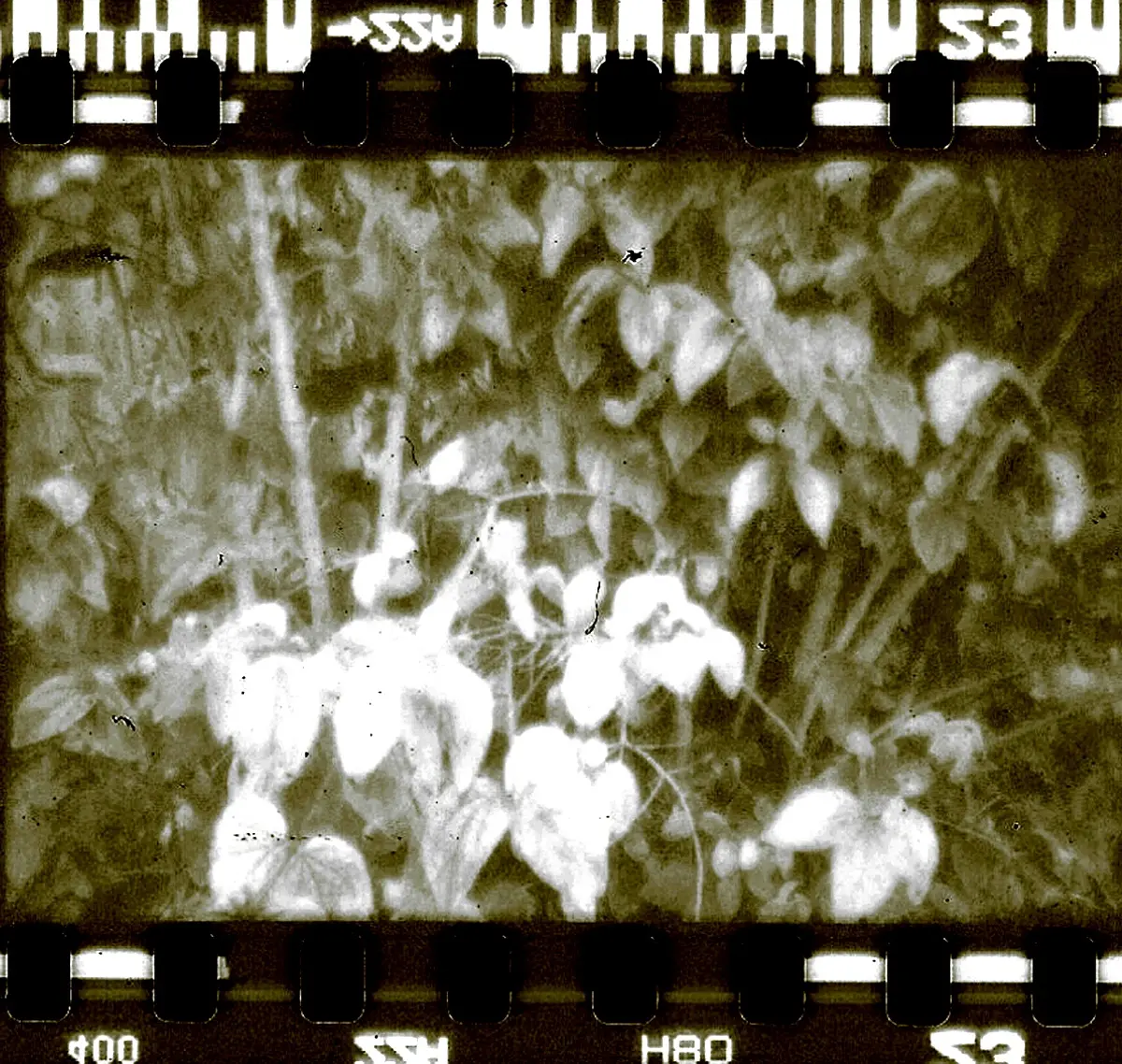
« sémiotique » comme celui recouvrant toutes les acceptations de ces deux vocables. En France, le terme de «sémiotique» est le plus souvent employé dans le sens de «sémiotique générale», alors que l’emploi du terme «sémiologie» renvoie tout à la fois à des sémiotiques spécifiques (par exemple, la sémiologie de l’image envisagée comme théorie de la signification de l’image) et à leurs applications pratiques 87.
Comme je l’utilise dans cette recherche, je mets l’accent sur l’approche sémiologique de l’analyse des images comme documents non-écrits. En outre, je construis un discours sémiotique pour dégager la compréhension tout en voyant la signification des images photographiques durant l’occupation états-unienne d’Haïti (1915 – 1934). Entre autre, les différentes connotations du terme renvoient à des traditions scientifiques différentes.
Bien que la réflexion sur les signes et la signification a été envisagée à différentes époques de l’histoire, on peut considérer que l’apparition de la sémiologie moderne remonte à la période couvrant la fin du siècle passé et le début de celui-ci avec les travaux, menés indépendamment, de Ferdinand de Saussure à Genève et de Charles Sanders Peirce en Amérique.
Pour le philosophe et scientifique américain Charles Sanders Peirce (1839-1914), la sémiotique est un autre nom de la logique: «la doctrine formelle des signes». On peut dire très schématiquement que son projet a consisté à décrire de manière formelle les mécanismes de production de la signification et à établir une classification des signes.
Le philosophe n’a pas écrit d’ouvrage spécifique sur ce sujet. Sa pensée nous est donnée par une multitude de textes (articles, lettres, conférences) rédigés à différentes époques (dès 1867) qui n’ont été rassemblés et publiés qu’à partir de 1931. C. S. Peirce liait la sémiotique au domaine de la logique dont il avait contribué au développement (méthode des tables de vérité du calcul des propositions notamment).
Dans cette perspective, la sémiotique peut être définie comme la théorie générale des signes et de leur articulation dans la pensée. En effet, selon l’approche de C. S. Peirce, la sémiotique est envisagée comme une philosophie de la représentation 88. Mais Pierce envisage aussi le signe comme élément d’un processus de communication, au sens non de «transmettre» mais de «mettre en relation»89.
Pour Charles Morris (logicien et philosophe américain), dont les recherches prolongent celles de Peirce, la sémiotique
87 (la sémiologie de l’image comme analyse de documents utilisant les moyens de la sémiotique)(“Approche Sémiologique – Approche_semiologique.pdf” 2015)
88 (« Approche_semiologique.pdf” 2015, p 4)
89 (“Approche_semiologique.pdf” 2015, même page)
est à la fois une science parmi les ciences (la science des signes) et un instrument de celles-ci. Car ce qu’étudient les sciences expérimentales et humaines, ce sont les phénomènes en tant qu’ils signifient, soit des signes. Chaque science se sert des signes et exprime ses résultats au moyen de ceux-ci. C. Morris envisage la sémiotique comme une métascience, qui aurait comme champ de recherche l’étude de la science par l’étude du langage de la science.
En Europe, le terme «sémiologie» se rattache à la tradition du linguiste genevois Ferdinand de Saussure (1857-1913) qui en a indiqué le champ possible au début du siècle dans son cours de linguistique générale90. La sémiologie prend donc son origine dans la linguistique qui, pour F. de Saussure, devait à terme être intégrée dans la science dont il donnait le programme: «étude de la vie des signes au sein de la vie sociale».
Cette science générale des signes avait vocation à porter sur les systèmes signifiants verbaux et non verbaux et devait constituer une théorie scientifique de la signification. En linguistique, F. de Saussure rompt avec la tradition diachronique de l’étude de la langue pour la considérer dans une approche synchronique comme un système.
Il oppose la langue (le modèle) à la parole (le phénomène). La langue est envisagée alors comme un ensemble de conventions dont le sujet parlant fait usage pour communiquer avec ses semblables par la parole. Il conçoit la langue comme un système autonome structuré constitué d’un ensemble de relations susceptibles d’être décrites de manière abstraite et dont les éléments n’ont aucune réalité indépendamment de leur relation à la totalité.
En étudiant la langue, F. de Saussure fonde la méthodologie «structuraliste» qui sera appliquée par la suite à d’autres types de faits culturels et sociaux que les faits de langue. Le terme «sémiologie» renvoie donc à toute une tradition européenne active dans le champ des sciences humaines et sociales.
Sous l’impulsion de Roland Barthes (1915-1980), la recherche en sémiologie a connu en France un développement important dès le milieu des années soixante dans le domaine des lettres. Les recherches sémiologiques relatives au cinéma ont, en particulier, connu un essor considérable avec les travaux de Christian Metz. R. Barthes a, très tôt, su reconnaître l’importance de l’étude des communications de masse.
Il a notamment développé ses recherches dans deux directions: il a, d’une part, engagé dès la fin des années cinquante une analyse critique portant sur le «langage» de la culture de masse en considérant les représentations collectives à l’œuvre dans les pratiques sociales comme des systèmes signifiants. Il étudiera notamment la mode comme système à partir de textes parus dans la presse.
En 1964, un important numéro de la revue Communications
90 (“Approche Sémiologique – Approche_semiologique.pdf” 2015, p 5)
contribuera à diffuser l’intérêt pour les recherches sémiologiques. R. Barthes a, d’autre part, œuvré à l’élargissement du champ de la linguistique (limité historiquement à la phrase) à l’étude des grands types de productions textuelles: sémiotique discursive (du discours), et en particulier sémiotique narrative (du récit)91.
On voit que R. Barthes, en mettant en œuvre le programme dont F. de Saussure n’avait fait que poser le principe, s’inscrit en continuateur de l’œuvre de celui-ci. C’est ainsi que, dans cette conception, la sémiologie apparaît comme une science qui vise à comprendre la manière dont s’élabore la signification. Ce champ d’étude concerne la totalité des productions sociales (objets de consommations, modes, rituels, etc.), en particulier celles qui sont véhiculées par les systèmes de communication de masse. Dans cette perspective, l’homme est considéré dans son environnement social et non comme un simple émetteur ou récepteur coupé du monde. Cependant,
R. Barthes, à la différence de Saussure, réaffirme le primat de la langue et considère que la sémiologie doit être dans la dépendance de la linguistique. La démarche représentée par les recherches de R. Barthes, qui a été nommée par certains «sémiologie de la signification», dépasse de beaucoup une autre approche sémiologique, représentée par les travaux de E.
Buyssens, G. Mounin et L.-J. Prieto, appelée «sémiologie de la communication». En effet, ces chercheurs limitent leurs investigations aux phénomènes qui relèvent de la «communication», qu’ils définissent comme un processus volontaire de transmission d’informations au moyen d’un système explicite de conventions (c’est-à-dire un code)… On peut donc considérer que les héritiers de F.
de Saussure se divisent schématiquement en deux groupes: le premier, d’orientation restrictive («sémiologie de la communication»), ne s’applique qu’à analyser certains faits culturels, alors que le second, d’orientation extensive, vise à décrire et expliciter les phénomènes relatifs à la circulation de l’information dans les sociétés humaines. Cette deuxième approche, plus souple, qui prend en considération des systèmes de conventions interprétatives ouverts, nous semble mieux à même de rendre compte des phénomènes de communication complexes à l’œuvre dans la communication en général, et visuelle en particulier.
Mais cette vision n’est pas propre à R. Barthes et aux chercheurs travaillant en France. Dès les années soixante, des chercheurs américains et européens d’horizons divers (anthropologie, sociologie, psychologie) qui travaillaient sur les interactions entre humains ont cherché à intégrer dans leurs recherches toutes les modalités de
91 (“Approche_semiologique.pdf” 2015, p 5-6)
communications structurées, et pas seulement les actes de communication verbaux, conscients et volontaires92.
On peut noter que tant l’approche de F. de Saussure que celle de C. S. Peirce excluent de leur champ d’étude les processus de communication constitués par le simple passage de signaux entre un émetteur et un récepteur de même que les cas qui impliquent une relation entre deux pôles de type stimulus-réponse sans élément médiateur (le signifié ou interprétant).
________________________
86 (“Approche Sémiologique – Approche_semiologique.pdf” 2015) ↑
91 (“Approche_semiologique.pdf” 2015, p 5-6) ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la sémiologie dans le contexte de la photographie documentaire?
Le terme sémiologie peut être défini comme la théorie ou la science des signes, et dans cette recherche, il est utilisé pour analyser les images comme documents non-écrits.
Qui sont les principaux théoriciens associés à la sémiologie?
Les principaux théoriciens associés à la sémiologie incluent Ferdinand de Saussure et Charles Sanders Peirce, qui ont contribué à la compréhension des signes et de leur signification.
Comment la sémiologie aide-t-elle à comprendre les photographies de l’occupation américaine d’Haïti?
L’analyse sémiologique permet de dégager la compréhension des images photographiques durant l’occupation états-unienne d’Haïti en examinant les connotations et les significations des signes présents dans les photographies.