Les défis et solutions en communication interculturelle au Congo révèlent des mécanismes de défense socioculturelle souvent méconnus. Cette recherche innovante, alliant psychologie et méthodologie mixte, promet de transformer notre compréhension des dynamiques communicatives dans un contexte riche et complexe.
- Facteurs sociologiques de l’acteur social
Pour décrire la variable sociale, nous allons nous appuyer sur la théorie de champ de Pierre Bourdieu235. Selon cette théorie, le monde social dans les sociétés modernes est constitué de structures qui sont certes construites par les agents sociaux, mais qui, une fois constituées, conditionnent à leur tour l’action de ces agents. Trois niveaux d’analyse peuvent être opérés à ce sujet : le statut et le rôle sociaux, l’ethnie et la province d’origine, et la nationalité.
230GALTON, F, Inquiries into Human Faculty and Its Development, London, J.M. Dent & Company, 1883, pp. 1- 387.
231REUCHLIN, M., op.cit, p. 165.
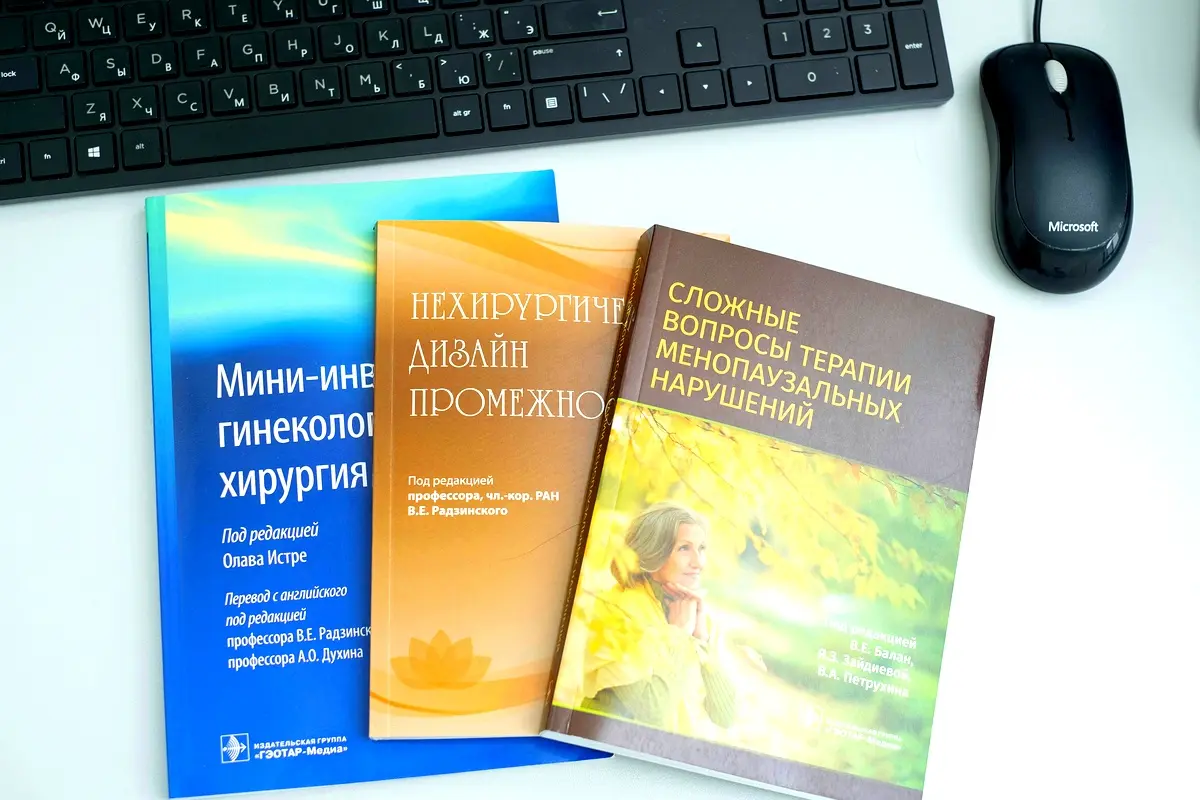
232CATTELL, R. B., The Scientific Analysis of Personality, London, Penguin, 1965, pp. 1-55.
233YUNG, C.G., Types psychologiques, Genève, Georg, 1986, pp. 1-456.
234EYSENCK, H.J., “Dimensions of personality: Criteria for a taxonomic paradigm”, in Pers Individ Dif, n°12, 1991, pp. 773-790.
235WACQUANT, L., « Pierre Bourdieu », in STONES, R. (ed.), Key Contemporary Thinkers, London, Macmillan, 2006, pp. 1-17.
- Statut et rôle de l’acteur social
Dans son ouvrage intitulé Le fondement culturel de la personnalité, Ralph Linton236 définit le rôle comme étant l’ensemble des modèles culturels associés à un statut donné. Il englobe par conséquent les attitudes, les valeurs et les comportements que la société assigne à une personne et à toutes les personnes qui occupent ce statut.
Aussi peut-on relever qu’un individu a généralement plusieurs statuts et joue plusieurs rôles. Le statut correspond à la place, relativement stable, qu’un individu occupe dans la société et le rôle aux actions attachées à ce statut : avoir le statut de parent et jouer son rôle de parent. Ainsi donc, la place qu’un individu donné occupe dans un système donné à un moment donné sera nommée son statut par rapport à ce système.
De son coté, Jean Stoetzel237 définit le statut et le rôle dans l’interaction entre l’individu et les autres comme suit : pour un individu, son statut est l’ensemble des comportements à quoi il peut s’attendre légitimement de la part des autres et son rôle l’ensemble des comportements auxquels les autres s’attendent légitimement de sa part. Cette définition rejoint l’idée essentielle que nous tirons de l’ouvrage d’Anne-Marie Rocheblave-Spenle238 intitulé La notion de rôle en psychologie sociale : le rôle est comme un modèle organisé de conduites, relatif à une certaine position de l’individu dans un ensemble interactionnel.
Jean Maisonneuve239 montre que le rôle a une «fonction de régulation des rapports sociaux» puisqu’il :
- correspond à un état du système social organisé en statuts,
- ajuste les relations sociales par le «jeu » que permettent les rôles assignés aux individus ;
- identifie les conflits (de rôles) ou les indices d’autres conflits.
Jean-Louis Moreno240 a montré comment l’on pouvait en rejouant des rôles sociaux, dénouer des conflits personnels (psychodrame) et groupaux (sociodrame). C’est dans cette même perspective que Didier Anzieu et Jacques-Yves Martin241 ont confirmé la thèse de Guillaumin selon laquelle la notion de rôle correspond à une auto-régulation active du sujet en fonction de l’objet partenaire, considéré comme source de certaines résistances ou ripostes. Or, c’est précisément ce que nous trouvons dans l’attitude. Ainsi, dans l’attitude comme dans le rôle, nous avons affaire avec une séquence comportementale, organisée selon un certain pattern en fonction d’un objet présentant des caractéristiques déterminées pour le sujet. En parlant de rôle,
236LINTON, R. cité par LÉVY, A., Psychologie sociale, Paris, Dunod, 1970, p. 330.
237STOETZEL, J., Psychologie sociale, Paris, Flammarion, 1978, p. 206.
238ROCHEBLAVE-SPENLE, A.-M., La notion de rôle en psychologie sociale, Paris, PUF, 1962, pp. 1-434
239MAISONNEUVE, J., Introduction à la psychosociologie, Paris, PUF, 2006, pp. 1-328.
240MORENO, J.-L., Psychothérapie de groupe et psychodrame, Paris, PUF, 1987, pp. 1-125.
241ANZIEU, D. et MARTIN, J.-Y., Psychologie des groupes restreints, Paris, PUF, 1968, p. 201.
on met de façon un peu plus marquée l’accent sur l’interaction et la réciprocité des processus attitudinaux.
De toutes ces considérations, on peut retenir que le statut est la place occupée à un moment donné par un individu dans le système social. Compte tenu de son statut, un individu accomplit des rôles, attendus et définis par le type de statut considéré. En fait, c’est la représentation de son statut qui déterminera la représentation des rôles qu’un individu estime devoir tenir, et c’est la représentation que les autres se font de son statut qui déterminera leur attente de rôles.
L’une des caractéristiques des rôles sociaux est leur rigidité, qui génère de nombreux obstacles en communication. On a constaté par exemple avec Pierre Bourdieu242 dans sa « théorie de l’habitus culturel », certains modèles nous sont déjà imposés par la société, lesquels modèles brodent nos comportements.
Pour l’auteur, il existe des dispositions qui sont à l’origine des pratiques ou des actions des individus, ce qu’il appelle habitus. Ce dernier désigne en effet un ensemble de dispositions, schèmes d’action ou de perception que l’individu acquiert à travers son expérience sociale. Par sa socialisation, puis sa trajectoire sociale, tout individu incorpore lentement un ensemble de manières de penser, de sentir et d’agir, qui se révèlent durables. Elles sont des schèmes de perception et d’action qui permettent à l’individu de produire un ensemble de pratiques nouvelles adaptées au monde social où il se trouve. Cinq caractéristiques peuvent être retenues à ce sujet :
- primo, un agent qui a été socialisé dans un certain monde social, en conserve, dans une
large mesure, les dispositions, même si elles sont devenues inadaptées à la suite (hystérésis) ;
- secundo, l’habitus est puissamment générateur, puisqu’il est à l’origine du sens pratique,
de l’unité de pensées et d’action de chaque individu ;
- tertio, les dispositions acquises dans une certaine activité sociale, notamment au sein de la famille, sont transposées dans une autre activité, tel le monde professionnel (transposable) ;
- quarto, l’habitus étant le reflet d’un monde social, il lui est adapté et permet aux agents,
sans que ceux-ci aient besoin d’entreprendre une réflexion « tactique » consciente, de répondre immédiatement et sans même y réfléchir aux évènements auxquels ils font face (sens pratique) ;
- quinto, chaque espace social propose en effet aux agents un enjeu spécifique fondé sur
la croyance et l’intérêt. Ce phénomène, est appelé Illusio acquise par socialisation.
Dans son analyse sur les « mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales », le même auteur insiste sur l’importance des facteurs culturels et symboliques dans cette reproduction et critique le primat donné aux facteurs économiques dans les conceptions
242BOURDIEU, P., La reproduction, Paris, Minuit, 1970, pp. 1-279.
marxistes. Il entend souligner que la capacité des agents en position de domination à imposer leurs productions culturelles et symboliques joue un rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domination.
De son coté, Nathalie Rigaux243 voit dans l’habitus deux caractéristiques, le principe générateur et le système de classement, qui conditionnent à la fois l’action et la perception des acteurs sociaux. Par rapport au « principe générateur », l’habitus s’acquiert par une forme d’apprentissage essentiellement non conscient, un apprentissage par corps. Il est l’intériorisation des possibilités propres à notre constitution objective (notre accès aux capitaux) qui se fait par accumulation d’expériences.
Ce qui marque ainsi le corps permet de générer des pratiques dans des contextes nouveaux. Il crée des dispositions transposables à tous les domaines de la pratique. Pour ce qui est du « système de classement », l’habitus est un système de schèmes de perception et d’appréciation, qualifié communément de « goût ».
Le goût fonctionne comme une disposition à différencier, à apprécier et par là même, à transformer les « choses en signes distincts et distinctifs ». Il opère comme un sens d’orientation sociale qui oriente vers les positions sociales les plus proches qui font qu’on parle de couples
« bien assortis », d’amis qui ont le même goût.
Enfin, nous percevons le monde à travers le filtre de notre habitus. C’est par cette médiation que le monde nous apparaît. Cette perception est dès lors marquée par notre position sociale, telle que nous l’avons incorporée (par l’habitus). Nous avons donc, d’une part, les modes de perception associés aux habitus de chaque position (spécifiques) et, d’autre part, les modes qui sont communs à tous. Cette différence s’observe au niveau de notre façon de voir le monde, de lui donner du sens et de nous communiquer avec les autres.
________________________
235 WACQUANT, L., « Pierre Bourdieu », in STONES, R. (ed.), Key Contemporary Thinkers, London, Macmillan, 2006, pp. 1-17. ↑
236 LINTON, R. cité par LÉVY, A., Psychologie sociale, Paris, Dunod, 1970, p. 330. ↑
237 STOETZEL, J., Psychologie sociale, Paris, Flammarion, 1978, p. 206. ↑
238 ROCHEBLAVE-SPENLE, A.-M., La notion de rôle en psychologie sociale, Paris, PUF, 1962, pp. 1-434. ↑
239 MAISONNEUVE, J., Introduction à la psychosociologie, Paris, PUF, 2006, pp. 1-328. ↑
240 MORENO, J.-L., Psychothérapie de groupe et psychodrame, Paris, PUF, 1987, pp. 1-125. ↑
241 ANZIEU, D. et MARTIN, J.-Y., Psychologie des groupes restreints, Paris, PUF, 1968, p. 201. ↑
242 BOURDIEU, P., La reproduction, Paris, Minuit, 1970, pp. 1-279. ↑
243 RIGAU, N., Habitus et pratiques sociales, Paris, PUF, 2000. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les facteurs sociologiques influençant la communication interculturelle au Congo ?
Les facteurs sociologiques incluent le statut et le rôle sociaux, l’ethnie et la province d’origine, ainsi que la nationalité.
Comment le statut et le rôle social affectent-ils la communication ?
Le statut correspond à la place qu’un individu occupe dans la société, tandis que le rôle englobe les actions et comportements associés à ce statut, influençant ainsi les attentes dans les interactions sociales.
Quelle est l’importance de la théorie de champ de Pierre Bourdieu dans l’analyse de la communication ?
La théorie de champ de Pierre Bourdieu permet de comprendre comment les structures sociales construites par les agents conditionnent leurs actions, ce qui est essentiel pour analyser la communication interculturelle.