Les défis de l’emprunt linguistique révèlent comment le français, langue véhiculaire au sein des résidences universitaires de Constantine, façonne les interactions culturelles. Cette étude met en lumière l’importance cruciale de cette langue dans un contexte de diversité, transformant ainsi notre compréhension des dynamiques linguistiques contemporaines.
L’emprunt
Toutes les langues du monde sont en situation de contact de langues. Cela explique le fait qu’aucune langue ne peut échapper au phénomène de l’emprunt. Ce dernier est définit par le dictionnaire de linguistique comme : « Il y a emprunt linguistique quand un parler A utilisé et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un parler B (dit langue source) et que A ne possédait pas ; l’unité ou le trait emprunté sont eux-mêmes qualifiés il ‘emprunts »31.
En effet lors de l’analyse de notre corpus oral, nous avons relevé quelques emprunts que nous allons classer comme suit :
- Emprunts à l’anglais ;
- Emprunts à l’arabe ;
- Emprunts à d’autres langues.
Emprunts à l’anglais
Dans l’extrait ci-dessous l’interactant I1 anglophone n’arrivant pas à trouver le bouton (rou- geur) en français l’emploie en anglais « rashes ». Dans ce même extrait nous notons également l’emploi des lexies « pimple » et « razor spot » pour désigner les boutons.
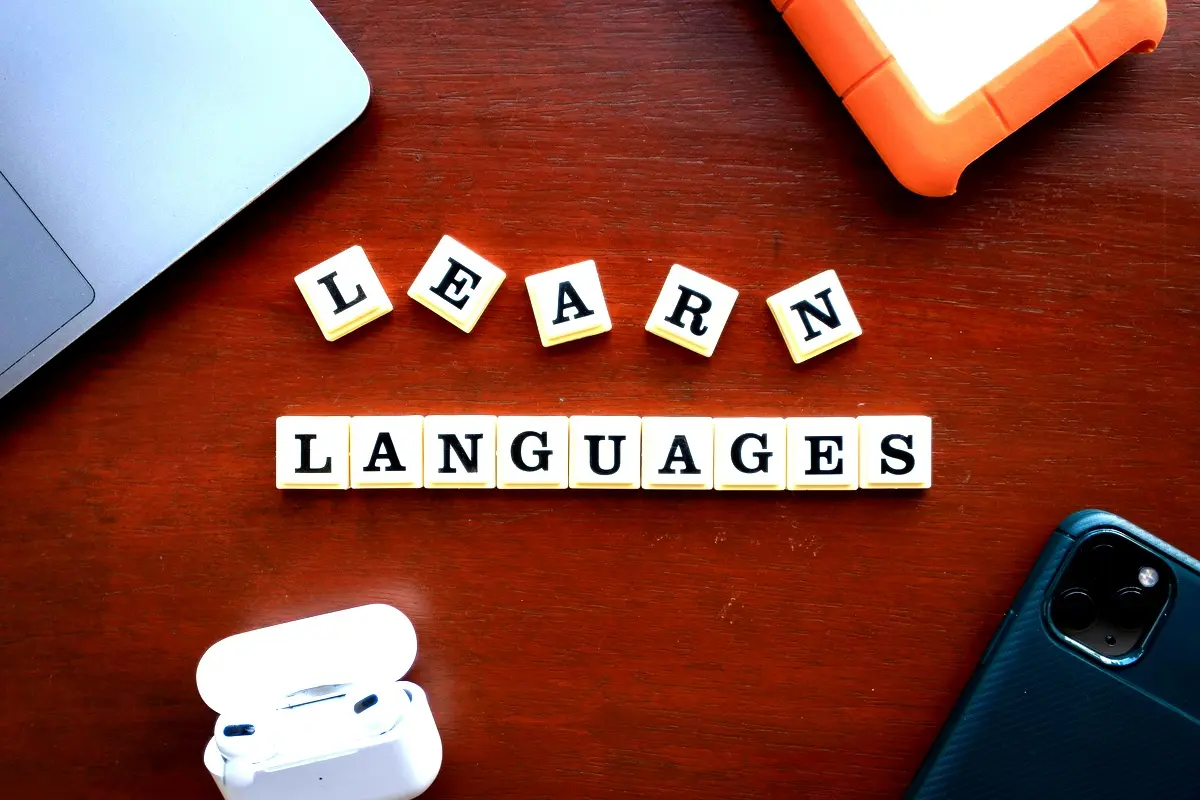
Extrait de l’enregistrement N°2 :
I1: normalement si c’est pas si c’est pas tranchant ça va te faire mal /./ et si il y’aura des xxx comment on appelle ça /./ des /./ [ rashes ] /./ he (de l’anglais)
I2: c’est quoi [ rashes ] (de l’anglais) encore
I1: je (ne) sais pas comment /
I2: les poils
I1: des /../ comme [ pimple /../ razor spot /../ ] (de l’anglais)
31 DUBOIS, J, 1994, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Larousse.
Extrait de l’enregistrement N°5 :
I2: c’est iPhone onze xxx n’est que ΄ a douze
I1 et I2: (rire)
I4: man (de l’anglais) /./ ça la /./ laisse ça comme ça <
I2: xxx (rire)
Dans l’extrait ci-dessus nous remarquons que l’interactant I4 recourt à l’utilisation de la lexie
« man » dont l’équivalent est « mec » ou « type » en français familier. Généralement en Afrique pour nommer leurs camarades, les jeunes utilisent couramment cette expression. Il s’agit donc là d’un emprunt spontané.
Observons l’intervention ci-dessous : Extrait de l’enregistrement N°5 :
I4: il fait comme ça /./ aujourd’hui /./ il filmé comme ça /./ il fait ça là /../ je le taqui- nais quoi ah mais toi tu (ne) t’habilles pas bien mais prouve que tu es avec moi oh :: je le taquinais /../ ah le gars a sorti iPhone avec trois oreilles ah j’ai vu ça (rire) y’a pas match
Dans cette intervention nous avons relevé un emprunt intégré. L’interactant I4 recourt à l’expression « match » qui est empruntée de la langue anglaise et qui littéralement veut dire
« compétition sportive ».
Emprunts à l’arabe
Nous relevons en premier lieu dans l’extrait ci-dessous l’interjection « wallah » qui sert de serment, cette lexie peut se définir littéralement comme le fait de jurer. Et elle est très fré- quente dans notre corpus.
Extrait de l’enregistrement N°6 :
I1: et si tu vois euh /./ xxx /./ on va aller sur le terrain
I2: [ wallah ] > (de l’arabe)
I1: oui
I2: euh où ça /../ vous allez partir dans quelle [ willaya ] (de l’arabe algérien)
Nous relevons dans le même extrait l’emploi de lexie « wilaya » un emprunt intégré et qui signifie une division administrative ou parfois willaya, ou un vilayet, est une division admi- nistrative qui existe dans plusieurs pays à majorité musulmane, c’est l’équivalent en français selon les Etats, des villes, des départements, des préfectures…
Extrait de l’enregistrement N°8 :
I1: [ hayya ] (de l’arabe ) (rire) tu viendras avec xxx quelqu’un va te déranger /./ tu tu sors avec ton marteau (rire)
Dans cette intervention nous relevons l’emprunt de la lexie « hayya » pour appeler à l’action ou à l’effort. Comme nous le voyons dans l’intervention ci-dessus l’interactant I1 subsaharien a recouru à cette expression.
Emprunts à d’autres langues
Tout d’abord l’emprunt de la lexie « tchalé » du twi (langue généralement parlée au Ghana) qui désigne littéralement « ami » ou « mec ». Dans cette intervention le locuteur ghanéen a utilisé ce terme pour nommer son interlocuteur.
Extrait de l’enregistrement N°2 :
I1: oui c’est là-bas /./ dans l’institut /…/ \ Oh [tchalé] /./ [ is not easy ] oh /./ [ is
xxx /../ xxx] (de l’anglais)
Ensuite l’emprunt très fréquent dans notre corpus de la lexie « wallay » du zarma ou songhaï (langues parlées au Niger et au Mali et dont l’une est la variété de l’autre). Cette lexie est aus- si à l’origine empruntée de la langue arabe dont l’équivalent est « wallah ». La lexie « wal- lay » sert également de serment (je jure). Nous proposons l’exemple suivant :
Extrait de l’enregistrement N°4 :
I1: [ wallay ] je (ne) sais /./ je (ne) sais pas
I3: t΄ as fait
I1: [ wallay ] j’ai presque fini même /./ je dois déposer ça le dix-sept (toux)
Extrait de l’enregistrement N°8 :
I2: (rire) [ wallay ] c’est bon /
I1: [ wallay ] il sait pas comment [ makanda ] aime la vie hein (rire) /../ [ makanda ] (rire) /…/ [ makanda ] euh ::::::: (rire) /
Nous tenons également à souligner l’emprunt de l’adverbe « lallé » toujours du zarma ou songhaï qui désigne littéralement en français « vraiment ». À titre d’exemple l’intervention suivante :
Extrait de l’enregistrement N°7 :
I1: (rire) [ lallé ] (vraiment) ça craint vraiment /./ ça craint grave >
Enfin l’emprunt à la langue haoussa (langue parlée généralement au Niger, au Nigéria, au Cameroun, au Tchad, au Ghana… et aussi qui sert de langue véhiculaire à tous ces pays).
Extrait de l’enregistrement N°6 :
I1: [wayo ] < (du haoussa) /../ moi je suis ici /
Dans cette intervention nous remarquons l’emploi de la lexie « wayo » qui est utilisée pour éprouver de l’émotion à l’égard de quelque chose.
Extrait de l’enregistrement N° :
I2: xxx j’étais / j’étais partie à la quincaillerie /./ j’ai dit au monsieur je veux un marteau /./ ΄ y’a une / tu vas faire quoi avec le marteau > /../ je l’ai bien regardé après il m’a parlé doucement < [ wallahi ] (du haoussa) < xxx
Dans cette intervention aussi l’emploi de la lexie « wallahi » empruntée également de l’arabe et qui équivaut en arabe à « wallah » (je jure). Au niveau de cet emprunt le sens est resté le même contrairement à la forme qui fut partiellement touchée.
La néologie
La néologie est également un phénomène résultant de celui de contact des langues et est source d’enrichissement des langues. L’ensemble de mots d’une langue donnée ne peut jamais être perçu comme clos. En effet les locuteurs d’une langue donnée font souvent recours à des créations des mots soit nouveaux ou à partir d’autres mots qui existent déjà dans une autre langue, gardent partiellement ou totalement la forme de ces mots, leurs sens.
C’est ce qui fait que les langues s’enrichissent et c’est dans cette optique que Bernard Quemada déclare « qu’une langue qui ne connaîtrait aucune forme de néologie serait déjà une langue morte, et l’on ne saurait contester que l’histoire de toutes nos langues n’est, en somme, que l’histoire de leur néologie.
» (Bernard Quemada, 1971, P 138).
Nous tenons à souligner que nous avons relevé très peu de néologie lors de l’analyse de notre corpus.
Extrait de l’enregistrement N°8 :
I1: [ wallay ] (du zarma et songhaï) il sait pas comment [ makanda ] aime la vie hein (rire) /../ [ makanda ] (rire) /…/ [ makanda ] euh ::::::: (rire) /
I3: (rire) comme les [ moudjs ] ( algériens) la qui se suicident < qui ont les problèmes
Dans la première intervention (celle d’I1), nous remarquons l’emploi du terme « makanda » à trois reprises et dans la seconde (I3) l’emploi de « moudjs », il s’agit de deux créations lexi- cales que nous avons observées quotidiennement chez notre public. Ces termes leurs servent de repère. Pour les subsahariens dans les résidences de l’université Salah Boubnider et en Al- gérie en général ces deux néologismes signifient :
- Est qualifié de « makanda » tout étranger subsaharien ;
- Et est qualifié de « moudj » tout algérien.
Pour le premier néologisme ils se sont inspirés d’une province de Kongo central en Répu- blique Démocratique du Congo. Il s’agit donc d’une néologie de forme.
Quant au second « moudj » ils se sont inspirés du mots « moudjahidine » terme de religion désignant une personne qui prend les armes au nom de l’Islam et qui fait le djihad (la guerre sainte qui défend la religion musulmane.)
________________________
31 DUBOIS, J, 1994, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Larousse. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les types d’emprunts linguistiques observés chez les étudiants subsahariens ?
Nous avons relevé des emprunts à l’anglais, à l’arabe et à d’autres langues.
Comment le français est-il perçu comme langue véhiculaire parmi les étudiants subsahariens ?
Le français est perçu comme un outil de communication essentiel dans un contexte de diversité culturelle.
Quels exemples d’emprunts à l’anglais sont mentionnés dans l’article ?
Des exemples incluent les lexies ‘rashes’, ‘pimple’ et ‘razor spot’ utilisées par les étudiants pour désigner les boutons.
