Section II : L’inorganisation de la circulation des décisions judiciaires nationales
Aucune disposition n’est consacrée dans le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires à la circulation des décisions judiciaires nationales et des actes authentiques lorsqu’ils ont appliqué le droit OHADA. Cette difficulté et l’insécurité juridique qu’elle engendre sont irritantes lorsqu’elles persistent dans un espace dont l’objectif affiché est l’intégration régionale.
Il faut se référer aux législations nationales pour connaître le régime juridique de circulation des jugements (Paragraphe 1) alors que pour l’instauration d’un véritable espace judiciaire, il faut nécessairement que l’OHADA organise la circulation des décisions de justice (Paragraphe 2).
Paragraphe I : L’absence de la libre circulation des décisions de justice au sein des Etats membres
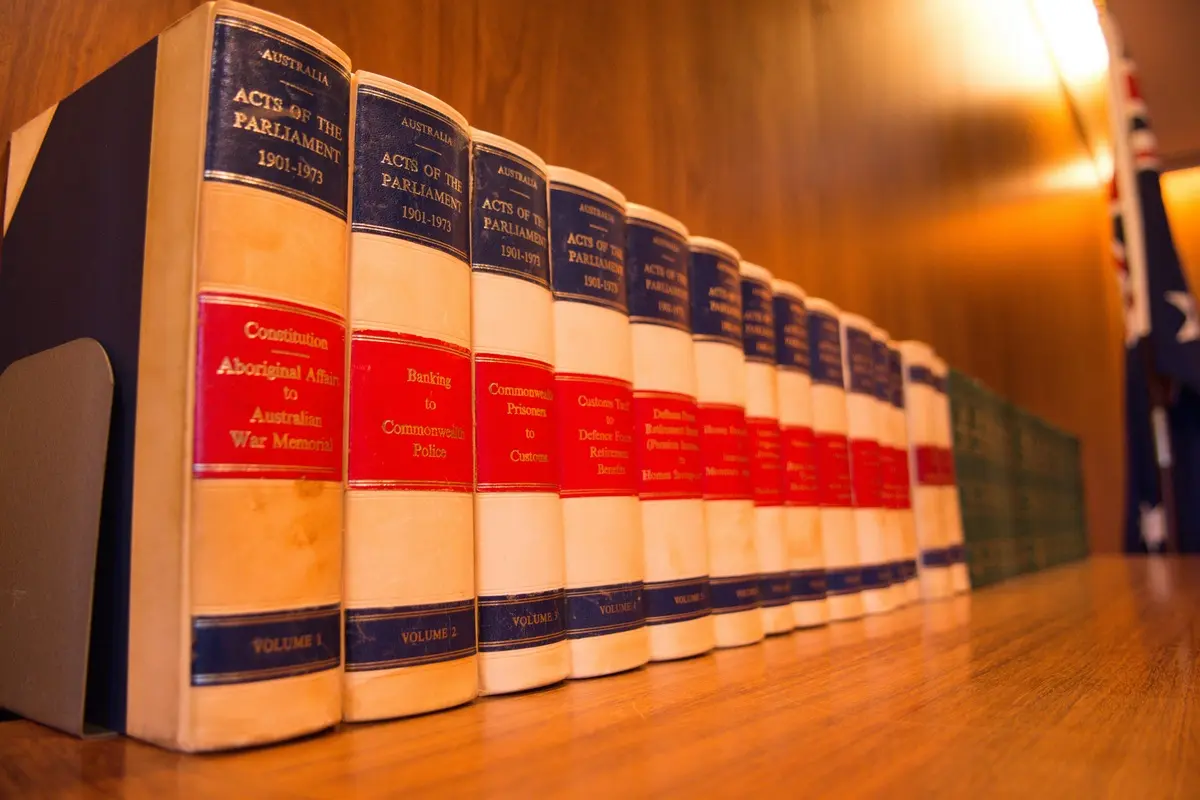
L’intention du législateur OHADA de ne pas légiférer sur la circulation des jugements nationaux, peut-être lue dans l’Acte uniforme OHADA relatif au transport de marchandises par route. En effet l’article 27 alinéa 3 de cet acte énonce que « lorsqu’un jugement rendu par une juridiction d’un Etat-partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient également exécutoire dans chacun des autres pays membres aussitôt, après accomplissement des formalités prescrites à cet effet dans l’Etat intéressé ».
Cela signifie que la procédure d’exequatur des décisions relatives au transport de marchandises par route est laissée aux législations nationales. La seule indication que le législateur donne est que les formalités requises « … ne peuvent comporter aucune révision de l’affaire ». Il s’en suit une diversité de régimes applicables à la circulation des jugements définitifs et une insécurité juridique quant à la circulation des jugements provisoires.
Le fait que l’OHADA ait laissé le soin aux législateurs nationaux de règlementer les procédures de reconnaissance et d’exécution des jugements a pour conséquence de créer une diversité de régime de circulation, parce que les législations nationales ne sont pas identiques. Certaines sont souples (cas de la Guinée[101], du Cameroun[102]), parce que ne posant pas de conditions excessives pour la reconnaissance et l’exécution, tandis que d’autres posent des conditions plus sévères.
En revanche, celles du Mali[103] et du Burkina-Faso[104] par exemple sont assez rigides et retiennent sensiblement les mêmes conditions.
Les conditions retenues par la législation la plus souple sont sensiblement au nombre de deux. L’une relative aux conflits de procédure et de décisions et l’autre relative à la contrariété à l’ordre public. Les autres conditions prévues dans les législations rigides sont : la compétence internationale du juge, le respect des droits de la défense, le caractère exécutoire de la décision dans son pays d’origine. Ces législations ont été adoptées à une période pendant laquelle le libéralisme des conditions d’exéquatur n’était pas encore rependu. Par conséquent elles ne sont plus adaptées à l’espace OHADA.
Certains Etats ne possèdent même pas de législation sur la reconnaissance et l’exequatur des jugements ou préfèrent tout simplement appliquer les conventions de coopérations judiciaires. La convention la plus englobante[106] est celle qui a été signé à Tananarive entre les pays de l’ex-OCAM en 1961. Or, les conditions posées dans cette convention sont rigides et inappropriées à un espace où les règles substantielles ont été unifiées.
C’est ainsi qu’à une ordonnance d’injonction de payer rendue au Cameroun et soumise au juge Gabonais pour exequatur, ce dernier au lieu d’appliquer la législation gabonaise, a appliqué les dispositions de la convention de Tananarive de 1961, dont les conditions sont toutes aussi rigides que certaines des législations nationales. Tout cela nous amène à affirmer qu’il faille nécessairement que l’OHADA organise la libre circulation des décisions de justice.
Paragraphe II : Plaidoyer pour l’instauration d’une libre circulation des décisions de justice
L’instauration de la libre circulation[106] des décisions de justice s’appuie sur la notion d’«espace» et postule qu’entre les Etats-parties à l’OHADA il n’existe plus de frontières juridiques en matière du droit des affaires. Dans un tel espace, les décisions rendues dans un Etat doivent automatiquement produire leurs effets dans les autres Etats parties.
L’instauration de cette libre circulation peut se faire selon le procédé de l’Union européenne. Premièrement, en matière d’injonction de payer, de délivrer ou de restituer, l’ordonnance rendue par le juge devrait être directement exécutoire sur l’ensemble des Etats-parties à l’OHADA. Le législateur OHADA devrait de ce fait supprimer l’exéquatur[107] préalable et admettre la possibilité d’exécution immédiate une fois que le titre serait passé en force de chose jugée.
La première raison qui justifie la suppression d’une procédure d’exequatur pour les décisions rendues à l’issue des procédures simplifiées de recouvrement, est le caractère certain de la créance[108]. A la lecture de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d’exécution (AUPRSVE), la forte présomption, ou encore la certitude de la créance de somme d’argent ou d’objet meuble corporel, est à la base des procédures simplifiées de recouvrement.
En effet, les articles 1 et 19 énoncent que toute personne qui se prétend titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible ou d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel, peut intenter une procédure simplifiée de recouvrement. Si à la vue des documents produits, la demande lui paraît fondée, le président de la juridiction compétente peut rendre soit une décision portant injonction de payer, soit ordonner la délivrance ou la restitution du bien meuble corporel.
C’est donc dire que l’utilisation de la procédure dépend de la forte présomption d’existence de la créance.
La procédure pourrait se dérouler comme suit : après que la décision portant injonction de payer ou de délivrer ait été signifiée au débiteur, si celui-ci ne forme pas opposition dans les 15 jours à compter de la date de la signification à personne, augmenté des délais de distance, la décision d’injonction de payer, de délivrer ou de restituer se transforme automatiquement en titre exécutoire, dont l’exécution peut être poursuivie dans tous les Etats parties de l’OHADA.
Si le débiteur par contre forme opposition, la décision d’injonction de payer, de délivrer ou de restituer rendue à l’issue de l’opposition, deviendra un titre exécutoire OHADA, après l’expiration des trente jours réservés à l’appel, à compter de la date de la décision. Si dans le délai de trente jours, le défendeur fait appel, la décision survenue à l’issue de l’appel devient immédiatement exécutoire dans tous les Etats-parties à l’OHADA sans exequatur[109].
Ensuite, lorsque le jugement a été rendu sur la base de débats contradictoires, et que le droit OHADA a été appliqué, la décision peut être revêtue automatiquement de l’autorité de la chose et de la force exécutoire dès lors qu’elle est passée en force de chose jugée. Cela peut être appliqué, lorsque les délais pour l’exercice des voies de recours ordinaires sont épuisés sans que le défendeur ait exercé un recours, ou alors lorsqu’une décision est survenue à l’issue de l’exercice des voies de recours.
Le demandeur d’exequatur devra produire à l’huissier ou à l’agent chargé de l’exécution dans l’Etat requis une copie certifiée conforme ou l’original de l’acte d’assignation à comparaître et de la notification de la décision au défendeur, et le cas échéant, un certificat de non appel, ou tout autre document attestant que le défendeur n’a pas exercé de voies de recours dans le pays d’origine.
Un document attestant que la décision est exécutoire dans son pays d’origine. Ces documents devront être annexés au procès-verbal de saisie sous peine de nullité de la saisie. La procédure sera donc inversée et il appartiendra à la partie qui conteste la force exécutoire de la décision de saisir le juge de l’exécution pour demander une mainlevée de la saisie.
L’OHADA n’est pas qu’un simple outil technique de sécrétion du droit. Par l’institution de la CCJA, et par l’uniformisation de certaines procédures, l’OHADA a réussi à mettre sur pied un véritable espace judiciaire. La CCJA à qui l’OHADA a conféré d’importants pouvoirs en matière d’interprétation et d’application des Actes uniformes, en la matière se substitue non seulement aux juridictions suprêmes nationales par la voie du recours en cassation, mais aussi aux juridictions nationales de fond à travers le pouvoir d’évocation dont elle dispose.
Toutes ces attributions ont été contestées par la doctrine parce que favorisant des rapports et les juridictions nationales[110]. Toujours est-il que cette hiérarchisation introduisant une structure pyramidale au sommet de laquelle se trouve la CCJA, et à la base les juridictions nationales de fond, contribue à l’émergence d’un espace judiciaire OHADA.
Aussi l’uniformisation des voies d’exécution permet la pratique uniforme des procédures d’exécution sur l’ensemble de l’espace géographique OHADA, ainsi que la force des arrêts de la CCJA dans tout l’espace OHADA.
Conclusion chapitre II :
L’espace judiciaire OHADA est loin d’être achevé dans la mesure où de nombreuses lacunes entravent la réalisation de cet espace. C’est notamment le cas de l’absence d’harmonisation de la carte judiciaire des Etats-parties et l’absence de coopération entre les juges des Etats-parties à l’OHADA. Cette absence de coopération conduit les juges nationaux des Etat-parties à évoluer en vase clos, ce qui a des conséquences néfastes sur la circulation des décisions.
Si l’incitation et l’accueil des investissements est l’objectif principal de l’OHADA, il serait alors préférable que les institutions de l’OHADA concentrent leurs efforts sur l’essentiel. Nous avons envie de penser à la réforme des institutions et des procédures judiciaires garantes de la sécurité juridique.
________________________
101. Loi N° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères. ↑
102. Article 517 du Code de procédure civile commerciale et sociale. ↑
103. Article 668 et s. Du Code de procédure civile. ↑
104. Celle qui regroupe le plu grand nombre d’Etats parties à l’OHADA. ↑
106. Il convient de rappeler que l’exéquatur n’a pas pour vocation de réviser le jugement au fond mais plutôt d’examiner si la décision rendue dans le respect des droits de la défense, si elle est conforme à l’ordre public communautaire. ↑
107. Articles 1, 2, 5, 19 et 23 de l’AUPRSVE. ↑
110. Favorisant des rapports et les juridictions nationales. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment l’absence de circulation des décisions judiciaires affecte-t-elle les investissements directs étrangers dans les États OHADA?
L’absence de circulation des décisions judiciaires nationales engendre une insécurité juridique, ce qui est irritant dans un espace dont l’objectif est l’intégration régionale.
Quelles sont les conséquences de la diversité des régimes juridiques sur la circulation des jugements dans les États membres de l’OHADA?
La diversité des régimes juridiques crée une insécurité juridique quant à la circulation des jugements, car certaines législations sont plus souples tandis que d’autres sont plus rigides.
Pourquoi est-il nécessaire que l’OHADA organise la circulation des décisions de justice?
Il est nécessaire que l’OHADA organise la libre circulation des décisions de justice pour éviter que les législations nationales ne créent des conditions rigides et inappropriées à l’espace OHADA.