Le cadre théorique de la contextualité révèle des mécanismes de défense insoupçonnés dans la communication interculturelle congolaise. Cette recherche innovante, alliant psychologie et méthodologie mixte, promet de transformer notre compréhension des dynamiques socioculturelles et d’éclairer des enjeux cruciaux de l’interaction humaine.
- Contextualité situationnelle
Telle est la troisième dimension de la communication interculturelle. C’est le cadre dans lequel la communication généralisée s’effectue. Ceci dit, il est question ici d’examiner tour à tour les notions et les éléments de cette dimension.
- Notions de la contextualité situationnelle
Comme on peut le remarquer, le contexte situationnel est le cadre spécifique dans lequel toute communication prend un sens. A cet effet, le processus de communication généralisée intervient pour modifier les contextes de l’environnement global (situation).
En communiquant, les individus se construisent, s’affirment, échangent des informations, nouent des liens, produisent des actes, entrent en conflit… La variété des contextes, des situations, des acteurs rend très complexe l’analyse des relations interpersonnelles.
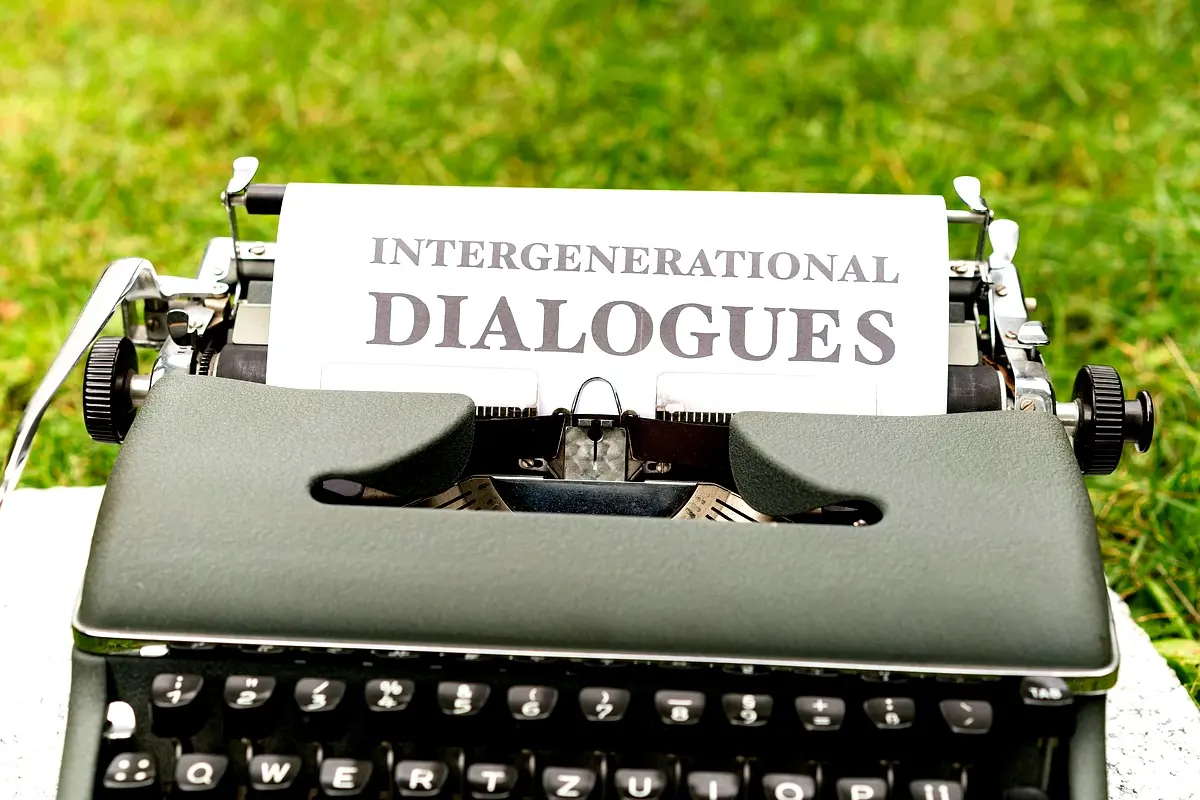
La communication est donc le rapport qui s’établit entre des personnes dans un contexte donné, à travers des interactions. Le contexte pèse sur toute situation de communication. Il y a donc un lien entre la communication (directe ou indirecte) et le contexte. D’où le concept de la « contextualité » cher à Edward Twitchel Hall153 ou celui de « contextualité situationnelle » avec Alex Mucchielli154.
Pour Edward Twitchel Hall155, les communications entre les individus peuvent être caractérisées par deux formes de contextualité : haute ou basse. Dans la culture à haute contextualité, les réseaux d’information marqués sont très extensifs, en raison d’une forte implication des relations personnelles. Ainsi, tout le monde est au courant du vécu de tout le monde et que dans la communication quotidienne, il n’est pas nécessaire de donner explicitement plus d’informations.
Tandis que dans la culture à basse contextualité, il a établit une distinction forte entre la vie privée et la vie professionnelle, on doit donc donner plus d’explication lors de la communication. Ces différences (haute ou basse contextualité) peuvent engendrer des malentendus.
Quelqu’un d’une culture de haute contextualité peut considérer l’autre culture comme bavarde, trop minutieuse ou trop directe. Inversement, quelqu’un d’une culture de basse contextualité peut considérer l’autre culture comme suspecte, douteuse (on me cache de l’information) et donc non coopérative.
Comme on peut le remarquer, dans toute communication, le contexte sert de cadre d’interprétation et de référence dans le sens où Alex Mucchielli et Claire Noy156 considèrent que le contexte est naturel, évident et approprié pour l’acteur compte tenu des enjeux, de ses orientations, de sa biographie.
Le contexte est donc corrélatif d’une orientation d’esprit (ou d’un système de pertinences) et d’actions en cours. Il peut exister plusieurs « contextes référentiels pertinents » pour interpréter, dans la totalité de ses significations et du point de vue de différents acteurs, une communication faite.
A ce sujet, Jean-Claude Abric157 distingue des facteurs de contexte et d’environnement qui affectent tout processus de communication dont celui de la communication interculturelle, notamment : le contexte spatial, le contexte social, le contexte culturel et idéologique.
A propos du contexte spatial, est mise en relief la disposition spatiale des locuteurs qui joue un rôle essentiel dans la nature des échanges : le type de langage utilisé, l’interprétation de la finalisation de la situation. Ce résultat peut être généralisé à l’ensemble de l’organisation de l’espace. L’aménagement matériel de l’espace est fortement socialisé.
La simple disposition des tables dans une salle de conférences manifeste une intentionnalité : dialogue et échange pour un espace ouvert et circulaire, monologue et absence d’interaction pour un espace fermé, ordonné et hiérarchisé comme une salle de classe ou un amphithéâtre.
Le lieu choisi pour communiquer, mais aussi le moment, l’utilisation ou non d’éléments matériels marqués socialement (fauteuils, bureaux, etc.) interviennent directement sur la nature et la qualité de l’interaction entre les acteurs.
Concernant le contexte social, il s’agit de l’effet de la présence d’un public ou d’observateurs sur le comportement, appelé en psychologie sociale l’audience et la coaction. Et de nombreuses recherches menées sur la facilitation sociale comme celle de Robert B. Zajong158 en 1965 ont permis de montrer que la présence d’un public (passif) agit directement sur la motivation, la démarche cognitive et la performance de sujets effectuant différents types de tâches.
La coaction, comme la présence d’un public actif, augmente le niveau général de motivation, augmente la performance individuelle mais gêne l’apprentissage.
Et pour ce qui est du contexte culturel et idéologique, ce sont la pratique de la communication, le décodage de la situation d’indicateurs verbaux ou non verbaux qui sont directement déterminés par le contexte culturel. Ce contexte peut être ici au sens étroit ou large.
Au sens étroit, la micro-culture d’une organisation, d’une institution, d’un groupe social donné détermine des modes de communication, un système d’échanges qui peut être complètement spécifique, c’est-à-dire compréhensible et mis en œuvre que dans ce contexte limité.
Quant au sens large, par expérience, il faut reconnaître qu’il peut être extrêmement difficile de communiquer avec des interlocuteurs issus d’une autre culture, faute de moyens de codage et de décodage appropriés de l’information transmise. Ainsi, la signification culturelle du sourire varie d’une culture à une autre.
Enfin, le contexte permet à l’acteur social qui produit ou reçoit et évalue une communication généralisée d’interpréter les événements. Ce « contexte pertinent » est très souvent confondu avec la situation-pour-l’acteur en question. Il est alors constitué d’éléments significatifs « de la situation ». Le paragraphe qui suit définit ces éléments.
________________________
153HALL, E.T., op.cit, 1984, pp.1-237. ↑
154MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 133-134. ↑
155HALL, E.T., op.cit, pp.1-237. ↑
156MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 133-134. ↑
157ABRIC, J.-C., op.cit, pp. 18-19. ↑
158ZAJONG, R.B., « Social facilitation », in Science, n°149, 1965, pp. 269-274. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la contextualité situationnelle en communication interculturelle?
Le contexte situationnel est le cadre spécifique dans lequel toute communication prend un sens. Il modifie les contextes de l’environnement global et influence les interactions entre individus.
Comment la culture influence la communication interculturelle au Congo?
Dans la culture à haute contextualité, les réseaux d’information sont très extensifs, tandis que dans la culture à basse contextualité, il y a une distinction forte entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui peut engendrer des malentendus.
Quels sont les facteurs de contexte qui affectent la communication interculturelle?
Jean-Claude Abric distingue des facteurs de contexte et d’environnement, notamment : le contexte spatial, le contexte social, le contexte culturel et idéologique, qui affectent tout processus de communication.