Le cadre théorique de la réception révèle comment l’adaptation cinématographique du Colonel Chabert par Yves Angelo redéfinit notre compréhension de l’œuvre de Balzac. En confrontant art littéraire et art cinématographique, cette étude offre des perspectives inédites sur l’intertextualité et la perception des œuvres.
Première partie
Chapitre I
L’œuvre et sa réception
Pendant longtemps, l’étude de l’œuvre littéraire s’est limitée en l’étude des deux éléments principaux qui sont : l’auteur et son œuvre.
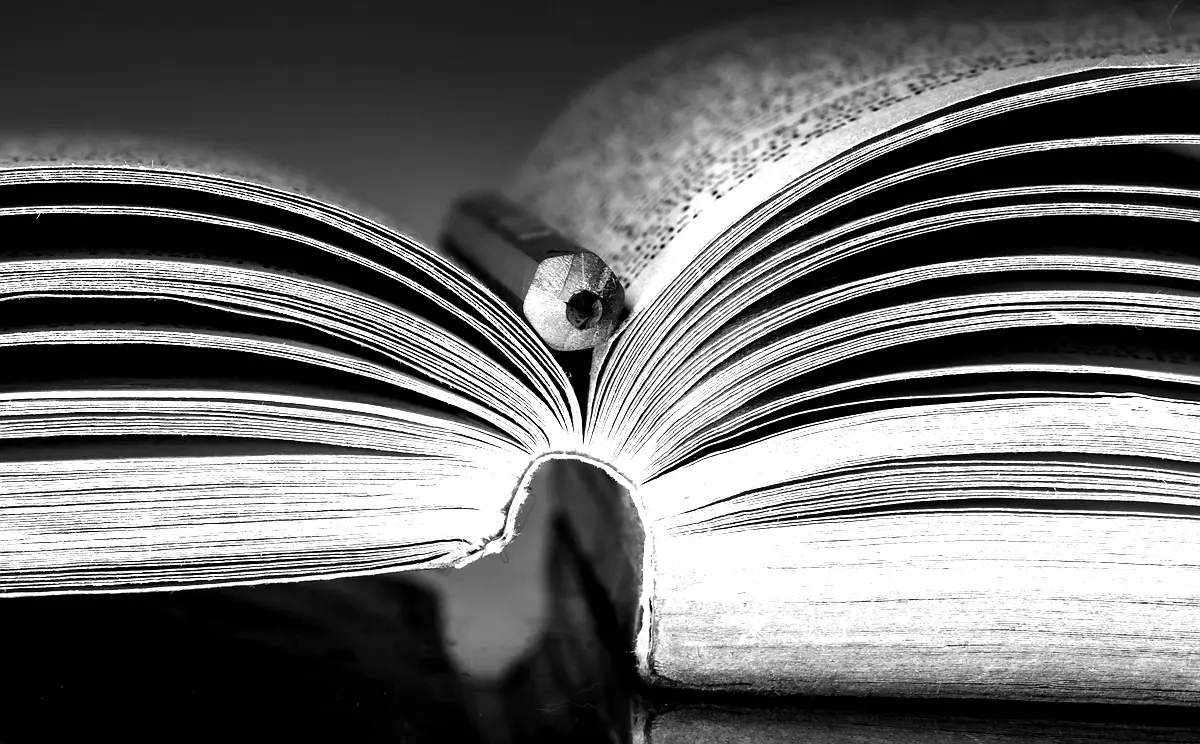
L’écrivain-critique français Sainte-Beuve (ainsi que d’autres) a consacré une grande partie de ses travaux pour étudier l’auteur, d’autre part, Roland Barthe a mis l’accent sur l’œuvre.
C’est Jean Paul Sartre qui évoque le problème de la réception dans la troisième partie de son ouvrage intitulé Que ce que la littérature ? « Pour qui écrit-on ? », où il a déclaré d’emblée que chaque écrivain écrit pour un destinataire : « A première vue, cela ne fait pas de doute : on écrit pour le lecteur universel » Plus tard les structuralistes de Prague ont développé une théorie de la réception.
Dans la seconde moitié du XIX siècle, certaines théories littéraires foisonnent pour un objet bien déterminé, c’est pour intervertir l’esthétique traditionnelle de la production par une autre esthétique c’est celle de la théorie de la réception et pour opposer en effet, l’idée que l’histoire littéraire est considérée comme étant seulement l’histoire d’écrivains et d’auteurs et non pas celle qui vise la réception des œuvres.
C’était avec le théoricien Allemand Hans Robert Jauss que, le rôle considérable du lecteur est mis en valeur dans ce qu’on appelle la Co-création du texte, Hans Robert Jauss adopte « la théorie de l’évolution » développée par les formalistes russes : Victor Chlovski, Boris Eichenbaum, Youri Tynianov…
Le lecteur a été introduit dans le texte pour une activité plus ou moins interprétative. Cet espace sacré qui abriterait le lecteur dans une communion particulière avec le livre. Il contribue donc à construire un sens propre à lui, et c’est un processus qui fait appel à ses références esthétique, politique, culturel ainsi que social.
Les théories de réception ont donné naissance à deux sous-théories celle de l’Allemand Hans Robert Jauss dans son ouvrage intitulé pour Une Esthétique De La Réception, et celle d’Iser Wolfgang dans l’acte de la lecture. Ces théories insistent sur deux concepts essentiels celui de l’acte de la lecture et celui du lecteur, en les considérant les éléments clés de la construction de sens.
Dans ce qui suit nous allons mettre l’accent sur des concepts liés aux théories de réception suivantes : « la réception », « l’acte de la lecture », « lecteur empirique », « l’horizon d’attente » et « lecteur modèle ».
Avant d’analyser ces concepts, nous tenterons de parler brièvement du fondateur de la théorie de réception.
Hans-Robert Jauss
Hans Robert Jauss, philosophe et théoricien de la littérature Allemande connu par sa formulation de la théorie de la réception développée en 1970. Professeur de littérature romane et de théorie de la littérature à l’université de Constance, fondée à la fin des années 1960 en Allemagne, où il enseigna de 1966-1987, il commença sa carrière académique avec sa thèse très remarquée « à la recherche du temps perdu » (1957).
Hans Robert Jauss est avec Wolfgang Iser le fondateur d’un groupe de recherche littéraire connu sous le nom d’école de Constance. La théorie de Jauss oppose totalement la théorie traditionnelle de la production et de l’imitation littéraires. Or cette nouvelle théorie fait du lecteur un protagoniste essentiel dans la communication littéraire.
La réception
La définition de la réception d’une œuvre littéraire a été formulée dans le dictionnaire de la critique littéraire ainsi : « la réception est perception d’une œuvre par le public (…) Etudier la réception d’un texte, c’est accepter que la lecture d’une œuvre est toujours une réception qui dépend du lieu et de l’époque où elle prend place. »7
Dans son ouvrage intitulé « Le démon de la théorie », L’écrivain et critique français Antoine Compagnon, a également simplifié le concept de la réception, on désigne donc par réception les études consacrées : « à la manière dont une œuvre affecte le lecteur, un lecteur à la fois passif et actif, […] individuel ou collectif, et sa réponse. »8
7Le dictionnaire de la critique littéraire, p.32
8COMPAGNON Antoine, Le démon de la théorie, p.24
C’est à partir des années soixante-dix que le théoricien Hans Robert Jauss créa une nouvelle théorie qui s’oppose carrément à toutes les théories traditionnelles qui négligent le rôle du lecteur dans le processus de la lecture, et qui confirment que le texte littéraire est un simple reflet de la vie sociale de l’écrivain, cette théorie figurant dans « pour une esthétique de la réception » a donné une nouvelle vision dans le domaine de la critique littéraire, en confirmant que « L’historicité de la littérature ne consiste pas dans un rapport de cohérence établi a posteriori entre des faits littéraires mais repose sur l’expérience que les lecteurs font d’abord des œuvres »9
En essayant ainsi de donner une nouvelle relativité à l’œuvre, afin de créer un lien entre elle et la société du lecteur, à ce propos Jauss dit : « l’œuvre littéraire n’a qu’une autonomie relative. Elle doit être analysée dans un rapport dialectique avec la société. Plus précisément, ce rapport consiste dans la production, la consommation et la communication de l’œuvre lors d’une période définie, au sein de la praxis historique globale »
L’étude de la réception dans la littérature permet à l’œuvre littéraire de se situer dans la nouvelle histoire littéraire, de prendre son importance dans le contexte dont elle fait partie et de s’opposer totalement à toute limitation dans les études littéraires traditionnelles, en ce sens Jauss dit :
L’esthétique de la réception ne permet pas seulement de saisir le sens et la forme de l’œuvre littéraire tels ont été compris de façon évolutive à travers l’histoire. Elle exige aussi que chaque œuvre soit placée dans la série littéraire dont elle fait partie, afin qu’on puisse déterminer sa situation historique, son rôle et son importance dans le contexte général de l’expérience littéraire.
Grâce aux définitions présentées, nous constatons que la réception optimale dépend de deux paramètres essentiels : le premier est la prise de conscience de l’œuvre par le lecteur et le deuxième c’est la lecture de l’œuvre par celui-ci, dans tous les cas c’est le lecteur qui fait tout seul le
9ROBERT JAUSS Hans, « pour une esthétique de la réception », p.46
processus de la lecture, c’est à la fois celui qui lit le texte et celui qui crée le sens avec sa propre valeur tout en rapprochant l’œuvre à sa vie réelle, c’est ce que Jauss a expliqué : «La réception des œuvres est donc une appropriation active qui en modifie la valeur et le sens au cours des générations jusqu’au moment présent où nous nous trouvons face à ces œuvres dans notre horizon propre, en situation de lecteur. »10
L’horizon d’attente
Toute œuvre littéraire est transformée pour un public bien déterminé afin d’évaluer sa forme et de décider si elle convient à ce qu’il attend ou le contraire.
De ce fait Hans Robert Jauss parle de ce qu’il a nommé l’« horizon d’attente », c’est l’une des idées fondamentales autour desquelles se construit la théorie de la réception, d’une part pour comprendre l’effet de l’œuvre et d’autre part, pour préciser le rapport entre l’œuvre littéraire et son public tout en reconnaissant l’origine de ce concept aux théoriciens notamment Husserl et Gadamer.
Selon Jauss, l’horizon d’attente du lecteur est un :
Système de références objectivement formulable qui, pour chaque œuvre au moment de l’histoire où elle apparaît, résulte de trois facteurs principaux : l’expérience préalable que le public a du genre dont elle relève, la forme et la thématique d’œuvres antérieures dont elle présuppose la connaissance, et l’opposition entre langage poétique et langage pratique monde imaginaire et réalité quotidienne.
En d’autres termes l’horizon d’attente se résume selon Jauss : « tout un ensemble d’attentes et de règles du jeu avec lesquelles les textes antérieurs l’ont familiarisé et qui au fil de la lecture peuvent être modulées, corrigées, modifiées ou simplement reproduites »
En effet, le concept d’horizon d’attente a fondé une analyse sur laquelle se construit une approche renouvelée de l’expérience esthétique et liée principalement par l’expérience, la connaissance et l’esprit du lecteur à travers la lecture.
L’adoption de 10Ibid, p.69
l’œuvre littéraire par son lecteur est traduite par le changement de sa vision ou bien le changement de ses comportements sociaux, il rejette donc ce que lui propose l’œuvre et ne réagit pas à ce qu’elle lui offre. Dans ce propos Jauss observe que : « la façon dont une œuvre littéraire au moment où elle apparaît, répond à l’attente de son premier public, la dépasse, la déçoit ou la contredit fournit un critère pour le jugement de sa valeur esthétique »
De plus, l’horizon d’attente dans la théorie de la réception comprend des connaissances littéraires préalables du lecteur, qui existent antérieurement, et les considèrent comme un fondement qui permet à celui-ci de réagir face à l’œuvre en question. En effet, le lecteur fait appel à ses connaissances lorsqu’il fait une lecture des textes passés pour une interprétation réflexive, on est surtout dans l’intertextualité qui détermine le rôle de la littérature et précise le rapport entre l’œuvre nouvelle et les textes antérieurs et en particulier le rôle du lecteur.
Jauss a fait une distinction entre l’horizon d’attente social et l’horizon d’attente littéraire. Pour lui le premier est lié principalement au lecteur et le deuxième est impliqué par le texte, ces deux éléments participent à la concrétisation du sens de l’œuvre. En effet, l’œuvre doit respecter certaines normes esthétiques, refléter la vie sociale et la vision du monde et s’inspirer à la fois des textes antérieurs.
Pour sa part le lecteur qui coexiste dans une époque déterminée et avec ses connaissances, il crée la réception de l’œuvre dans un « horizon d’attente social », il affirme que :
« L’esthétique de la réception » en s’engageant dans la voie de la lecture, a opté pour deux orientations aussi interactives que distinctives l’une de l’autre, celle de l’ « effet » et celle de la « réception » en avançant que la concrétisation d’une œuvre littéraire est la résultante des deux composantes l’ « effet » qu’elle produit sur le lecteur et la « réception » faite par ce dernier. Ainsi « l’effet présuppose un rappel ou un rayonnement
venu du texte, mais aussi une réceptivité du destinataire qui se l’approprie » 11
Effectivement, l’horizon d’attente est devenu un concept fondamental dans la théorie de la réception dans la mesure où il permet à étudier l’histoire littéraire et de définir l’œuvre littéraire comme une œuvre d’art par rapport à son effet sur le public.
________________________
7Le dictionnaire de la critique littéraire, p.32 ↑
8COMPAGNON Antoine, Le démon de la théorie, p.24 ↑
9ROBERT JAUSS Hans, « pour une esthétique de la réception », p.46 ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la théorie de la réception selon Hans Robert Jauss?
La théorie de la réception développée par Hans Robert Jauss met en valeur le rôle considérable du lecteur dans la co-création du texte, considérant que la lecture d’une œuvre est toujours une réception qui dépend du lieu et de l’époque où elle prend place.
Comment la réception d’une œuvre littéraire est-elle définie?
La réception d’une œuvre littéraire est définie comme la perception d’une œuvre par le public, et étudier la réception d’un texte implique d’accepter que la lecture est influencée par le contexte historique et culturel.
Quels sont les concepts clés des théories de la réception?
Les concepts clés des théories de la réception incluent ‘la réception’, ‘l’acte de la lecture’, ‘lecteur empirique’, ‘horizon d’attente’ et ‘lecteur modèle’.