Le cadre théorique de la photographie révèle comment les images documentaires de l’occupation américaine d’Haïti (1915-1920) transcendent leur fonction initiale. En analysant les codes vestimentaires et les postures, cette étude met en lumière des représentations sociopolitiques méconnues, redéfinissant notre compréhension de cette période cruciale.
C- Problématique
Contrairement à ce qu’on pensait, la photographie, partant de son évolution en Haïti, a souvent servi pour expliquer des réalités sociopolitiques. D’une part, elle est associée à son foyer d’invention, c’est-à-dire la France. Michel Philippe Lerebours a affirmé que les premiers photographes s’installent à Port-au-Prince en 186022. Jean Desquiron a affirmé : « peu de temps après l’auto-proclamation du président Faustin Soulouque comme empereur Faustin Ier, Johannes Friborg invite le public à venir se faire des portraits au daguerréotype »23.
D’autre part, elle est associée à une élite, une institution étatique qu’est l’armée dès la fin du XIXème siècle dans des pays européens et américains. Entre autre, Charles Baudelaire a identifié l’essor de la photographie avec l’essor de la bourgeoisie24. Ceci dit, il a mis en question son caractère élitiste.
D’ailleurs, quelqu’un d’autre avance que des militaires en carte de visite sont venus introduire la photo en Haïti vers les années 1864.
En effet, Roger Gaillard nous a affirmé que « les photographes cubains étaient déjà là en 1878, après la défaite de leur première guerre d’indépendance ». Parmi ces expatriés cubains, il n’y a
18 (“Liste Chronologique Des Massacres Commis En Haïti Au XXe Siècle 2015, p 3)
19 (Gaillard Roger 1981)
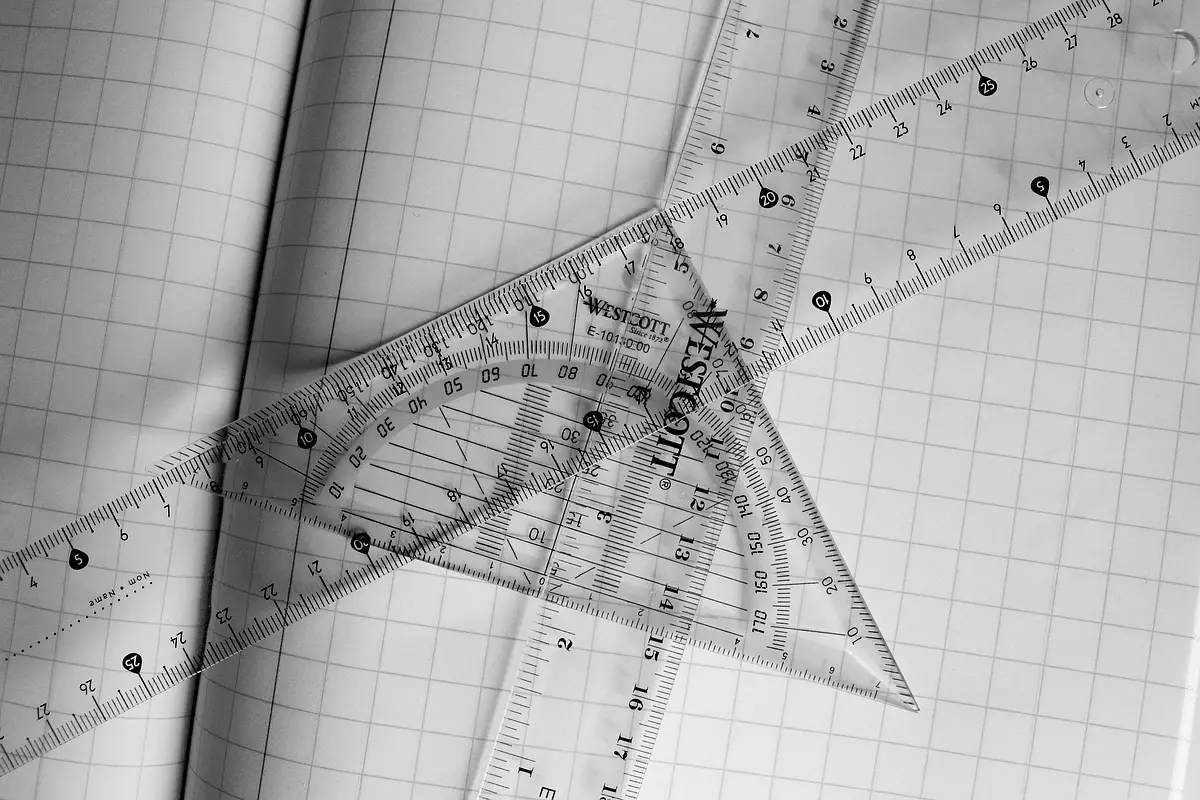
20 (Ibid, p 211)
21 Ibid, p 229, 230)
22 LEREBOURS Michel Philippe, Haïti et ses peintres, De 1804 à 1980, Ed. Bibliothèque Nationale d’Haïti, 1989, Haïti
23 DESQUIRON Jean, Haiti à la une – une anthologie de la presse haïtienne de 1724 à 1934, Tome I (1724 – 1864), p 238
24 MICHAUD Stéphane, Jean – Yves MOLLIER et Nicole SAVY, Usages de l’image au XIXème siècle, Ed. Créaphis, 1992, Paris, p. 252
que des cordonniers. D’autres sont tailleurs, coiffeurs, orfèvres, photographes, ébénistes, sans compter des musiciens et des médecins représentant les professions libérales25. L’auteur poursuit
: « …ils ne vivent que de la sueur de leur front »26. En effet, les premiers photographes qui s’installent en Haïti étaient venus de partout, particulièrement de la France et de Cuba, et ils n’avaient d’autres statuts que d’artisans. Donc, c’étaient des amateurs. En outre, dans les premiers moments de la photographie le portrait était dominant. Les personnages allaient se faire photographier pour exhiber leur richesse, leur « statut social ».
A l’occasion du 28 Juillet 1915, marquant le débarquement de l’armée états-unienne à Port-au- Prince, une nouvelle vague de photographes vinrent en Haïti27. Pour ainsi dire, diverses sources nous sont parvenues. En fait, ces sources génèrent des contradictions qui s’expriment même dans notre réalité historique avec la trace de ces photographes qui nous sont parvenus.
Entre autres, cette vague de photographes états-unien a laissé tant de photos éveillent notre curiosité. Pour ainsi dire, les photos essaient de révéler le réel dans un désir de pérennité. Ils sont de genre documentaire. C’est pourquoi, nous avons eu beaucoup d’intérêt à nous aventurer sur cette thématique pendant l’occupation états-unienne d’Haïti (1915–1920).
Cette période correspond à un moment où la population haïtienne a vécu un changement de paradigme dans le sujet photographique à l’aide des images inédites, surtout dans les représentations humaines.
Aussi, est-ce une période marquée par le mouvement social des cacos. A noter que, les cacos étaient des citoyens haïtiens qui ont mené un vaste mouvement social visant à résister face à l’occupation. Ils revendiquaient la souveraineté du peuple haïtien, libre et indépendant. Ce mouvement social allait ouvrir de nouveaux horizons pour les photographes. Bien entendu, la résistance intellectuelle s’est fait sentir. A tel point que « Georges Sylvain et ses collaborateurs organisèrent une croisade en Haïti et aux Etats-Unis dans le but de restaurer la souveraineté haïtienne…28 »
25 Gaillard Roger, Les blancs débarquent : La République exterminatrice, 1982, Ibid, p.192
26 Ibid, p. 193
27 En s’appuyant sur la signature du Major Mead qui a photographié le cadavre de Charlemagne Péralte
28 JEREMIE Rouchon TROIS GENERATIONS D’INTELLECTUELS Haïtiens : DE LA PERCEPTION DU DISCRÉDIT ÉTRANGERA LASECONDE INDÉPENDANCE », Thèse de doctorat, Université d’Ottawa, 1997 http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/nq21978.pdf
Du coup, le sujet photographique s’est diversifié. C’est ce qu’on va appeler dans les années 1910 – 193029 la photographie documentaire. Tout d’abord, ce qui nous parait un peu controverser c’est le message imagé que les Marines ont fait circulé du mouvement des cacos, jusqu’à ce qu’ils leur accusaient de « bandits »30.
C’est-à-dire des malfaiteurs ne bénéficiant d’aucune protection de la loi, pouvant à tout moment être abattu sans jugement. Or, ce ne sont que les héritiers des traditions révolutionnaires haïtiennes31 qui se sont organisés à la fois militairement et politiquement en se fondant sur les traditions ancestrales. Leur objectif était de lutter pour le rétablissement de la souveraineté nationale.
Pour casser le mouvement, après la mort de Charlemagne Péralte le 1er novembre 1919, les Marines ont fait circuler des milliers d’exemplaires de l’image de l’assassinat de celui-ci, une façon d’intimider les Cacos. A remarquer que Charlemagne Péralte était un révolutionnaire nationaliste et chef du mouvement des Cacos, une icône de la résistance armée, manifestation essentielle du nationalisme de souche paysanne32.
En outre, après avoir assassiné Benoit Batraville le 20 mai 1920, les Marines ont coupé sa tête et faire le tour de la ville avec33. A noter que celui-ci était le lieutenant de Charlemagne Peralte qui a repris le flambeau de la lutte. Il a été nommé le 2 décembre 1919 commandant des forces Cacos, pour remplacer tout de suite Charlemagne Péralte dans un congrès organisé par les Cacos.
Par ailleurs, dans quel objectif que les Marines ont assassiné des leaders du mouvement des cacos ? Dans quel objectif les marines ont partagé des exemplaires des photos d’assassinats aux populations rurales ? N’était-ce pas un outil de manipulation ?
Par la propagation de ces messages photographiques, des citoyens inspirés de la crainte de l’occupant ont cessé de soutenir le mouvement des Cacos. En outre, ces citoyens se sont trouvés relativement à proximité des localités occupées par les Cacos. Ainsi, l’image des Cacos comme patriotes et nationalistes34 n’a pas cessé de discréditer.
Le constat d’un manque de vulgarisation de cette tranche d’histoire sur les supports iconographiques, à vocation scientifique, fait défaut à la compréhension et à la sensibilisation de plus d’un. A cela, certains individus se trouvent en difficulté de s’approprier de l’image de leur société. En fait, c’est une société d’hypocrite qui cache son histoire et son image. Sur ce point, Charles – Olivier Carbonell a affirmé: « Une société ne se dévoile jamais si bien que lorsqu’elle projette derrière elle sa propre image »35.
Dans ce cas, cette recherche sur l’iconographie en Haïti est fondamentale. Peut-être, notre seule limite c’est que notre discours se tourne autour de l’image. Et qui concerne le premier quinquennat de la période étudiée, et les sujets sont des représentations humaines. Et ceci dit, peut-être l’importance de cette recherche qui vise à étudier le mouvement social des Cacos à l’aide du genre documentaire.
Nous essayons de montrer à quel niveau le photographe pourrait être objectif, comme Paul Sand a évoqué la notion de l’objectivité de la photographie…36. Cependant, comment la photographie documentaire peut-elle servir d’aide-mémoire pour comprendre le mouvement social des Cacos pendant l’occupation états-unienne d’Haïti (1915 – 1920)?
Nous nous donnons pour objectif de valoriser la photographie documentaire dans sa capacité de mettre à jour l’image « inédite » de l’identité des protagonistes durant l’occupation états-unienne d’Haïti (1915 – 1920). Ensuite, démontrer la façon dont chacun des cas du corpus modélise un aspect particulier du mouvement des Cacos. Puis, faire ressortir le caractère factice du message identitaire souligné par la photographie. Et, démontrer que la photographie documentaire comme source pouvant raconter les évènements historiques. Enfin, démontrer que la photographie documentaire peut servir d’aide-mémoire du mouvement de résistance des Cacos.
Nous fixons l’hypothèse que la photographie documentaire est révélatrice de la répression de l’occupant sur le mouvement social des cacos.
Le modèle théorique de Barthes faisant croire que la photographie apporte derrière elle un message et le modèle d’analyse d’image de Stéphanie Dansereau37 pratique se rencontrent dans notre travail. Cette rencontre facilite l’opérationnalisation de ce concept. D’abord nous identifions l’œuvre; une première exploration; une analyse, les aspects extérieurs, l’analyse de la mise en œuvre; les procédés d’expression; la contextualisation, le contexte de l’élaboration de l’œuvre, les recherches savantes; et enfin un résumé.
35 CARBONELLE Charles Olivier, L’HISTORIOGRAPHIE, Edition PUF, 1981, p. 4
36 FRIZOT Michel, LACAMBRE Geneviève, Antoinette LENORMAND – ROMAIN, Rodolphe RAPETIT, Philippe NEAGU, Françoise HEILBRUN, Marc BASCOU, Philippe THIEBAUT, Caroline MATHIEU, Georges VIGNE, Nouvelle histoire de la photographie, Ed. Bordas S. A, 1994, Paris, p. 387
37 DANSEREAU, Stéphanie, http://www.er.uqam.ca/nobel/r33554/accueil/guantanamo.html
________________________
22 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
23 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
24 MICHAUD Stéphane, Jean – Yves MOLLIER et Nicole SAVY, Usages de l’image au XIXème siècle, Ed. Créaphis, 1992, Paris, p. 252. ↑
25 Gaillard Roger, Les blancs débarquent : La République exterminatrice, 1982, Ibid, p.192. ↑
27 En s’appuyant sur la signature du Major Mead qui a photographié le cadavre de Charlemagne Péralte. ↑
28 JEREMIE Rouchon TROIS GENERATIONS D’INTELLECTUELS Haïtiens : DE LA PERCEPTION DU DISCRÉDIT ÉTRANGERA LASECONDE INDÉPENDANCE », Thèse de doctorat, Université d’Ottawa, 1997. ↑
29 En mettant l’accent sur la définition adoptée au Vème congrès de la Photographie en 1910, cité dans le corps du travail par M.me Françoise DENOYELLE dans son mémoire de maitrise en 2012. Et en considérant les travaux de Michel Frizot dans lesquels elle a fait l’évolution de la photographie documentaire (1915 – 1920). ↑
30 Gaillard Roger, Les blancs débarquent : Charlemagne Péralte le caco, 1981, p, 43. ↑
31 Dubois Laurent, http://www.fokal.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1080%3Ademocratie-a-la-base- lhistoire-de-la-culture-politique-dhaiti&Itemid=54. ↑
32 CASTOR Suzy, L’occupation américaine d’Haïti, Ed. CRESFED, 3ème Ed. Française p. 150. ↑
33 Entrevue avec un guide du MUPANAH en février 2014. ↑
34 Gaillard Roger, Ibid, p. 12-13. ↑
35 CARBONELLE Charles Olivier, L’HISTORIOGRAPHIE, Edition PUF, 1981, p. 4. ↑
36 FRIZOT Michel, LACAMBRE Geneviève, Antoinette LENORMAND – ROMAIN, Rodolphe RAPETIT, Philippe NEAGU, Françoise HEILBRUN, Marc BASCOU, Philippe THIEBAUT, Caroline MATHIEU, Georges VIGNE, Nouvelle histoire de la photographie, Ed. Bordas S. A, 1994, Paris, p. 387. ↑
37 DANSEREAU, Stéphanie, http://www.er.uqam.ca/nobel/r33554/accueil/guantanamo.html. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment la photographie a-t-elle évolué en Haïti pendant l’occupation américaine ?
La photographie a souvent servi à expliquer des réalités sociopolitiques en Haïti, évoluant avec l’arrivée de photographes états-uniens après le débarquement de l’armée en 1915.
Quel rôle ont joué les cacos dans la photographie durant l’occupation d’Haïti ?
Les cacos, qui ont mené un mouvement social pour revendiquer la souveraineté haïtienne, ont ouvert de nouveaux horizons pour les photographes en introduisant des représentations humaines inédites.
Quels types de photographies ont été produites pendant l’occupation états-unienne d’Haïti ?
Une nouvelle vague de photographes a produit des images documentaires qui cherchent à révéler le réel, notamment à travers des représentations de groupes dans des contextes militaires et politiques.