Le cadre théorique de la certification révèle des enjeux cruciaux pour la responsabilité des commissaires aux comptes en Tunisie. En examinant 30 prospectus financiers, cette étude met en lumière des risques souvent méconnus et propose des solutions innovantes, essentielles pour une meilleure transparence financière.
Section 2 : Les risques économiques et financiers liés aux opérations d’émission
Le développement et la communication des informations financières relèvent du système comptable de l’entreprise. Ainsi le rôle assigné à n’importe quel système comptable est de faciliter le processus de décision d’une multitude d’utilisateurs de l’information financière.
D’abord le public financier : les offreurs de crédit commercial qui s’intéressent surtout à la liquidité de la firme analysée, les banquiers qui ont à évaluer les demandes d’emprunt présentées par les entreprises et les obligataires qui s’intéressent à la capacité de l’entreprise d’assurer sur ses flux de liquidité le service de la dette pendant une longue période et qui peuvent être conduits à analyser la structure financière de l’entreprise, ses principales sources de financement et utilisations de fonds, les investisseurs ou leurs prescripteurs qui ont à recommander l’achat ou la vente de titres et à conseiller une clientèle dans la constitution d’un portefeuille et qui se préoccupent surtout des bénéfices actuels et escomptés dans le futur, ainsi que de la stabilité de ceux-ci autour d’une tendance.
Ensuite d’autres utilisateurs tels que les organismes de contrôle, les clients, les fournisseurs, etc. Dans cette étude des risques, nous nous intéressons essentiellement au public financier et plus particulièrement aux investisseurs.
Un risque est la menace qu’un événement ou une action (ou son absence) affecte la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs et altère sa performance.
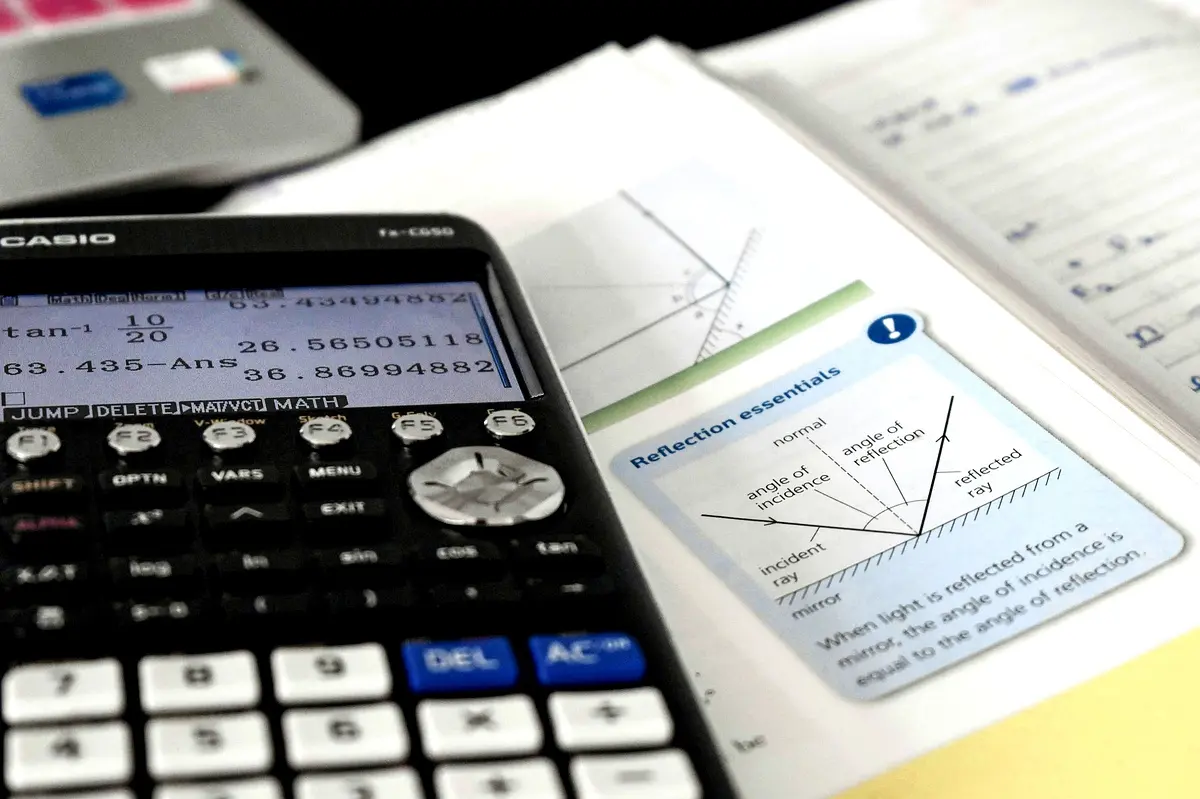
Il s’agit, dans cette section, de définir les différents types de risques auxquels l’entreprise, émettrice de valeurs mobilières, est soumise. Dans la section 3 du premier chapitre de la deuxième partie, nous allons proposer un ensemble de mesures qui sont généralement utilisées par les auditeurs pour appréhender ces risques.
Risque économique ou d’exploitation
Les capitaux apportés par les actionnaires et les prêteurs doivent être rémunérés, faute de quoi, l’entreprise aurait les plus grandes difficultés à attirer les capitaux et risquerait ainsi de rater des occasions de traiter des opérations commerciales rentables.
Le risque économique ou risque d’exploitation relève de la décision d’investissement dont l’objectif est d’effectuer le meilleur choix parmi les différents projets ou programmes d’activité économique qui s’offrent à l’entreprise. Il peut être défini comme le risque attaché à la réalisation d’un revenu ou d’un flux de liquidité futur espéré, calculé sans tenir compte du moyen de financer l’investissement qui doit permettre la réalisation de ce revenu. C’est la probabilité de réaliser un excédent brut d’exploitation négatif.
L’activité de l’entreprise est soumise au risque d’exploitation (qualifié aussi de risque opérationnel) car elle ne peut pas prévoir avec certitude les différentes composantes de son résultat (coût, quantités, prix) et de son cycle d’exploitation (achat, transformation, vente). Mesurer ce type de risque, c’est évaluer la possibilité de faire des pertes ou un résultat d’exploitation insuffisant.
Cette éventualité est liée à l’importance des charges fixes qui diminuent la flexibilité de l’entreprise, c’est-à-dire sa capacité à s’adapter à une variation de son chiffre d’affaires.
Nous proposons ainsi d’étudier les véritables indicateurs de risque d’exploitation. En effet, La capacité d’une entreprise à affronter les risques relatifs à son exploitation dépend de la taille et de la dimension qu’elle occupe par rapport aux entreprises concurrentes.
Parmi les facteurs de risque propres à l’état de l’entreprise figurent, d’une part, les variables liées à la dimension de la firme et, d’autre part, celles liées à son activité boursière.
Dimension de l’entreprise
La dimension des sociétés peut être appréhendée d’un point de vue purement statique, par l’analyse de la taille à un instant donné ou, à l’inverse, d’un point de vue dynamique, par l’observation du taux de croissance. On va essayer de montrer comment ces deux éléments d’appréciation peuvent être en relation avec le risque d’un titre.
Taille
Les grandes entreprises sont présumées présenter moins de risque. Plusieurs arguments théoriques, qui ne sont pas totalement indépendants, peuvent être avancés en faveur de cette présomption6.
Croissance
Plusieurs auteurs ont cherché à tester l’hypothèse d’une relation positive entre le risque boursier et une croissance élevée des entreprises.
Les indices de croissance qui peuvent être retenus sont le taux de croissance des bénéfices, le taux de croissance des actifs et le taux de croissance du chiffre d’affaires.
Activité boursière :
L’activité boursière a été reconnue depuis longtemps par les analystes financiers comme étant un indice du risque d’une action. Lorsque l’activité boursière est importante, le cours des actions risque de fluctuer beaucoup et d’amplifier les variations moyennes du marché.
Risque associé au coût du capital ou risque financier
Il est rare que les moyens mis en œuvre par l’entreprise soient entièrement financés par ses actionnaires. Pour compléter son financement, elle doit le plus souvent utiliser le crédit des banques. Les sommes investies étant différentes, la rentabilité envisagée du point de vue de l’entreprise ou rentabilité économique ne peut donc être la même que la rentabilité intéressant l’actionnaire ou rentabilité financière.
Le risque financier est lié à la nature aléatoire du résultat net qui intègre l’effet du risque d’exploitation et celui du financement. Ainsi et en plus de l’incertitude sur les composantes du résultat d’exploitation vient s’ajouter le poids des charges financières, elles-mêmes fonction du niveau d’endettement.
Pour analyser le risque financier, il convient cette fois d’apprécier ou de connaître le résultat obtenu non pas par unité de capital productif mais par unité de capital investi par les actionnaires (R= Bénéfices nets/Capitaux Propres). 7
Risque d’insolvabilité ou de défaillance
Les deux types de risque précédents sont centrés sur l’analyse de la variabilité du résultat. Les risques envisagés dans ce titre s’intéressent à la qualité de la structure financière et à la capacité d’une entreprise à pouvoir payer ses dettes. Une entreprise est considérée comme solvable si le montant de ses actifs est supérieur à celui de ses dettes.
Pour être viable, l’entreprise devra satisfaire ses besoins d’investissement et de fonds de roulement. La permanence de ces besoins implique la permanence du financement. Autrement dit, le capital économique, constitué par les éléments productifs de l’entreprise ainsi que le fonds de roulement nécessaire à la bonne marche de cette dernière doivent être couverts par des capitaux stables.
Au niveau des états financiers établis par l’entreprise, les capitaux stables nécessaires sont représentés par les capitaux permanents (propres ou empruntés). Le gestionnaire doit donc connaître d’une part la quantité de capitaux stables nécessaires et d’autre part la structure idéale de ces capitaux, c’est-à-dire la répartition entre capitaux propres et capitaux empruntés.
Ainsi, une entreprise ayant largement recours à l’emprunt supportera systématiquement des charges financières (même si la situation de l’entreprise est déficitaire) qu’elle peut ne pas pouvoir honorer si les prévisions de bénéfices ne sont pas réalisées.
Dans cette hypothèse défavorable, la marge brute d’autofinancement comprimée par les frais financiers, ne permet pas à l’entreprise de s’autofinancer, l’entreprise doit alors emprunter davantage et payer de nouveaux frais financiers. Le cercle vicieux se perpétue ainsi jusqu’à la faillite.
En réalité l’endettement présente pour la firme des caractéristiques paradoxales, liées à l’incertitude de l’avenir. D’un côté, comme l’endettement entraîne pour la firme l’obligation stricte de payer des charges financières dont le montant est fixé à l’avance, toute baisse de la rentabilité d’exploitation fait naître pour les actionnaires le risque de ne pas obtenir les dividendes attendus. Ce risque est d’autant plus important que l’endettement soit élevé.
Par ailleurs, comme le montant des charges d’intérêt des emprunts n’est pas lié au résultat d’exploitation, la différence entre le rendement des capitaux investis et le coût des capitaux empruntés profite aux actionnaires. Cet avantage est d’autant plus important que le taux d’endettement est élevé.
Mais la politique d’endettement de l’entreprise n’est pas la seule décision financière à avoir un impact direct sur le risque de son insolvabilité ou de sa défaillance, la seconde décision financière majeure de l’entreprise est la politique de distribution des bénéfices.
Les ratios de structure financière ou d’insolvabilité, permettant l’appréciation d’un tel risque, peuvent être regroupés en trois catégories : ratios de liquidité à long terme, ratios de liquidité à court terme et taux de distribution des dividendes.
Risque de lissage du résultat
En évoquant la notion de risque comptable, on ne peut s’abstenir d’évoquer le risque encouru par l’utilisateur de l’information comptable dans le cas où celle-ci se trouverait entachée d’une erreur de mesure commise lors de l’élaboration des états financiers. L’investisseur est en droit de se demander si les comptes qui lui sont présentés sont correctement établis. L’erreur comptable peut en fait être affectée à n’importe quel poste du bilan. L’analyse financière établie sur ces bases perd alors toute sa signification.
Généralement, le lissage des résultats est défini comme étant un processus par lequel on manipule plusieurs instruments comptables afin de réduire la variabilité des résultats d’une manière permanente. Dans ce sens, « le lissage des résultats est un processus qui diminue les variations du résultat en transférant des sommes d’une année à l’autre ».
On distingue principalement trois moyens ou instruments de lissage des résultats :
- le choix particulier d’une méthode comptable,
- le changement de méthodes comptables,
- le lissage des résultats par le biais des « accruals »8.
Une étude9 menée par des chercheurs tunisiens tentait d’identifier les firmes industrielles tunisiennes qui lissent intentionnellement leurs résultats comptables. Les tests effectués ont montré que 69,56% des firmes de l’échantillon étudié lissent leurs résultats nets par la manipulation des « accruals ».
Dans ce cadre, l’examen des états financiers publiés au cours de la période allant de 1970 à 1989 de 137 entreprises tunisiennes a fait ressortir une évolution régulière de leurs résultats comptables.
________________________
6 U. Ben-Zion et S. Shalit (1975), pp. 1018. ↑
7 Ce type de ratios intéresse surtout les actionnaires car il indique la capacité de l’entreprise à rémunérer les capitaux investis par ces derniers, soit sous forme de dividendes, soit sous forme d’affectation aux réserves qui augmentent la valeur intrinsèque de l’action. ↑
8 Chalayer et Dumontier (1996) définissent les « accruals » comme suit : « Les accruals correspondent aux produits et charges qui n’ont pas généré de flux de trésorerie au cours de l’exercice au titre duquel ils ont été comptabilisés ». Les « accruals » englobent l’ensemble des éléments qui permettent de passer d’une comptabilité de flux à une comptabilité d’engagement. Ils sont représentés par la différence entre le résultat net et les cash-flows générés par l’activité de la firme. ↑
9 MATTOUSSI Hammadi et TRABELSI Samir, « le lissage des résultats : une étude empirique sur un échantillon d’entreprises tunisiennes » – Cahier de Recherches de l’ISCAE « Série Recherches Comptables » N° 1 : Novembre 1998 (p 29-48). ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les risques économiques liés à l’émission de prospectus d’information financière ?
Le risque économique ou risque d’exploitation est lié à la décision d’investissement et à la réalisation d’un revenu ou d’un flux de liquidité futur espéré, sans tenir compte du moyen de financer l’investissement.
Comment le commissaire aux comptes évalue-t-il les risques liés aux prospectus ?
Les auditeurs utilisent un ensemble de mesures pour appréhender les risques liés aux prospectus, en se concentrant sur le public financier, notamment les investisseurs.
Pourquoi est-il important de certifier les prospectus d’information financière ?
La certification des prospectus est essentielle pour faciliter le processus de décision des utilisateurs de l’information financière, comme les investisseurs et les organismes de contrôle.