Les applications pratiques de la lecture révèlent comment l’adaptation cinématographique du Colonel Chabert par Yves Angelo transforme notre compréhension de l’œuvre de Balzac. Cette étude met en lumière des enjeux intertextuels cruciaux, offrant des perspectives nouvelles sur la réception littéraire et cinématographique.
4 Le lecteur et l’acte de la lecture
En adoptant la théorie fondée par w, Iser, Jean Peytard a développé un schéma, nous le reprenons ici en le simplifiant.
[4_applications-pratiques-de-la-lecture-une-analyse-essentielle_1]
Pour Jean Peytard, le texte a trois visés possibles, celle de « l’instance situationnelle » à l’intérieur d’un domaine socio-discursif, une deuxième visée nommée « l’instance ergo-textuelle », qui consiste le travail d’élaboration entre le scripteur et le lecteur et une troisième visée qui porte sur « l’instance textuelle » ou on s’intéresse qu’aux pôles narrateur/narrataire.12
De ce qui précède, nous constatons que, le rôle du lecteur dans le processus de lire et de comprendre un texte littéraire est assez important, en le considérant comme producteur de sens dans le vaste champ littéraire, autrement dit: « la question n’est plus de savoir ce qu’est la littérature comme objet ou comme produit fini, mais ce qu’elle est en tant que projet ou représentation dans la tête de celui qui lit », et cela est apparu clairement grâce foisonnement des théories de réception de Jauss (1978) et de Iser (1985),
11Ibid, p.65
12https://journals.openedition.org/semen/4261, (consulté le 23/4/2019.)
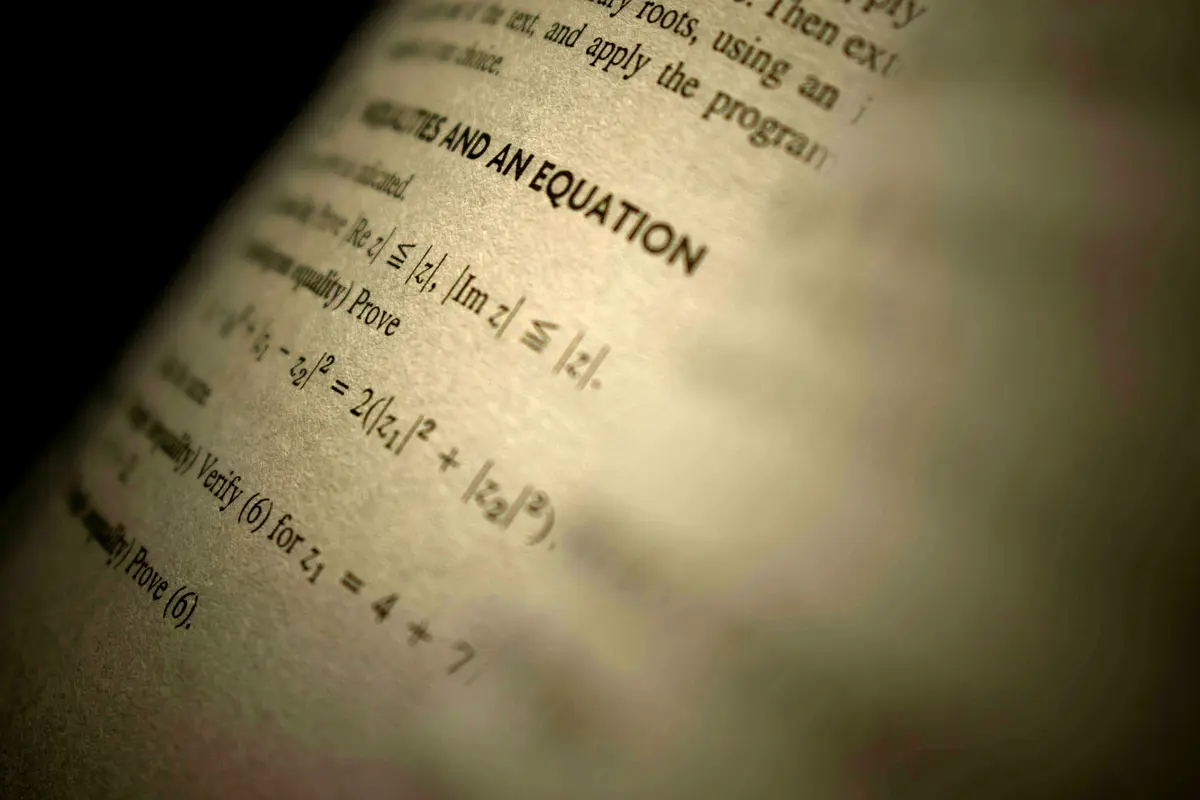
Le rôle du lecteur
Chaque auteur en produisant un texte cherche à trouver un lecteur qui donnera du sens à son écriture. On comprend à partir de là que le texte qui n’est pas lu est un texte mort et c’est au lecteur de le rendre vivant et de le remplir de sens et de significations, en précisant ce rôle Jauss dit que : « la réception des œuvres est donc une appropriation active qui en modifie la valeur et le sens au cours des générations jusqu’au moment présent où nous nous trouvons face à ces œuvres dans notre horizon propre en situation de lecteurs. »
L’interprétation du texte selon un lecteur lui donne la possibilité d’accepter ou de rejeter le contenu de l’œuvre en se basant sur les expériences personnelles, culturelles et sociales déjà vécues, dans ce sens Jauss ajoute : « Le lecteur est tout ensemble (ou tour à tour) celui qui occupe le rôle du récepteur, du discriminant (fonction critique fondamentale qui consiste à retenir ou à rejeter) et, dans certains cas, du producteur, imitant ou interprétant de façon polémique, une œuvre antécédente »
On peut également dire que le texte est incomplet car il est tissu de non-dits et de blancs à remplir C’est pour cela que le lecteur s’acharne à le réactualiser et à l’interpréter, Umberto Eco dit à ce propos : « le texte est en fait une « machine » paresseuse qui exige du lecteur un travail coopératif acharné pour remplir les espaces de non-dit ou de déjà-dit restés en blancs ».
L’acte de la lecture
La lecture d’un texte littéraire consiste à découvrir le sens caché entre ses lignes.
Lire, c’est le fait d’entrer à l’intérieur d’un texte et tenter de le découvrir. Cela explique la relation de dépendance entre le texte et son lecteur.
En effet, le texte et son lecteur sont liés par l’activité de la lecture. Cette dernière donne au texte une valeur esthétique.
Pour Iser l’auteur produit le texte et le lecteur le reproduit en l’interprétant à sa propre manière.
Il affirme que l’œuvre littéraire possède deux pôles principaux : l’un artistique c’est le texte, l’autre esthétique c’est la lecture.
En effet, l’œuvre littéraire ne peut devenir vivante que grâce à sa concrétisation, c’est-à-dire la lecture réalisée par le lecteur, dans cette optique Iser explique : « L’œuvre littéraire possède deux pôles que l’on peut nommer le pôle artistique et le pôle esthétique, le premier étant le texte créé par l’auteur et le second désignant la « concrétisation ». En effet, l’œuvre est plus que le texte, dans la mesure où elle ne devient vivante que grâce à sa concrétisation et que cette dernière n’est à son tour pas totalement indépendante des dispositions que le lecteur met en elle ».
Tout dépend aux conditions qui amènent le lecteur à réagir face au texte lu.
1. La réception du « Le Colonel Chabert » par Yves Angelo
C’est dans le champ d’intertextualité que Julia Kristeva définit comme « tout texte se construit comme mosaïque de citation, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte »13 ou s’inscrit le rapport qui relie deux arts différents, la littérature et le cinéma à travers l’adaptation cinématographique, qui permet de réaliser et de produire de nouvelles matières artistiques.
Avant d’entrer dans cette discipline, on doit aborder les définitions de la littérature et du cinéma, deux arts étroitement liés comme l’indiquent Elisa Bricco et Nancy Murzilly dans les cahiers de Narratologie « On ne peut nier que le rapport entre les arts et la littérature ait toujoursété étroit et n’ait cessé de l’être jusqu’à présent, mais les influences réciproques entre les différentes formes de la création artistique constituent aujourd’hui un champ privilégié de la recherche en littérature et en art parce que ces liaisons se multiplient et acquièrent de nouvelles configurations. »
13 KRISTEVA, Julia, Sémiotiké, Recherche pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, p. 85.
La littérature
Selon le dictionnaire Larousse la littérature c’est l’ensemble d’ouvrage ou de simples écrits produits par un groupe social particulier, ou pour un public ciblé, autrement dit c’est l’art qui réunit la production des œuvres, que ce soit en prose ou en poésie, et la connaissance des romans qui dirigent ces productions.
Le cinéma
Également qualifié de septième art, il est visuel dans sa forme, dans l’intention de créer une image de façon à ce qu’il ne donne pas la possibilité aux spectateurs de développer leur imagination, à ce propos Karine Abadie a défini le cinéma comme «[…] le cinéma relève des arts visuels, car l’on voit le film comme ungénérateur des images qu’il donne à voir, alors que la littérature relève dumonde textuel, tributaire de l’imaginaire du lecteur quant à la créationd’images. »
Au regard de ces deux définitions, on constate que la première a un aspect évasif, elle suggère des pistes d’imagination, cependant la deuxième donne à voir en stérilisant l’imagination car l’image a un aspect directif.
En se référant à ce qui précède, nous constatons que la transposition de l’œuvre de Balzac à l’écran était selon un point de vue interprétatif du réalisateur français Yves Angelo, à l’aide d’une équipe professionnelle d’acteurs et de techniciens en 1994.
________________________
12https://journals.openedition.org/semen/4261, (consulté le 23/4/2019.) ↑
13 KRISTEVA, Julia, Sémiotiké, Recherche pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, p. 85. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quel est le rôle du lecteur dans le processus de lecture?
Le rôle du lecteur dans le processus de lire et de comprendre un texte littéraire est assez important, en le considérant comme producteur de sens dans le vaste champ littéraire.
Comment la lecture transforme un texte littéraire?
La lecture d’un texte littéraire consiste à découvrir le sens caché entre ses lignes, et cela donne au texte une valeur esthétique.
Quelles sont les deux pôles principaux d’une œuvre littéraire selon Iser?
Pour Iser, l’œuvre littéraire possède deux pôles principaux : l’un artistique, c’est le texte, et l’autre esthétique, c’est la lecture.