Les applications pratiques de la fiction révèlent comment l’œuvre d’Alice Zeniter, « L’Art de Perdre », redéfinit notre compréhension de l’Histoire. En transformant des événements tragiques en récits captivants, l’auteure offre une perspective inédite sur les luttes algériennes, enrichissant ainsi le débat sur la valeur de la fiction littéraire.
Le camp de Rivesaltes, un espace de représentation :
Outre le fait que le camp de Rivesaltes est déjà assez connu, vu son Histoire indissociable d’une Histoire dramatique du colonisateur et du colonisé, on distingue que ce qui le rend remarquable, en tant qu’un espace de représentation dans le récit, c’est le changement capital qu’atteignent les évènements qui ont lieu à Rivesaltes.
L’auteure attribue à cet espace une description tout à fait en accord avec ce qu’était Rivesaltes en réalité, et elle se permet de renforcer le côté réel en évoquant une revue historique du camp :
« Elle commence dans un carré de toile et de barbelés.
Le camp Joffre _appelé aussi camp de Rivesaltes_ où, après les longs jours de voyage sans sommeil, arrivent Ali, Yema et leurs trois enfants est un enclos plein de fantômes : ceux des républicains espagnols qui ont fui Franco pour se retrouver parqués ici, ceux des Juifs et des Tziganes que Vichy a raflés dans la zone libre, ceux de quelques prisonniers de guerre d’origine diverse que la dysenterie ou le typhus ont fauchés loin de la ligne de front »35.
Toujours dans le registre effet du réel, nous avons remarqué que l’auteure le renforce par des éléments factuels dont on peut attester de son existence :
« Sur l’une de ces vidéos d’archives, réutilisée dans le documentaire Musulmans de France, de 1904 à nos jours, on peut voir Hamid, minuscule, mais aisément reconnaissable à la
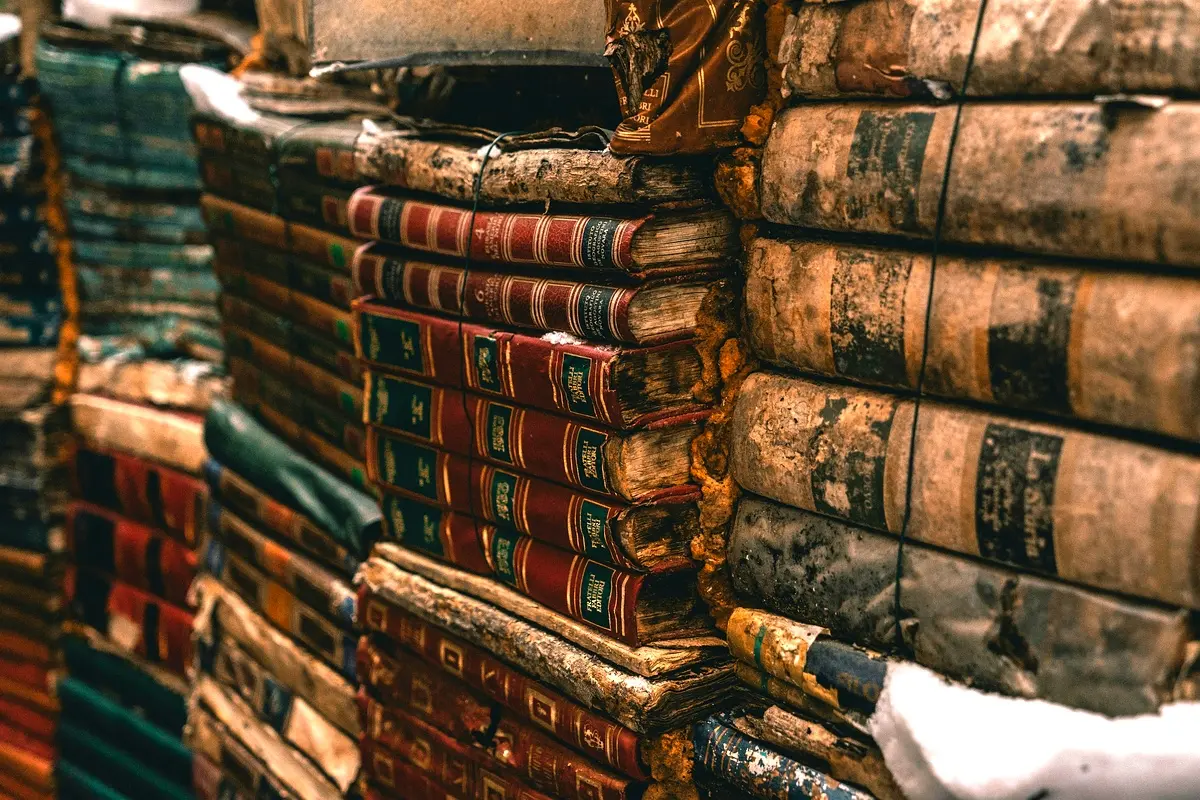
34 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 109.
35 Ibid, p. 193.
paupière légèrement tombante sur son œil gauche, qui s’époumone au milieu d’une cinquantaine d’enfants dans un bâtiment préfabriqué :
On y danse, on y danse
Sur le pont d’Avignon, on y danse tous en rond ! »36
Cependant, la citation précédente nous révèle aussi que même les lieux n’échappent pas à la fiction ; étant donné que Hamid est un personnage fictif, on pourrait affirmer que le réel dans la narration est contaminé par des éléments fictifs, en d’autres termes le rôle de la fiction dans ce cas, c’est d’introduire les personnages dans l’espace de représentation37.
Cela pourrait être dû aux intentions narratives de l’auteure, qui ne voudrait pas borner les espaces à n’être qu’un cadre spatial des évènements ; A. Zeniter nous fait sentir que même l’espace aurait d’autres rôles à assumer, comme celui de peser sur l’état d’esprit des personnages, et particulièrement celui de Hamid : « La tristesse appuie sur sa voix, la maintien dans les fréquences basses, coincé au fond, proche du grondement. ».38
De plus est, l’influence de Rivesaltes sur l’aspect psychique du Hamid favorise la construction d’une histoire très singulière, quand on voit que celui-ci tombera dans le mutisme et l’angoisse et ne pourra plus s’exprimer que pour dire, des années plus tard après le déménagement :
« _on est arrivés en France quand j’étais encore gamin, dit Hamid d’une voix qu’il espère neutre (et le discours qui suit est sans doute plus proche du discours qu’il espère tenir que de celui qu’il tient réellement à ce moment-là, beaucoup plus haché, plus hésitant, et plus obscure). On était dans un camp, on était derrière des barbelés, comme des bêtes nuisibles. Je ne sais plus combien de temps ça a duré. C’était le royaume de la boue. Mes parents ont dit merci. »39
Distinctivement, la période du logement au camp Rivesaltes avait ses effets sur les personnages du roman, l’éloignement et la peur pèsent lourdement sur leurs esprits, la monotonie de l’espace enfermé du camp se reflète fatalement sur la vie des personnages qui se trouvent tiraillés entre un passé effrayant et un avenir incertain aiguisé par la terreur du présent, l’espace insolite et inaccoutumé entraine la chute et la déchéance et réduit l’existence des personnages à une routine éternelle.
Le camp de Rivesaltes bouleverse à nouveau l’ordre du
36 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.200.
37 Louis Marin, le récit, Encyclopédie Universalis2016.
38 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 208.
39 Ibid, p. 398.
récit qui semble s’ingénier à interroger le moindre détail d’une monotone vie quotidienne, après avoir y été question de la guerre et d’évènement.
A. Zeniter nous donne l’impression que même l’organisation des évènements du récit file à travers les sillons de cet espace réel d’une vocation fictionnelle, un espace assez distinct là où submerge le temps anachronique, les personnages et les actions inanimées avec l’art du beau langage pour accueillir une hétérogénéité humaine qui ne reflète aucune diversité pour la simple raison qu’a cité l’auteure :
« C’est un lieu pour les hommes qui n’ont pas d’Histoire, car aucune des nations qui pourraient leur en offrir une ne veut les y intégrer. ».40
En revanche, l’espace ne se met en évidence qu’à l’aide du récit, de même que la dimension symbolique et la signification de camp Rivesaltes n’étaient qu’un fruit de l’interaction avec les personnages, tout acte est un paradoxe par rapport aux règles du camp, telle une façon de refuser la pauvreté et chasser la misère, alors que l’espace évolue, s’adapte et même se concilie aux individualités des personnages :
« On fait une place à Messaoud dans la tente déjà surpeuplée pour lui éviter une installation dans le quartier des célibataires et la soirée prend des airs de fête. Ali et Yema veulent partager avec lui tout ce qui constitue le peu qu’ils ont. ».41
C’est ainsi que ce qu’on a appelé le paradoxe, dans un espace fermé et destructif les personnages de notre récit encensent plus leur vie et encore moins le lieu dans lequel ils évoluent, en aménageant le camp et, plus profondément, en cherchant à rétablir une hiérarchie familiale perdue, faute d’activité, là où Ali et Yema sont les piliers, les personnages veulent dire, en somme, qu’on cherche à vivre et qu’on ne se contente pas de survivre.
La stratégie choisie par l’auteure pour réconcilier l’espace avec les individualités des personnages trahit l’aspect du réel et penche davantage vers la fiction, on pourrait dire que la personnification des personnages et le sujet imposent le choix d’espace, ainsi dans le cas de Ali, pour lui faire atteindre l’effondrement, lui l’homme de montagne, l’auteure aurait dû choisir un lieu enfermé et imposant tel que le camp de Rivesaltes.
40 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 194.
41 Ibid, p. 212.
________________________
34 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 109. ↑
36 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.200. ↑
37 Louis Marin, le récit, Encyclopédie Universalis2016. ↑
38 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 208. ↑
40 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 194. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment Alice Zeniter utilise-t-elle le camp de Rivesaltes dans son roman ?
L’auteure attribue au camp de Rivesaltes une description en accord avec sa réalité historique et renforce le côté réel en évoquant une revue historique du camp.
Quel est l’impact du camp de Rivesaltes sur les personnages du roman ?
La période de logement au camp Rivesaltes a des effets sur les personnages, l’éloignement et la peur pèsent lourdement sur leurs esprits, et la monotonie de l’espace enfermé se reflète sur leur vie.
Quelle est la relation entre fiction et réalité dans ‘L’Art de Perdre’ ?
La narration révèle que même les lieux n’échappent pas à la fiction, introduisant des personnages fictifs dans des espaces de représentation, ce qui montre que le réel est contaminé par des éléments fictifs.