Les applications pratiques de gestion fiscale révèlent des résultats surprenants sur la pérennité des PME camerounaises. En analysant le cas de BKOUASS-Sarl, cette étude met en lumière des stratégies essentielles pour prévenir les risques fiscaux, transformant ainsi la compréhension des enjeux fiscaux dans le contexte local.
1.3. Caractéristiques, attributs et typologie liés au risque fiscal
Au regard de l’absence d’une définition qui englobe tous les aspects du risque fiscal, il convient d’analyser ses caractéristiques générales, ses attributs et sa typologie pour pouvoir avoir une définition aussi précise que complète.
11
1.3.1. Caractéristiques générales du risque fiscal
En effet, le non-respect des dispositions fiscales peut être involontaire comme il peut résulter de la volonté délibérée du contribuable. Dans ce cadre, il conviendra d’analyser ces deux aspects.
1.3.1.1. Risque fiscal involontaire
Si le risque fiscal est involontaire, il peut résulter dans ce cas d’une simple erreur dans l’application des règles fiscales ou d’une ignorance de dispositions fiscales favorables pour l’entreprise. Selon Cozian (2008, p. 549), « tout le monde peut se tromper, y compris l’administration surtout quand il s’agit du maniement de textes fiscaux dont la clarté n’est pas toujours la qualité première.
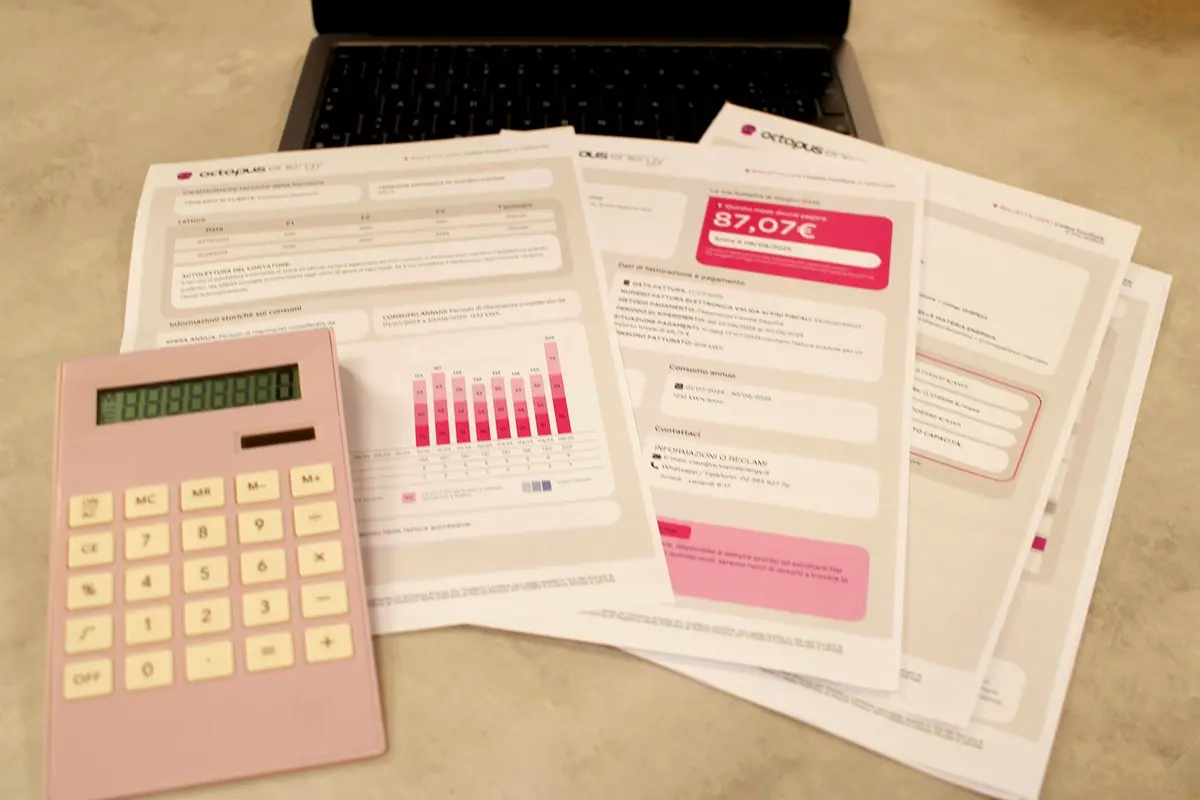
L’administration peut évidemment rectifier les erreurs commises et notifier les rappels d’impôt correspondants. Comme le contribuable est présumé de bonne foi, il n’encourt aucune sanction. Il supporte simplement l’intérêt de retard de 0,30% par mois, qui n’est pas une pénalité, mais le coût du crédit forcé octroyé par le trésor ».
Ainsi, lorsque le contribuable se trompe involontairement dans l’application des règles fiscales, il n’encourt pas de sanctions fiscales mais supportera le paiement de pénalités dues au retard dans l’acquittement de l’impôt dû.
Dans le deuxième cas, le contribuable n’a pas pu bénéficier d’une disposition fiscale avantageuse étant donné qu’il n’en a pas eu connaissance. Ceci peut avoir comme cause l’incompétence du personnel fiscal de l’entreprise ou le changement fréquent de la législation fiscale…
Le risque fiscal involontaire peut ainsi prendre la forme d’une simple erreur ou d’une méconnaissance des avantages fiscaux. La situation devient plus complexe lorsque le caractère volontaire est introduit dans l’étude du risque fiscal.
1.3.1.2. Risque fiscal volontaire
Le risque fiscal volontaire peut résulter, selon Rossignol (2002a), soit du non-respect intentionnel de la réglementation fiscale, soit d’un non bénéfice voulu des avantages fiscaux. D’un côté, l’entreprise peut renoncer au bénéfice des avantages fiscaux dans le but de ne pas attirer l’attention de l’administration fiscale sur certains faits.
D’un autre côté, si le non-respect des règles fiscales est volontaire, il résulte dans ce cas d’une volonté délibérée d’échapper à la loi par des procédés illégaux, et s’appelle une fraude fiscale.
D’autres notions évoquent la volonté du contribuable et s’apparentent aussi à la fraude. Elles diffèrent selon le pays d’étude. Pour éviter des confusions de terminologie liées à l’étude du risque fiscal, il est indispensable de définir les notions en se plaçant dans le contexte de notre étude.
S’agissant du contexte camerounais, le législateur semble se contenter d’utiliser le seul terme de fraude et d’évitement fiscal dans les textes législatifs. Ces termes désignent toute intention délibérée d’échapper à l’impôt en violant les dispositions réglementaires.
⮚ Notion de fraude fiscale et évasion fiscale
La fraude fiscale est définie par Rossignol et Chadefaux (2001, p. 16) comme étant « l’action qui consiste à se soustraire ou à tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt. Cette fraude constitue un délit qui, pour être caractérisé en tant que tel, repose sur une intention délibérée ».
Selon Cozian (2008, p. 549), « il y a fraude lorsque le contribuable viole, de façon délibérée et éhontée, les prescriptions de la loi fiscale. Il ne déclare pas les bénéfices ou le chiffre d’affaires qu’il a réalisé, il déduit des charges qu’il n’a pas payé, sa comptabilité est truquée… ».
Bazart (2005) a présenté un schéma des différents comportements en commençant par l’honnêteté et en allant vers la fraude tout en passant par les notions d’habileté, d’évasion admise et d’évasion refusée (figure 2).
13
Figure 2 : De l’honnêteté à la fraude un continuum de comportements
[4_applications-pratiques-de-gestion-fiscale-pour-pme_2]
Source : Bazard, (2005, p. 17)
La notion d’évasion fiscale est définie différemment par Deboissy et Cozian (2010, p. 675) qui la considèrent comme « le fait d’échapper, totalement ou partiellement, à l’impôt en utilisant des procédés ou des montages licites. Elle se confond dès lors avec l’habileté fiscale ».
Dans le même sens, Heckly (1987, p. 209) précise que « l’évasion fiscale constitue une sorte de fraude légale dans la mesure où elle consiste, pour le contribuable, à profiter de faveurs fiscales décidées par les pouvoirs publics pour infléchir son comportement » mais souligne que « souvent, l’opinion publique ne fait pas la différence entre la fraude et l’évasion fiscales ».
La fraude fiscale est un délit pénal punissable d’amende et de prison. Le dispositif législatif camerounais anti-fraude fiscal englobe un ensemble de dispositions prévues aussi bien par le code général des impôts que par le code pénal.
Il s’agit des articles allant de L 107 à L 114. Et aussi, le dispositif législatif anti-fraude/évasion se renforce d’avantage à travers ce décret signé du Président de République en 2014 comme l’indique le document en annexe 1.
D’autres notions entourent la notion de fraude fiscale. Ces notions diffèrent aussi selon le contexte d’étude
⮚ Notions voisines de la fraude fiscale
Ces notions sont l’abus de droit et l’acte anormal de gestion
14
– Notion d’acte anormal de gestion
L’administration fiscale peut contester un choix fiscal effectué dès lors que ce choix est contraire à l’intérêt de l’entreprise.
« Est anormal l’acte qui est accompli dans l’intérêt non de la société, mais d’un tiers (exemple : renoncer à percevoir des recettes sans contrepartie et sans justification, supporter des charges dans l’intérêt d’un tiers, dépenses exagérées) »
– Notion d’abus de droit
L’abus de droit désigne la volonté d’échapper à l’impôt par des procédures juridiques artificielles, c’est un trucage réalisé par des juristes, une forme de manipulation par ceux qui comprennent trop bien le droit fiscal, c’est-à-dire la fiscalité en tant que science.
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les caractéristiques du risque fiscal involontaire?
Le risque fiscal involontaire peut résulter d’une simple erreur dans l’application des règles fiscales ou d’une ignorance de dispositions fiscales favorables pour l’entreprise.
Comment se manifeste le risque fiscal volontaire?
Le risque fiscal volontaire peut résulter du non-respect intentionnel de la réglementation fiscale ou d’un non bénéfice voulu des avantages fiscaux.
Quelle est la définition de la fraude fiscale?
La fraude fiscale est définie comme l’action qui consiste à se soustraire ou à tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt.
