L’analyse de corpus linguistique révèle que le français est perçu comme un outil de communication essentiel parmi les étudiants subsahariens à Constantine. Ces résultats surprenants soulignent l’importance du français dans un contexte de diversité culturelle, avec des implications significatives pour l’intégration linguistique et sociale.
Présentation et description du corpus
Tout d’abord nous tenons en premier lieux à définir le corpus qui selon Galisson et Coste (1976 : 131) « est un ensemble fini d’énoncés pris pour objet d’analyse. Plus particulière- ment, ensemble fini d’énoncés considérés comme caractéristiques du type de langue a étudié.
» .
Nous citons aussi Dubois et Al (1973 : 128), selon qui le corpus : « un ensemble d’énoncés ou de phrases comprenant des mots présentant un trait phonétique ou une origine étrangère ». Ils reprennent plus loin que le corpus est un : « Ensemble d’énoncés qu’on soumet à l’analyse
». (Dubois et al. 2001 : 123).
Partant donc de ces définitions et considérant qu’il existe différents types de corpus nous te- nons à définir notre corpus. Ainsi dans le cas de notre recherche nous avons deux types de corpus que nous allons soumettre à l’analyse un peu plus loin à savoir un corpus écrit qui est le questionnaire destinés aux étudiants subsahariens résidants dans les résidences de l’université Salah Boubnider et un autre oral , c’est-à-dire leurs productions orales, que nous avons enregistrées. Ainsi notre corpus écrit fera l’objet d’une étude quantitative et le corpus oral l’objet d’une étude qualitative.
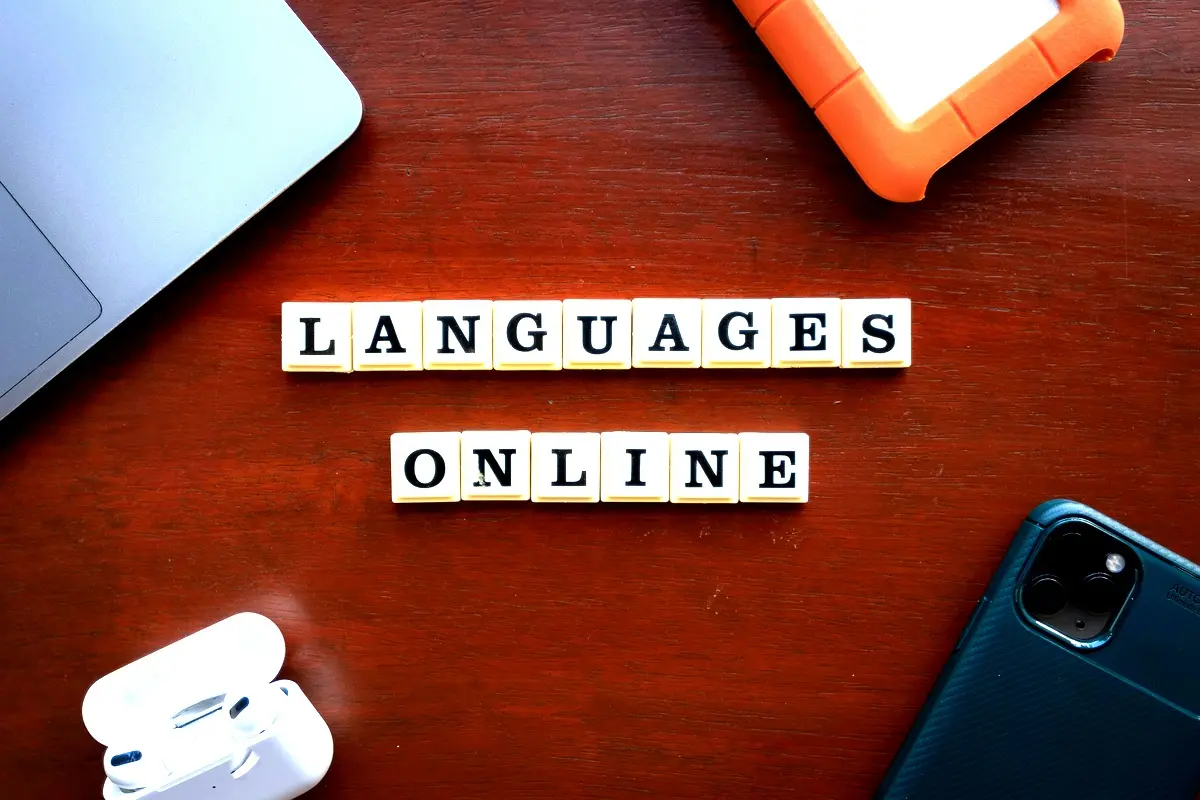
De ce fait nous allons donc procéder à la présentation et la description de l’ensemble de nos deux corpus dans les points suivants.
Notre questionnaire
Comme l’a affirmé donc CALVET, le questionnaire est un des instruments de recherche mis à contribution par la sociolinguistique, nous avons eu recours à celui-ci pour mener notre en- quête dans le cadre de notre travail de recherche.
En effet nous avons soumis notre questionnaire à trente-cinq questionnés qui ont constitué notre échantillon. Il s’agit d’un questionnaire auto-administré et élaboré de manière structurée pour recueillir des données suffisantes qui nous permettrons par la suite de confirmer nos hypothèses. Le dit questionnaire comme nous l’avons évoqué un peu plus haut fut soumis à nos enquêtés pendant la période allant du 20 Avril au 22 Mai 2021 via Internet parce qu’il s’agit d’un questionnaire en ligne (GoogleForms).
Après élaboration de notre questionnaire rédigé en langue française, sur le site GoogleForms (https://docs.google.com/forms/u/0/), nous avons passé à son administration à nos informa- teurs. Nous nous sommes donc servis des réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook et Messenger afin de partager le lien de notre questionnaire qui est le suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCfgaEtCEGtxN23bqgvm8XjVzbjTaFHlPatPs FKumfoc2sQ/viewform?usp=pp_url .
Nous tenons à souligner aussi que notre questionnaire est subdivisé en deux sections :
- En premier lieu, les questions portant sur l’identification socioculturelle et professio n- nelle de nos informateurs (nationalité, âge, sexe, niveau d’étude et lieu de résidences) ;
- Et un ensemble de questions sur le répertoire linguistique des enquêtés (langue mater- nelle, langues qu’ils parlent et comprennent, langue de scolarisation ou d’étude, la langue officielle de leurs pays respectifs…) ; sur la pratique et le degré d’usage de la langue française qui d’ailleurs est le principal objet de notre recherche ; sur leurs choix linguistiques lors des interaction avec leurs camarades étrangers ou même l’administration de leurs résidences respectives, face à un inconnu dans ces mêmes ré- sidences et enfin des question portant sur les représentations et les attitudes qu’ont ces questionnés vis-à-vis de la langue française.
Enfin ce questionnaire que nous avons administré à nos questionnés comprend au total 22 questions fermées, semi-ouvertes et ouvertes, dont parmi les questions semi-ouvertes et ou- vertes deux portent respectivement sur les représentations et attitudes vis-à-vis de la langue française, il s’agit de la 12e et de la 20e question.
Tableau 1 : échantillon des étudiants subsahariens auxquels nous avons admi- nistré notre questionnaire par résidences :
| Tableau 1 : échantillon des étudiants subsahariens | |
|---|---|
| Parameter/Criteria | Description/Value |
| Type de corpus | Corpus écrit et oral |
| Nombre de questions | 22 questions |
Les enregistrements audio
Toujours dans le cadre de notre recherche, afin de confirmer ce qu’ont affirmé nos informa- teurs dans le questionnaire qui leur a été administré au départ et d’avoir une idée des langues utilisées par ces locuteurs lors des interactions au sein de ces résidences, nous avons envisagé d’effectuer quelques enregistrements. En effet nous nous sommes personnellement servis du dictaphone de notre téléphone portable afin d’effectuer ces enregistrements au niveau des résidences des garçons, nous nous sommes intéressés sur la résidence Ain El Bey 02 tout en profitant de notre appartenance à cette dernière. Là nous avons enregistré des échanges entre un locuteur ghanéen (anglophone) et un autre nigérien (francophone) lors d’une séance de coiffure. À ceux-là s’ajoutent d’autres.
En revanche au niveau des résidences des filles, compte tenu de l’inaccessibilité à celles-ci, nous avons délégué une de nos condisciples résidant à la résidence Ain El Bey 03 pour nous effectuer ces enregistrements. Celle-ci a aussi enregistré des échanges entre deux interlocu- trices nigériennes et une autre malienne à l’aide du dictaphone de son téléphone aussi, elle nous les a envoyés par la suite via le réseau social WhatsApp. L’ensemble de ces enregistre- ments fera par la suite l’objet d’une transcription orthographique.
Nous tenons aussi à souligner que nous avons effectué ces enregistrements avec l’accord de notre public. Nous avons informé ce dernier que nous comptons enregistrer leurs interactions pendants quelques minutes dans le cadre d’une étude, mais nous n’avons pas précisé quand nous allons le faire exactement afin de recueillir des productions orales naturelles que nous allons soumettre à la transcription comme nous l’avons évoqué ci-dessus puis à l’analyse.
Tableau 2 : enregistrements effectués et leurs durées.
| Tableau 2 : enregistrements effectués | |
|---|---|
| Parameter/Criteria | Description/Value |
| Type d’enregistrement | Audio |
| Durée | Variable selon les échanges |
Protocole de transcription :
La transcription est généralement une tâche délicate qui nécessite beaucoup d’attention de la part du transcripteur. Nous concernant, elle fut une opération pénible qui nous a demandé des heures de travail où nous avons écouté nos enregistrements à maintes reprises afin de mener à bien cette tâche. À cet effet, nous nous sommes inspirés de deux systèmes, celui de CLAIRE BLANCHE BENVENISTE et celui de D.MORSLY tous les deux cités par BENDIEB
ABERKANE MEHDI dans son projet présenté en vue de l’obtention du diplôme de docto- rat.29
Tableau 3 : Protocole de transcription.
| Tableau 3 : Protocole de transcription | |
|---|---|
| Parameter/Criteria | Description/Value |
| Système de transcription | CLAIRE BLANCHE BENVENISTE et D.MORSLY |
| Durée de transcription | Variable selon les enregistrements |
29BENDIEB, M. (2016). Norme et variation dans l’enseignement du français langue étrangère en Algérie. Thèse de Doctorat. Université des frères MENTOURI Constantine.
Conclusion partielle
En conclusion, dans ce chapitre nous avons évoqué les différentes techniques d’investigation et méthodes auxquelles nous avons fait recours et qui nous ont aiguillées tout au long de notre recherche. Cela dit, nous avons justifié ce recours à deux méthodes d’enquête, à savoir le questionnaire et l’enregistrement. De plus, nous avons aussi présenté et décrit notre corpus avant de le soumettre à l’analyse qui sera d’ailleurs le point que nous allons soulever dans le chapitre à venir.
________________________
29BENDIEB, M. (2016). Norme et variation dans l’enseignement du français langue étrangère en Algérie. Thèse de Doctorat. Université des frères MENTOURI Constantine. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quel est le statut du français chez les étudiants subsahariens à Constantine?
Le français est perçu comme un outil de communication essentiel et est la langue la plus utilisée parmi les étudiants subsahariens dans les résidences universitaires de Constantine.
Comment a été élaboré le questionnaire pour l’étude?
Le questionnaire a été élaboré de manière structurée et soumis à trente-cinq étudiants subsahariens via Internet entre le 20 avril et le 22 mai 2021.
Quels types de corpus ont été analysés dans cette recherche?
Deux types de corpus ont été analysés : un corpus écrit constitué du questionnaire et un corpus oral basé sur les productions orales des étudiants enregistrées.
