L’analyse comparative du mariage en RDC révèle une réalité troublante : la répression insuffisante du mariage forcé, souvent éclipsée par d’autres infractions sexuelles. Cette étude met en lumière les conséquences socio-juridiques de cette négligence, appelant à une réforme urgente pour protéger les droits des femmes.
Chapitre Premier
DU MARIAGE EN DROIT CONGOLAIS
Nous examinerons dans ce chapitre d’une part, la définition, le but et la nature juridique du terme mariage, lequel, au vu de la société et surtout du code de la famille, apparaît être la seule base légale d’existence d’un coupe (section 1ière) ; et de l’autre part, nous entamerons également les conditions de fond et de forme de l’existence du mariage, sans le respect desquelles, le mariage paraît, dans une certaine mesure, être frappé d’une nullité absolue qui, de surcroît, conduirait directement et simplement à l’annulation du mariage (section 2ième).
Au finish, nous bouclerons ce chapitre ayant trait au mariage par épingler les effets ou les différentes conséquences que peut engendrer le mariage après sa conclusion (section 3ième).
Section Première :
Définitions, but et nature juridique du mariage
Paragraphe 1. Notions du mariage
Point 1. Définitions
De manière traditionnelle, le mariage est défini comme une union légitime d’un homme et d’une femme. C’est l’acte officiel et solennel qui institue, entre les époux ou partenaires, une communauté de patrimoine et de renommée appelée « foyer » dont le but est de façon durable un cadre de vie commune aux parentes et enfants pour leur éducation.24
A Rome, le mariage s’aperçoit comme une union de l’homme et de la femme destinée à durer toute la vie. C’est ainsi que Portalis décrit le mariage comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par les secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée ».25
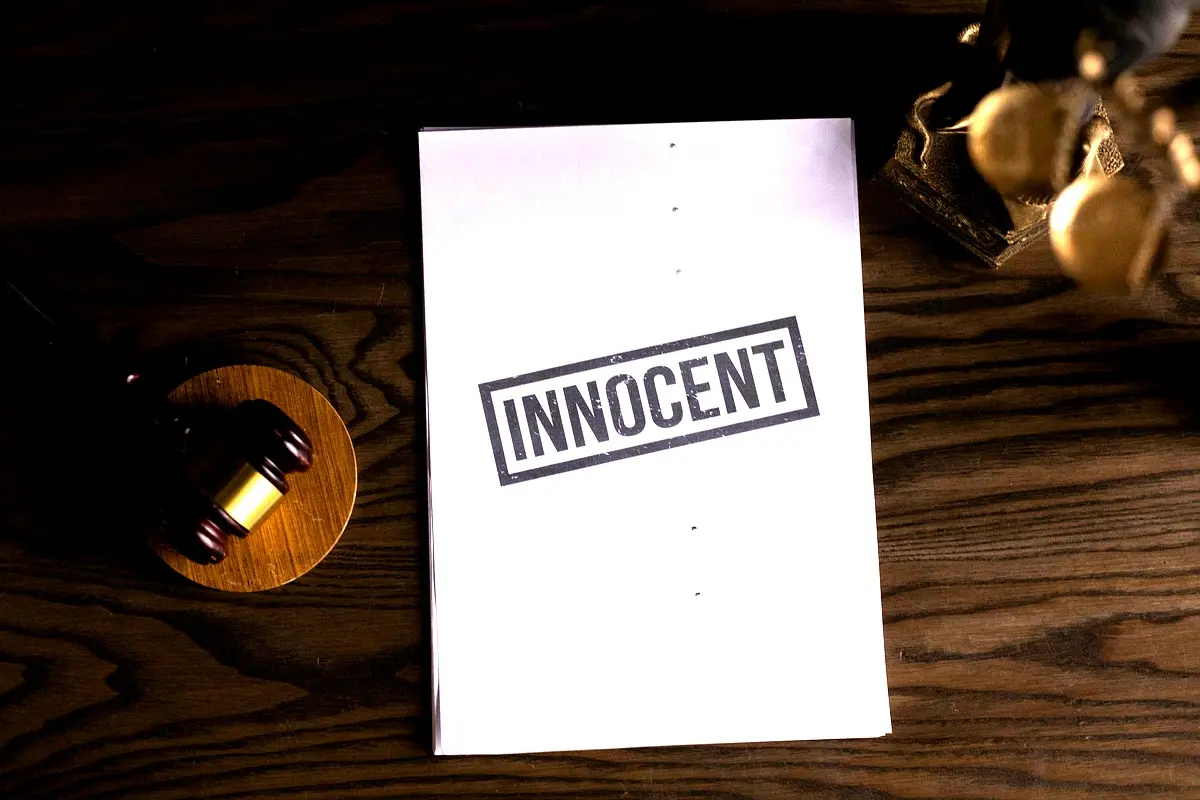
Le mariage est également perçu, de manière générale, comme l’union d’un homme et d’une femme dans l’intention de vivre ensemble. Mais c’est une institution solennelle qui s’articule autour des règles préétablies bien qu’elle implique une part importante de volontés individuelles.26
De ce fait, il nous paraît important voire indispensable de signaler à ce stade qu’en Droit congolais, la définition du mariage est donnée par l’article 330 du code de la famille qui dispose « le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, qui ne se sont engagés, ni l’un ni l’autre, dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. »
24 A lire sur https://www.legavox/boysson.com consulté le 14 mars 2020, à 21h03min.
25Voir THERY I. et BIET C., Portalis ou l’esprit des siècles, cité par MALAURIE P. et FUCHIRON, Droit civil, la famille, 2ième éd., Defrenos, Paris, 2006, p.52, cité par KIFWABALA TEKILAZAYA J.-P., op. cit., p.119.
26 Ibid.
En effet, nous remarquons avec consternation dans les définitions ci-haut indiquées, des auteurs précités et surtout du code de la famille une incohérence ou pour mieux dire un manque d’un élément important et capital que devrait contenir la définition du concept mariage. Il s’agit ici du consentement que doivent émettre personnellement l‘homme et la femme qui souhaiteraient devenir partenaires ou époux unis par les liens du mariage car, lorsque le législateur congolais indique à l’article 330 du code sus-évoqué que le mariage est une union
entre l‘homme et la femme, il ne fait que confirmer l’une des conditions naturelles de l’existence du mariage prévue par la loi. Cette condition dont fait montre le législateur congolais n’est autre que la différence de sexe entre les deux époux et dans ce cas, il ne fait pas du tout allusion ou référence à la condition préalable qu’est le consentement au mariage alors que cette dernière condition étant indispensable devrait, à tout prix, être reprise dans les prescrits de l’article 330 du code de
la famille.
C’est dans ce sens que nous définissons le mariage comme une union entre deux individus de sexes opposés, ayant atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis qui, ayant personnellement émis leur consentement libre et éclairé, s’obligent à s’unir par les liens d’un mariage légal et durable bien réglementés par la loi.
Point 2. Liberté du mariage ou droit au mariage
Le mariage est une liberté fondamentale et étant comme telle, les atteintes à la liberté du mariage doivent être strictement nécessaires et contrôlées, mais elles peuvent tout de même exister si elles sont justifiées par un intérêt essentiel, suffisamment important pour justifier une atteinte à une liberté fondamentale.27
Il existe plusieurs exemples d’atteintes à la liberté de se marier : l’âge, la protection des majeurs incapables, l’interdiction de la polygamie… il existe aussi des exemples d’atteintes à la liberté de choisir son conjoint : les empêchements en raison des liens de parenté ou d’alliance, la nécessité de la différence de sexe qui interdit le mariage homosexuel…
En revanche, il n’existe aucune restriction à la liberté de se marier tenant à la nationalité ou même au séjour irrégulier. Un étranger en situation irrégulière a parfaitement le droit de se marier, et l’en empêcher constitue une atteinte à une liberté fondamentale.28
La liberté du mariage suppose aussi la liberté de ne pas se marier. C’est pourquoi, en principe, une clause de célibat dans un contrat est nulle car contraire à l’ordre public. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent la justifier (ex. : Affaire du cours Sainte-Marthe, Cour de cassation, Assemblée plénière du 19 mai 1978 : les juges ont estimé que les convictions religieuses ont été un élément important lors du recrutement. De ce fait, le licenciement de l’enseignante divorcée qui s’était remariée n’était pas abusif).29
La liberté de ne pas se marier justifie aussi la qualification des fiançailles de fait juridique. La jurisprudence refuse de voir dans les fiançailles un contrat, car cela supposerait une obligation
27 DIONISI PEYRUSSE A., Droit civil : les personnes, la famille, les biens, Tome 1, CNFPT, Paris, 2007, p.52.
28 Ibid.
29 DIONISI PEYRUSSE A., op. cit., p.53.
de se marier qui irait à l’encontre de la liberté de ne pas se marier. Dans le même ordre d’idée, les juges considèrent que la rupture de fiançailles n’est pas une faute. Toutefois, afin de pouvoir accorder des dommages et intérêts lorsque la situation est particulière, les juges admettent que les circonstances de la rupture peuvent être fautives. La rupture en elle-même n’est pas une faute, mais elle peut avoir été l’occasion de commettre une faute. C’est le cas par exemple lorsque l’un des fiancés disparaît sans explication la veille du mariage, laissant les frais de cérémonie à la charge de l’autre.
Paragraphe 2. But du mariage
Parler du but du mariage revient à se poser la question de savoir pour quel motif ou finalité l’homme et la femme se marient-ils ? Et pour y répondre, nous estimons, en effet, que la loi précise le but du mariage entre l’homme et la femme pour leur union dans le mariage. Ainsi, l’article 349 du code de la famille dispose que : « le but du mariage est de créer une union entre l’homme et la femme qui s’engagent à vivre ensemble jusqu’au décès de l’un d’entre eux, pour partager leur commune destinée et perpétuer leur espèce ».
En effet, le mariage entre l’homme et la femme a une symbolique bien ancrée. De nos jours, les futurs mariés ne se marient plus par obligation sociale ou religieuse. Néanmoins, les traditions se perpétuent dans le temps. En plus de se présenter l’amour entre deux personnes, le mariage, est un réel engagement dans une vie commune qui implique des droits et des obligations.
C’est pourquoi, outre l’importance du mariage aux yeux des mariés, plusieurs raisons poussent deux individus à s’engager ensemble. D’abord, pour célébrer leur amour aux yeux de tous car le mariage est avant tout un acte d’amour réunissant deux personnes de sexes opposés qui vivent une réelle complicité et qui souhaitent s’engager sur le long terme. Le mariage est également le moment propice pour réunir tous les proches des mariés et ainsi exposer leur amour au grand jour.
Ensuite et enfin, le mariage a pour finalité de créer une alliance éternelle entre les deux partenaires. Les deux aimés s’engagent à rester soudés et unis dans les bons comme dans les pires moments.
Par ailleurs, de tout ce qui précède, nous pensons que le but ultime entre l’homme et la femme serait celui de vivre ensemble sous un même toit conjugal. C’est-à-dire chacun des époux après célébration du mariage doit quitter le toit parental pour regagner le toit conjugal et y vivre avec son partenaire dans le simple objectif pour les deux conjoints, de partager leur commune destinée et de perpétuer leur espèce c’est-à-dire faire des enfants.
Toutefois, cet objectif entre l’homme et la femme ne pourrait être atteint que lorsqu’avant la célébration dudit mariage, il y a eu accord de volonté bien éclairé entre les deux futurs conjoints qui se sont décidés d’eux-mêmes c’est-à-dire en émettant leur propre consentement exempt de vices à se prendre pour mari et femme. Cela revient à dire que lorsque les deux partenaires ont subi des violences ou menaces ou ont été contraints de se marier, même le but pour lequel l’homme et la femme parviennent à se marier ne pourrait jamais être réalisé et de surcroit, il n’y aurait guère d’amour, à proprement parler, entre les deux conjoints contraints
au mariage et le foyer conjugal pourrait se trouver buté à des graves problèmes conjugaux qui conduiraient, par la suite, au divorce.
________________________
24 A lire sur https://www.legavox/boysson.com consulté le 14 mars 2020, à 21h03min. ↑
25Voir THERY I. et BIET C., Portalis ou l’esprit des siècles, cité par MALAURIE P. et FUCHIRON, Droit civil, la famille, 2ième éd., Defrenos, Paris, 2006, p.52, cité par KIFWABALA TEKILAZAYA J.-P., op. cit., p.119. ↑
27 DIONISI PEYRUSSE A., Droit civil : les personnes, la famille, les biens, Tome 1, CNFPT, Paris, 2007, p.52. ↑
29 DIONISI PEYRUSSE A., op. cit., p.53. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la définition du mariage en droit congolais?
En Droit congolais, la définition du mariage est donnée par l’article 330 du code de la famille qui dispose « le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, qui ne se sont engagés, ni l’un ni l’autre, dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi ».
Quels sont les éléments essentiels de l’existence du mariage?
Les éléments essentiels de l’existence du mariage incluent le consentement libre et éclairé des deux individus, la différence de sexe entre les époux, et le respect des conditions de fond et de forme prévues par la loi.
Quels sont les effets du mariage après sa conclusion?
Les effets ou les différentes conséquences que peut engendrer le mariage après sa conclusion sont abordés dans le chapitre, mais les détails spécifiques ne sont pas fournis dans l’extrait.