L’analyse comparative du français véhiculaire révèle que 85 % des étudiants subsahariens à l’Université Salah Boubnider utilisent cette langue comme principal moyen de communication. Ces résultats transforment notre compréhension du rôle du français dans un contexte multiculturel, soulignant son importance cruciale dans les résidences universitaires.
Chapitre III :
Analyse des corpus et présentation des résultats
Introduction
Après avoir défini l’aspect théorique de notre travail de recherche et déterminé les différentes techniques d’investigation auxquelles nous avons recouru afin de recueillir les données nécessaires, nous allons dans ce chapitre présenter l’analyse de ces données recueillies. Ces dernières obtenues par le biais du questionnaire que nous avons soumis à nos enquêtés et aussi par le biais de leurs productions orales que nous avons enregistrées feront respectivement l’objet d’une analyse quantitative et qualitative.
Ces deux approches complémentaires nous permettrons de confirmer ou d’infirmer les hypothèses que nous avons émises au départ.
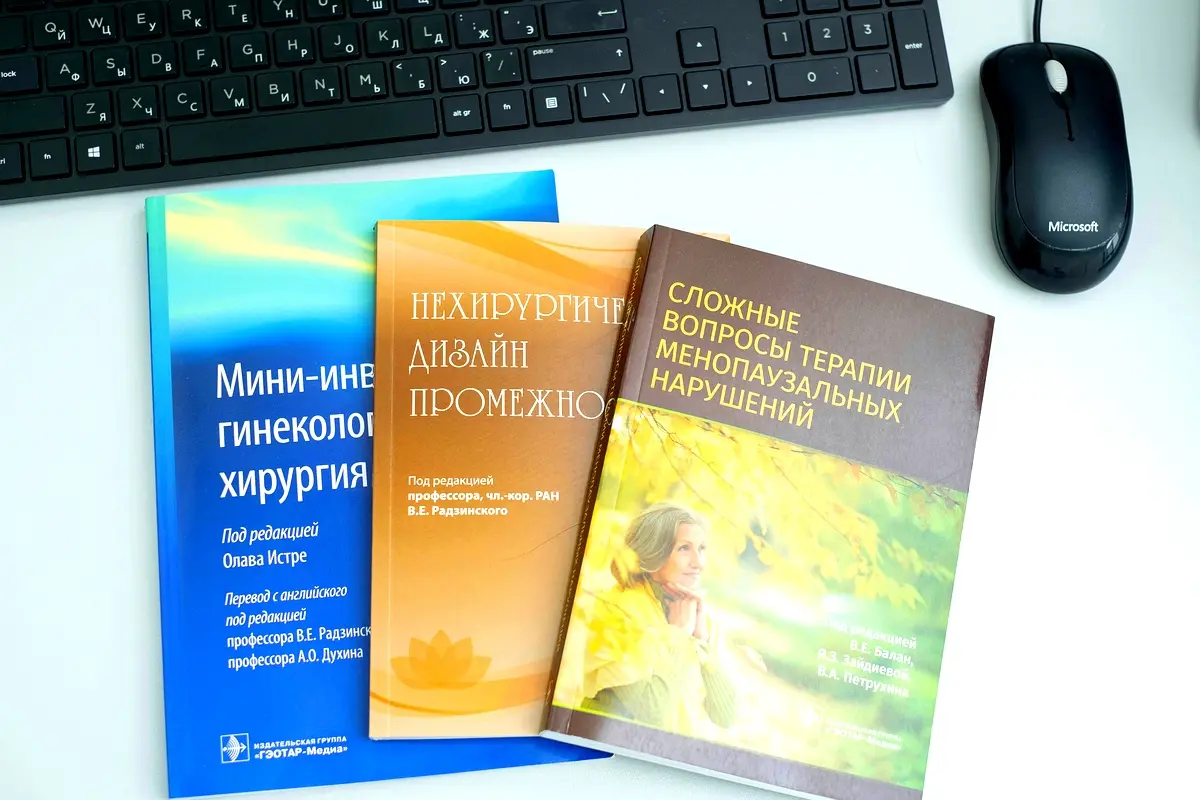
Résultats et Analyse du Questionnaire
Nous allons en premier lieu laisser la primauté et la priorité à l’analyse quantitative, celle du questionnaire donc.
Ci-dessous nous avons établi une grille d’analyse du dit questionnaire :
Tableau 4 : Grille d’Analyse du questionnaire.
L’usage de la langue française au sein des résidences de l’Université Salah Boubnider chez les étudiants subsahariens | |||||
Usage véhiculaire du français. | Insécurité Linguistique. | Degré d’usage du français/ Représentation et attitude vis-à-vis de la langue française. | Contact des langues. | ||
Items | |||||
L’usage linguis- tique de nos ques- tionnés :
| L’usage lin- guistique en premier face à un inconnu. | Fréquence de l’utilisation de langue française. Ce que représente la langue française pour nos enquêtés. | Enceinte plu- rilingue : Différentes langues offi- cielles des en- quêtés. | ||
| Attitude des en- quêtés vis-à-vis de cette langue. | Plusieurs langues en présences (langues ma- ternelles). Autres langues qu’utilisent ces locuteurs ex- cepté le fran- çais. | |||
L’usage du français lorsque son interlo- cuteur ne parle pas sa langue. | Alternance codique lors des interac- tions. | ||||
Situations | L’usage du français pour mieux se faire comprendre par son interlocuteur. | ||||
Présentation des Enquêtés
Identification Socioculturelle et Professionnelle
Nous consacrons cette partie à l’identification de nos enquêtés en fonction du sexe, de l’âge, du niveau d’étude, lieu de résidence et leurs nationalités. Pour cela, nous leur avons posé un ensemble de questions portant sur ces différents points.
Sexe :
Comme le prouve la figure ci-dessous, notre échantillon est en majorité composé de femmes avec plus de soixante pour cent, soit un total de 22 enquêtés de sexe féminin sur les 35. Et ce malgré l’administration du questionnaire à notre public d’une manière aléatoire.
Ce résultat suscite un ensemble de questionnement compte tenu de la faible valeur accordée à la scolarisation des filles, à leur éducation par la communauté subsaharienne en général.
[6_analyse-comparative-du-francais-vehiculaire-chez-les-etudiants_2]
Figure 1 : distribution des questionnaires selon le sexe.
Âge :
Le diagramme ci-dessous, représente la variable âge de nos informateurs. Notre public est constitué que de jeunes étudiants dont l’âge se situe entre 18 et 30 ans.
Plus de 90% de nos enquêtés ont une moyenne d’âge se situant entre 18 et 26 ans (32/35), la seconde tranche d’âge dont la moyenne se situe entre 23-26 ans a le taux le plus élevé avec 48,6%.
Quant à la troisième et dernière tranche, la plus âgée donc, se rapporte qu’a 3 questionnés sur les 35 soit 8,6%, dont deux sont des doctorants.
[6_analyse-comparative-du-francais-vehiculaire-chez-les-etudiants_3]
Figure 2 : distribution des questionnaires selon l’âge.
Niveau d’étude :
Dans notre questionnaire, la question sur le niveau d’étude des enquêtés fait référence à leur niveau actuel au moment de l’administration de celui-ci.
L’enseignement supérieur en Algérie se conforme depuis quelques décennies au système LMD (Licence, Master, Doctorat). Ce dernier a été mis en vigueur depuis l’année universitaire 2004 et comporte trois cycles que nous présentons comme suit :
- Licence : L1 : Licence première année.
L2 : Licence deuxième année. L3 : Licence troisième année.
- Master : M1 : Master première année.
M2 : Master deuxième année.
- Doctorat.
A travers ce diagramme suivant et en tenant compte de la population ciblée par notre sujet de recherche nous tenons à souligner que l’ensemble de nos enquêtés ont effectué leurs études supérieures ou sont toujours en train de le faire.
En effet, nous avons remarqué après retour du questionnaire avoir touché tous les niveaux. Ces résultats se présentent comme suit :
- Les étudiants en Licence : seize(16) enquêtés soit 45,7% ;
- Les étudiants en Master : douze(12) enquêtés soit 34,3% ;
- Les doctorants : sept(7) enquêtés soit 20%.
Nous remarquons que 80% de nos enquêtés sont des étudiants du premier et du second cycle. Cela pourrait être dû à l’inappétence de poursuivre ce troisième cycle de la part de ces étudiants subsahariens.
[6_analyse-comparative-du-francais-vehiculaire-chez-les-etudiants_4]
Figure 3 : distribution des questionnaires selon le niveau d’étude.
Lieu de résidence :
Nous tenons d’abord à souligner que ce ne sont pas dans toutes les résidences de l’Université Salah Boubnider qu’on remarque la présence des étrangers subsahariens, nous avons au total enregistré sept qui sont :
- Résidence Ain El Bey 02
- Résidence Ain El Bey 04
- Résidence Ain El Bey 08
- Résidence Ain El Bey 01
- Résidence Ain El Bey 03
- Résidence Ain El Bey 07
- Résidence Ain El Bey 12
Dont les trois premières sont pour les garçons et les quatre autres pour les filles. Nous remarquons que les résidences des filles représentent à elles seules 62,9 % de l’effectif total.
Le présent diagramme montre que nous avons touché l’intégralité des résidences qui nous concernent, même si nous avons administré notre questionnaire de façon aléatoire l’effectif varie d’une résidence à une autre.
[6_analyse-comparative-du-francais-vehiculaire-chez-les-etudiants_5]
Figure 4 : distributions des questionnaires selon le lieu de résidence.
Nationalité :
Parmi les seize (16) nationalités répertoriées au total dans les résidences de l’Université Salah Boubnider, nous avons touché treize (13) que nous classons en quatre sous-groupes comme suit :
- Les francophones (Burkina Faso, Burundi, Mali, Niger, Tchad et Togo) ;
- Les anglophones (Ghana, Nigeria, Ouganda, Zambie et Zimbabwe) :
- Les lusophones (Mozambique) ;
- Les arabophones (Mauritanie).
Nous tenons à souligner par le biais du tableau ci-dessous que la majorité des enquêtés viennent des pays francophones avec un taux supérieur à 50%, soit six(6) pays au total sur les treize et correspondants a dix-huit (18) enquêtés.
Quant aux anglophones, leur nombre aussi est important, soit quinze (15) enquêtes pour cinq (5) pays.
Tableau 5 : distribution des questionnaires par nationalité.
Nationalité | Effectif | Pourcentage | |
Francophones | Burkinabé | 3 | 8,571% |
Burundaise | 1 | 2,857% | |
Malienne | 4 | 11,428% | |
Nigérienne | 5 | 14,285% | |
Tchadienne | 2 | 5,714% | |
Togolaise | 3 | 8,571% | |
Anglophones | Ghanéenne | 1 | 2,857% |
Nigériane | 2 | 5,714% | |
Ougandaise | 1 | 2,857% | |
Zambienne | 2 | 5,714% | |
Zimbabwéenne | 9 | 25,714% | |
Lusophones | Mozambicaine | 1 | 2,857% |
Arabophones | Mauritanienne | 1 | 2,857% |
Total | 13 | 35 | 100% |
Le répertoire linguistique
Nous le savons qu’en plus de sa langue maternelle, l’on apprend également d’autres langues de différentes manières et l’on les parle couramment, il s’agit du répertoire linguistique. Ce concept fut pour la première fois introduit en sociolinguistique par GUMPERZ.
Il est définit comme « l’ensemble des systèmes linguistiques ou des variétés utilisés par une communauté selon un ensemble de règles qui la caractérisent ». (DUBOIS et AL, 2002 :461 )
Nous allons nous focaliser dans cette partie au répertoire linguistique des enquêtés, pour ce nous leurs avons posé un ensemble de questions relatif à leur répertoire linguistique (langues maternelles, langues officielles, langues de scolarisation ou d’étude …).
Langue maternelle
La langue maternelle est la langue héritée de ses parents ou plus particulièrement de la mère. Elle est donc généralement la première langue acquise et ce de façon naturelle.
Nous avons posé la question suivante aux enquêtés :
- Quelle est votre langue maternelle ?
Et trente-quatre (34) questionnés ont répondu à la question parmi les trente-cinq (35) qui constituent notre échantillon.
L’objectif de cette question est d’avoir une idée sur le caractère plurilingue de cette communauté subsaharienne.
Par le biais du graphique ci-dessous nous présentons les différentes langues maternelles des enquêtés. En effet plus de 97% de nos enquêtés ont comme langue maternelle, les langues d’origine africaine telles que les langues khoisan parlées en Afrique Australe, les langues nigéro-congolaises et les langues nilo-sahariennes parlées en Afrique subsaharienne.
Nous citons entre autres : le Bambara (au Mali et au Burkina Faso) ; le Haoussa (au Niger et au Nigéria) ; le Zarma ou Songhaï et le Tamacheck (au Niger et au Mali) ; le peulh que nous trouvons dans presque toute l’Afrique ; le shona au Zimbabwe qui d’ailleurs a enregistré le plus de réponses soit sept sur trente-quatre 7/34 (ou même sept sur neuf 7/9 de nos questionnés zimbabwéens) etc.
Nous soulignons aussi qu’un de nos enquêtés a affirmé avoir l’anglais comme langue maternelle, nous expliquons cela par le fait qu’il serait peut-être issu d’un mariage mixte (métissage) entre un père subsaharien et une mère étrangère (européenne, américaine), ou même l’inverse.
[6_analyse-comparative-du-francais-vehiculaire-chez-les-etudiants_6]
Figure 5 : la langue maternelle des enquêtés.
Langues officielles
Dans un Etat une des langues en présence est généralement utilisée de manière privilégiée au sein de ses institutions, c’est la langue de l’administration. En effet dans le cas de l’Afrique la quasi-totalité des pays ont pour langue officielle celle des pays colonisateurs respectifs.
Le présent diagramme montre que plus de 90% de nos enquêtés sont issus des pays francophones et anglophones, soit respectivement 51,4% (18 questionnés) et 42,9% (15 questionnés).
Le reste, avec moins de 10% venants des pays arabophones et lusophones (2 questionnés).
[6_analyse-comparative-du-francais-vehiculaire-chez-les-etudiants_7]
Figure 6 : la langue officielle des enquêtés.
Langues de scolarisation ou d’étude
La langue de scolarisation ou d’étude peut se définir comme étant la langue dans laquelle se font les apprentissages, c’est la langue des établissements d’enseignement (primaire, secondaire, supérieur) qu’ils soient privés ou publics.
Généralement en Afrique ce sont les langues officielles qui assurent l’enseignement. Et nous savons que ces dernières furent imposées aux pays africains par les empires coloniaux même si pendant les décennies 50-60 la plupart de ces pays ont acquis leurs indépendances.
Nous soulignons aussi que jusqu’à nos jours presque tous les pays subsahariens ont gardé ces langues dans leurs institutions.
Pour avoir un aperçu sur la langue d’étude de nos enquêtés nous leurs avons posé les questions suivantes :
- Quelle est votre langue de scolarisation ou d’étude ? Cycle universitaire
- Quelle est votre langue de scolarisation ou d’étude ? Cycles antérieurs
Un seul enquêté n’a donc pas répondu à ces questions, soit 34 réponses (plus de 97%).
Cycle universitaire
Le graphique ci-présent montre que plus de 90% de nos enquêtés ont répondu avoir le français comme langue d’étude à l’université, soit trente-un sur les trente-quatre (31/34) ayant répondu à la question.
Deux (2) de nos enquêtés ont affirmé quant à eux avoir l’anglais comme langue d’étude universitaire, cela s’explique par le fait qu’ils sont tous les deux inscrits au département d’anglais de l’Université Frère Mentouri.
Enfin un (1) de ces enquêtés, lui dit poursuivre ses études universitaires à la fois en français et en arabe. Cela explique les dispensions des cours en langue arabe dans d’autres facultés comme nous l’avons souligné un peu plus haut.
[6_analyse-comparative-du-francais-vehiculaire-chez-les-etudiants_8]
Figure 7 : langue d’étude des enquêtés au cycle universitaire.
Cycles antérieurs
Là, nous présentons les résultats des langues d’études recensées de nos enquêtés par le biais de ce graphique ci-dessous. Ils se présentent comme suit :
- Le français avec 64,6% soit 22 enquêtés ;
- L’anglais avec 32,4% soit 11 enquêtés ;
- Le portugais 3% soit 1 enquêté.
Nous avons remarqué que plus de la moitié de nos enquêtés avaient eu la langue française comme langue de scolarisation tout au long de leurs cycles antérieurs.
À la langue française s’ajoute l’anglais avec à-peu-près un tiers du total.
[6_analyse-comparative-du-francais-vehiculaire-chez-les-etudiants_9]
Figure 8 : langue d’étude des enquêtés au cours des cycles antérieurs.
Questions Fréquemment Posées
Quel est le statut du français chez les étudiants subsahariens dans les résidences universitaires?
Le français est perçu comme un outil de communication essentiel dans un contexte de diversité culturelle, et c’est la langue la plus utilisée parmi les étudiants subsahariens.
Comment les étudiants subsahariens utilisent-ils le français au quotidien?
Les étudiants utilisent le français avec leurs camarades étrangers, face à des inconnus, et pour mieux se faire comprendre par leurs interlocuteurs.
Quelles méthodes ont été utilisées pour analyser l’usage du français chez les étudiants?
Les méthodes d’enquête incluent des questionnaires et des enregistrements pour une analyse quantitative et qualitative des données.
