L’analyse comparative des cultures révèle comment l’exil façonne l’identité dans l’œuvre de Leïla Sebbar. En explorant le tiraillement entre la langue française et arabe, cette recherche met en lumière des enjeux identitaires cruciaux, transformant la souffrance en une puissante source de création littéraire.
Culture d’origine et culture de vie
Le concept très vaste de la culture est caractérisé par tout un ensemble d’habitudes, de représentations mentales et des expériences vécues. Les cultures se multiplient et se divergent, il n’existe pas une seule ou unique culture, mais des milliers, chacune appartient à une société. Le sociologue Denys Cuchela définit ainsi : «La notion de culture, comprise dans le sens étendu, qui renvoie aux modes de vie et de pensée, est aujourd’hui assez largement admise.»23
Il existe plusieurs définition de la culture qui sont très attirantes parmi lesquelles, on va aborder, celle de l’encyclopédie de Larousse : « L’ensemble des connaissances acquises ; instructions, savoir, ensemble des structures sociales, religieuses, des manifestations interculturelles, artistiques qui caractérisent une société. »24
La nostalgie du pays est bien expliquée non seulement dans les écrits de Leïla Sebbar, mais aussi dans ses rencontres et ses interviews, où l’auteure ne cesse pas de parler de ses souvenirs d’enfance dans l’Algérie notamment dans la maison d’école. Leïla Sebbar était séparée de sa langue paternelle et de la culture orientale qui n’était pas transmise ou bien hériter de son père et de ses ancêtres, c’est en France ou l’Algérie n’existe pas, Leïla comme tous les écrivains exilés évoque dans ses textes ce conflit de croisement culturelle qui la met en situation déséquilibrée et instaure en elle un sentiment de perte et de malaise.
Notre protagoniste tout au long de son roman est à la recherche de sa langue paternelle pour approcher à sa culture et à son origine perdu.
Dans cette étude, la relation s’établit entre les Français et les Maghrébins. Tous les deux possèdent deux identités et deux cultures différentes certes, mais liées par le biais de la colonisation et le mariage mixte qui permet une interaction et un chevauchement entre les deux univers, ici nous parlons de la biculturalité.
La culture orientale
La culture d’une société donnée inclura la totalité des coutumes, des croyances, des formes d’art, la cuisine, la musique, la façon de s’habiller, etc. Ces éléments fondent et définissent une culture ou une tradition quelconque. Leïla Sebbar a tenté quelques fois d’écouter les chansons orientales en particulier les chanteuses égyptiennes pour rattraper une petite partie perdue de son algérianité c’est grâce à ces fils et à la technologie : « Avec la parabole, j’ai
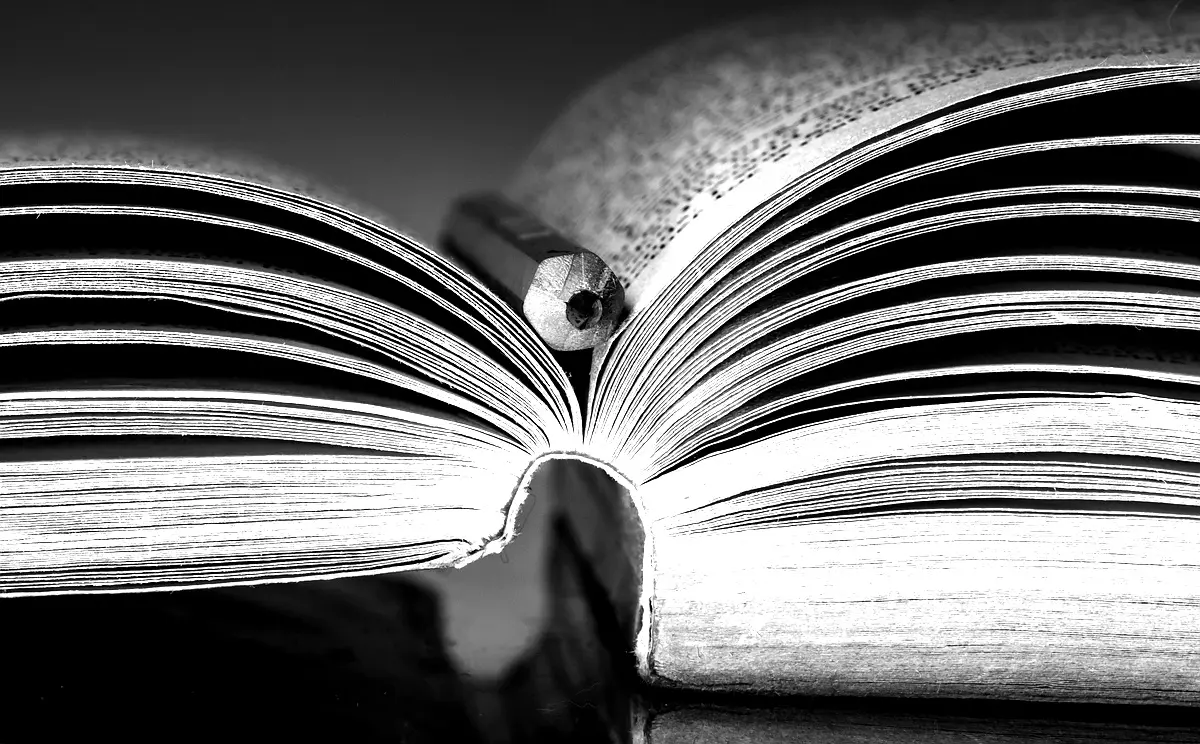
23CUCHE, Denys, La notion de culture dans les sciences sociales. Paris, La Découverte, 2004, p. 4
24Dictionnaire encyclopédique, Le Larousse. Paris, 1980
appris des chansons égyptiennes, mes fils m’envoient des cassettes. » 25 Ce genre de musique caractérise La culture orientale classique celle des ancêtres.
La cuisine sert aussi de références traditionnelles. L’auteur décrit des plats traditionnels : « la sœur aux yeux verts, l’âge les a voilés, est assise sure la natte, un grand plat en bois devant elle, elle roule des pates pour la chorba, fine, très fine. » Les étrangers aiment, respectent et se fascinent devant nos traditions algériennes.
Plus loin de la musique et la cuisine s’ajoute d’autres traditions propres à ce peuple unique, riche et varié par ses tenues traditionnelles comme le haïk ou la fauta qui représentent la pudeur et la pureté de la femme algérienne. Notre protagoniste raconte avec chagrin, comment elle a échoué d’imiter les gestes qui lui paraissaient simples de mettre une fauta seule devant son miroir, contrairement à la servante : « Fatima prenait sa fauta, une pièce de tissu à rayures coloré qu’elle posait sur sa tête, repliant chaque coin dans un geste rapide, précis difficile à reproduire, pour dissimuler ses cheveux, déjà cachés par un ou deux foulards.» 26
Les hommes aussi ont une façon spécifique de s’habiller qui les caractérisent des autres cultures et des autres civilisations : « Au ras de la terre rouge d’où partaient les chevaux en ligne, jusqu’à l’autre bout du stade, alors les hommes, le burnous blanc gonflé, tiraient tous à la fois, debout sur les étriers. »27
Le burnous et chéchias sont des vêtements très typiques en Algérie, il est porté par les combattants pour cacher leur misère durant la période coloniale. Il revêt toute une symbolique, en effet il est le symbole de la paix et la pureté.
On trouve que la narratrice dans son œuvre parle beaucoup des traditions qui sont pratiquées en Algérie telles que la fantasia une course de chevaux montés par des cavaliers compétents armés de fusils où des coups de baroud sont tirés en l’air. C’est ce spectacle qui a poussé l’écrivaine à poser des questions à son père pour qu’il puisse donner la signification des cris poussés par ces hommes.
Elle site aussi le cri unanime du ‘’djihad’’ (la guerre sainte), Allah ouakbar: «… si l’un d’eux n’avait pas arrêté son cheval à temps, mais nous n’avions pas besoin de reculer brutalement, après deux ou trois heures de baroud, nous savions que ces hommes ne se seraient pas laissés emporter par leurs chevaux.
»28
25 SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, 2003, p.75.
26 Ibid. p. 56
27 Ibid. p. 14
28 Ibid. p. 16
L’œuvre ne manque pas des croyances et des rites. La narratrice a parlé d’une femme sainte de la région du Ténès c’est Imma B’net, la mère des filles, cette femme est devenu sainte, elle ne s’est pas convertie à l’Islam, mais son tombeau est devenu un lieu de pèlerinage pour les femmes algériennes qui vont fréquemment visiter ce petit sanctuaire ou les bougies ne s’éteignent pas.
La culture occidentale
La culture française avait aussi sa part dans cette œuvre. L’influence maternelle incarnée par les mini-jupes et la liberté de choisir et de réclamer ses droits et sa part de son mari était un héritage purement français : « ces filles de la citadelle hermétique que leur mère, la Française, habillait trop court à la manière des Nazaréens dévergondés et que le père abandonnait à la voie publique » 29
Elle rajoute que sa mère française n’a pas changé ses traditions, son mode de vie et ses habitudes. La famille Sebbar respectent les traditions de cette Française, ils n’obligent pas à cette française de porter le voile ou de mettre le haïk, donc on ne lui exige pas des traditions qui ne sont pas les siennes. Elle se comporte avec son mari, comme chez les Français.
La narratrice évoque aussi des écrivains français tel que Paul Robert, l’auteur du dictionnaire, aussi, Le Robert, Bordas et Le Grand Larousse et aussi des villes de France notamment, Nice, Bordeaux, Paris…
L’Orient et l’Occident restent toujours historiquement et forcément liés. Cette relation réciproque et interactionnelle entre la culture du Nord et l’autre de Sud est un cercle vicieux évoque et influence plusieurs écrivains. Amine Maalouf favorise ce rapport et ce phénomène de réciprocité éternel, car pour lui on doit accepter et respecter la culture de l’autre pour mieux le comprendre et le faire intégrer et surtout pour mieux vivre. « Aujourd’hui chacun d’entre nous doit nécessairement adopter d’innombrables éléments venus des cultures les plus puissantes ; mais il est essentiel que chacun puisse vérifier que certains éléments de sa propre culture des personnages, des modes, des musiques, des plats, des mots…-sont adoptés sur tous les continents »30affirme l’écrivain Maalouf.
29 Ibid. p. 41
30MAALOUF, Amin, Les Identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998. p. 140.
Dans ce passage l’auteur interpelle l’homme de garder et de protéger sa propre culture qui fabrique son identité, sa distinction et aussi sa dignité. Bref, l’homme est sensé de conserver sa culture et de se servir à la culture de l’autre.
Tout au long de ce chapitre, nous avons essayé de saisir que l’exil chez notre protagoniste n’implique pas uniquement un déplacement spatial ou un changement géographique, il signifie également un isolement et une marginalisation par rapport à un entourage social ou par rapport à une langue précise, ce qui implique chez Leïla Sebbar une perte. Nous avons dévoilé par la suite, que la mixité raciale est la première cause qui a influencé la vie de l’écrivaine au sein de sa société.
On constate par la suite que cet écart de la langue et de la culture arabe expose la famille Sebbar à s’exiler, si l’exil se transmet comme l’affirme l’écrivaine, c’est là un des plus lourds héritages qui lui ait été transmis. Ainsi est-ce que ce blocage linguistique peut contribuer à une instabilité identitaire ?
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment Leïla Sebbar exprime-t-elle la nostalgie de son pays dans son œuvre ?
Leïla Sebbar évoque sa nostalgie du pays à travers ses écrits, ses rencontres et ses interviews, où elle parle de ses souvenirs d’enfance en Algérie, notamment dans la maison d’école.
Quelle est la relation entre la culture orientale et la culture française dans l’œuvre de Sebbar ?
La relation s’établit entre les Français et les Maghrébins, chacun possédant deux identités et cultures différentes, mais liées par la colonisation et le mariage mixte, ce qui permet une interaction et un chevauchement entre les deux univers.
Quels éléments de la culture orientale sont présents dans les écrits de Sebbar ?
Les éléments de la culture orientale présents dans les écrits de Sebbar incluent la musique, la cuisine, et les tenues traditionnelles, comme le haïk ou la fauta, qui représentent la pudeur et la pureté de la femme algérienne.