L’analyse comparative des cultures congolaises révèle des mécanismes de défense souvent méconnus dans la communication interculturelle. En combinant des approches qualitatives et quantitatives, cette recherche offre des perspectives inédites sur les dynamiques socioculturelles, essentielles pour comprendre les interactions multiculturelles au Congo.
- Multiculturel ou multiculturalisme, une réalité sociale de cohabitation des cultures
Les mots multiculturel (ou pluriculturel) ne font que juxtaposer des phénomènes culturels, et concernent des sociétés dans lesquelles plusieurs cultures cohabitent, mais ils ne disent rien de leurs interrelations. Rajouter un « isme » à multiculturel lui donne cependant une dimension plus dynamique. Ainsi, faire référence au multiculturalisme, pour Denys Cuche182, c’est revendiquer une reconnaissance politique officielle de la pluralité culturelle et un traitement public équitable de toutes les collectivités culturelles.
Pour Steve Vertovec183, le multiculturalisme est un concept qui, à partir des années soixante-dix, s’est incorporé au discours de nombreuses disciplines et a été utilisé par des secteurs sociaux très divers : enseignants, responsables politiques, assistants sociaux, etc. Mais on n’attribue toujours pas le même sens à ce concept, au point que sous la même étiquette, des propositions sociales opposées ont été avancées. C’est pourquoi l’utilisation très ambiguë de ce concept dans des contextes différents oblige à leur redéfinition permanente. Cette considération amène l’auteur à relever deux faits.
Le premier fait est que « nombre de divers usages que l’on fait du multiculturalisme renferment implicitement une conception essentialiste de la culture. Celle-ci serait un certain nombre de caractéristiques plus ou moins éthérées qui différencient et distinguent les divers peuples » 184.
Le second fait est qu’« on peut dépister derrière le multiculturalisme les traces d’un nouveau racisme, le racisme sans races, et d’une rhétorique de l’exclusion. Ce principe d’exclusion fondé sur la différenciation par la race, une catégorie déjà rejetée par la science, soit remplacée par celui de l’identité culturelle » 185.
D’après Philippe Pierre186, le multiculturalisme désigne la cristallisation de divers projets politiques qui consistent à ne plus refouler l’expression des différences civiles dans la seule sphère du privé mais au contraire à leur garantir une représentation publique dans les instances politiques en accordant plus de droits aux minorités.
Emilio Lamo de Espinosa187 entend par multiculturalisme (en tant que fait) la cohabitation dans un même espace social des personnes identifiées des cultures diverses jusqu’à un métissage. Dans ce cas, est exclu le multiculturalisme radical ou le développement de cultures séparées débouchant sur un nouveau racisme ou nationalisme excluant.
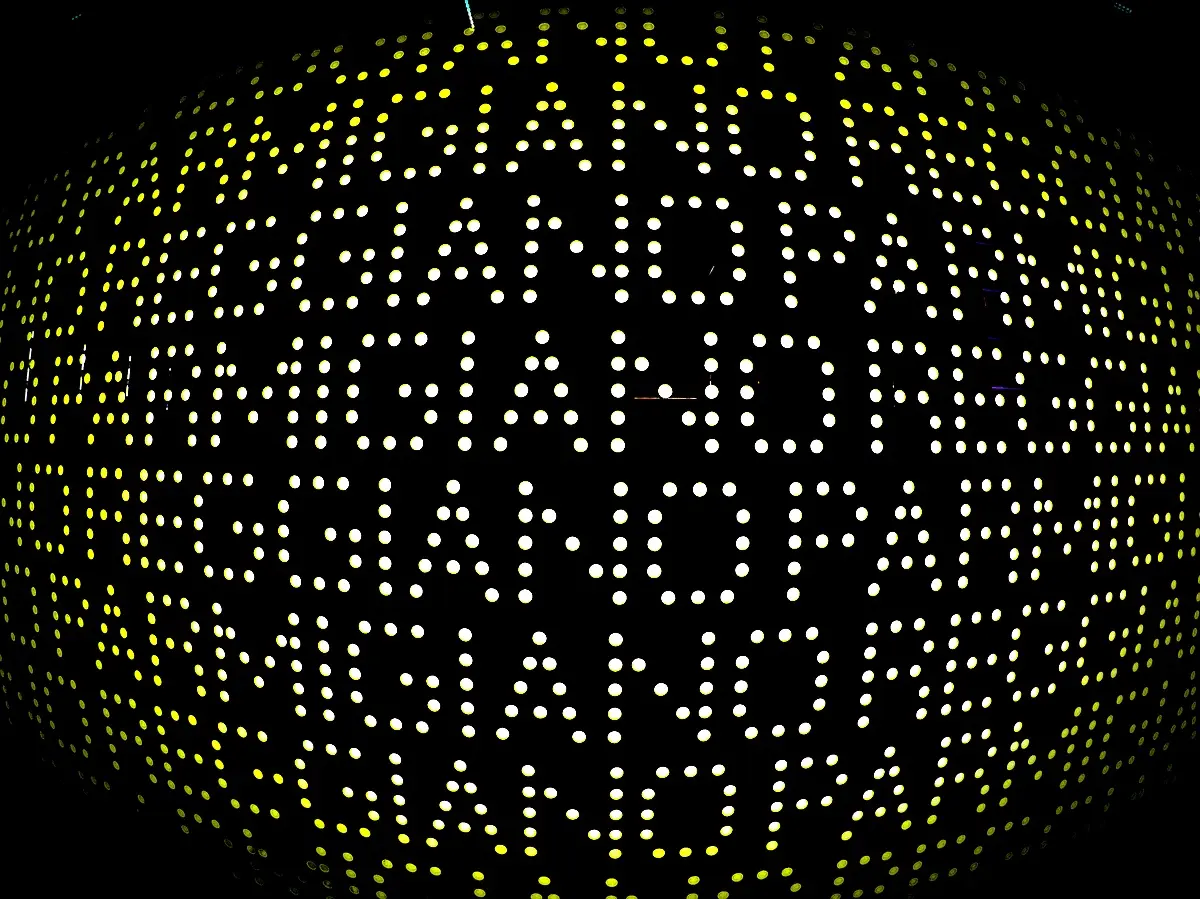
Comme on peut le remarquer, le multiculturalisme peut susciter deux faits essentiels sur les identités socioculturelles des personnes impliquées, à savoir le problème de différence (ou des inégalités) et celui d’égalité.
De son côté, Miquel Rodrigo Alsina188 entend par multiculturalisme la coexistence de diverses cultures dans un même espace réel, médiatique ou virtuel, tandis que l’interculturalité serait les rapports qui s’établissent entre celles-ci. Autrement dit, le multiculturalisme indiquerait l’état de fait, la situation d’une société plurielle du point de vue des communautés culturelles aux identités différenciées. L’interculturalité, par contre, se rapporterait à la dynamique qui se produit entre ces dernières.
En quelques mots, « le multiculturalisme se fonde sur les différences nationales et ethniques »189.
- Interculturel, une réalité dynamique relationnelle et identitaire entre les cultures
Le préfixe inter exprime, pour Gina Stoïciu190, trois des enjeux majeurs de la communication ; il s’agit d’une rencontre avec, d’une rencontre entre et d’une rencontre agissant sur. La connotation « avec » est indicatrice des acteurs, des cultures et des identités en présence.
La connotation « entre » renvoie à la dynamique relationnelle et identitaire ainsi qu’aux échanges entre les acteurs en présence, échanges ponctués d’interaction, de positionnement, de négociation, d’action et de réaction. Et, la connotation « sur » exprime l’importance de la prise en considération des dynamiques de changement, dans leurs contexte respectifs.
C’est en tenant compte de ce triple point de vue qu’apparaît véritablement, selon l’auteur, la communication interculturelle dans la pleine dynamique de son unité.
Pour Michel Sauquet, Martin Vielajus et Juliette Decoster 191, l’interculturel concerne les relations entre les cultures ; ceci étant, il n’est une notion ni positive ni négative. L’idée de dialogue interculturel, qui suppose une démarche de découverte réciproque, n’y est pas forcément, par exemple, incluse.
L’interculturel évoque également le concept transculturel qui renvoie, selon Chantal Forestal192, à des caractéristiques communes qui traverseraient plusieurs cultures, soit des caractéristiques communes qui ne relèvent pas des systèmes culturels eux-mêmes.
Ce qu’il y a d’intéressant dans ce concept, c’est la question qu’il pose : y a-t-il des universaux culturels ? Et si ces universaux existent, d’où viennent-ils ? De la biologie, des apports des grandes traditions spirituelles ? Pour l’auteur, cette dimension est une chose essentielle pour renforcer les relations interethniques ou internationales au travers d’une coopération entre les ethnies ou les groupes socioculturels lorsque ces dernières cherchent à vivre ensemble, c’est-à-dire à trouver les conditions et le mode de fonctionnement qui préviennent les conflits.
________________________
182 CUCHE, D., cité par SAUQUET, M. et alii, op.cit, p. 4. ↑
183 VERTOVEC, S., « Multuralism, culturalism and public incorporation », in Ethnic and racial studies, Vol. 19, n°1, 1996, p. 50. ↑
184 VERTOVEC, S., op.cit, p. 51. ↑
186 PIERRE, P., « Eléments pour une réflexion critique sur le management interculturel », p. 2, document téléchargé le 01 janvier 2010, URL : www.philippepierre.com. ↑
187 LAMO DE ESPINOSA, E., « Fronteras culturales», in LAMO DE ESPINOSA, E. (edit.), Culturas, estados, ciudadanos: Una aproximación al multiculturalismo en Europa, Madrid, Alianza, 1995, p. 18. ↑
188 RODRIGO, M.A, « Éléments pour une communication interculturelle », in CIDOB, nº 36, 1997, p.131. ↑
189 KYMLICKA, W., Ciudadania multicultural, Barcelona, Paidos, 1996, pp. 35-36. ↑
190 STOICIU, G., « L’émergence du domaine d’étude de la communication interculturelle », p. 10, document téléchargé le 17 janvier 2010, URL : http://www.midipyrenees.fr ↑
191 SAUQUET, M. et alii, « Pour une formation à l’interculturel », p. 4, document téléchargé le 15 décembre 2011, URL : http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/deed.fr ↑
192 FORESTAL, C., [Référence à compléter selon le texte source]. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que le multiculturalisme selon Denys Cuche?
Pour Denys Cuche, le multiculturalisme est une revendication de reconnaissance politique officielle de la pluralité culturelle et un traitement public équitable de toutes les collectivités culturelles.
Comment le multiculturalisme est-il perçu dans le contexte congolais?
Dans le contexte congolais, le multiculturalisme peut susciter des problèmes de différence (ou des inégalités) et celui d’égalité, en mettant en avant la coexistence de diverses cultures.
Quelle est la différence entre multiculturalisme et interculturalité?
Le multiculturalisme désigne la coexistence de diverses cultures dans un même espace, tandis que l’interculturalité se rapporte aux rapports et aux dynamiques qui s’établissent entre ces cultures.