L’analyse comparative de la photographie révèle comment les images documentaires de l’occupation américaine d’Haïti (1915-1920) transcendent leur fonction initiale. En scrutant les codes vestimentaires et les postures, cette étude met en lumière des représentations sociopolitiques inattendues, essentielles pour comprendre cette période tumultueuse.
CHAPITRE IV – ANALYSES DE CAS
REPRESENTATION DES MARINES AMERICAINS
- 28 Juillet 1915, l’armée états-unienne a envahi Port-au-Prince
L’armée états-unienne a envahi Port-au-Prince
Photo d’environ 330 Marines160, américains à bord du navire Connecticut ont envahi Port-au-Prince le 28 juillet 1915 ayant pour objectifs de
« protéger » les
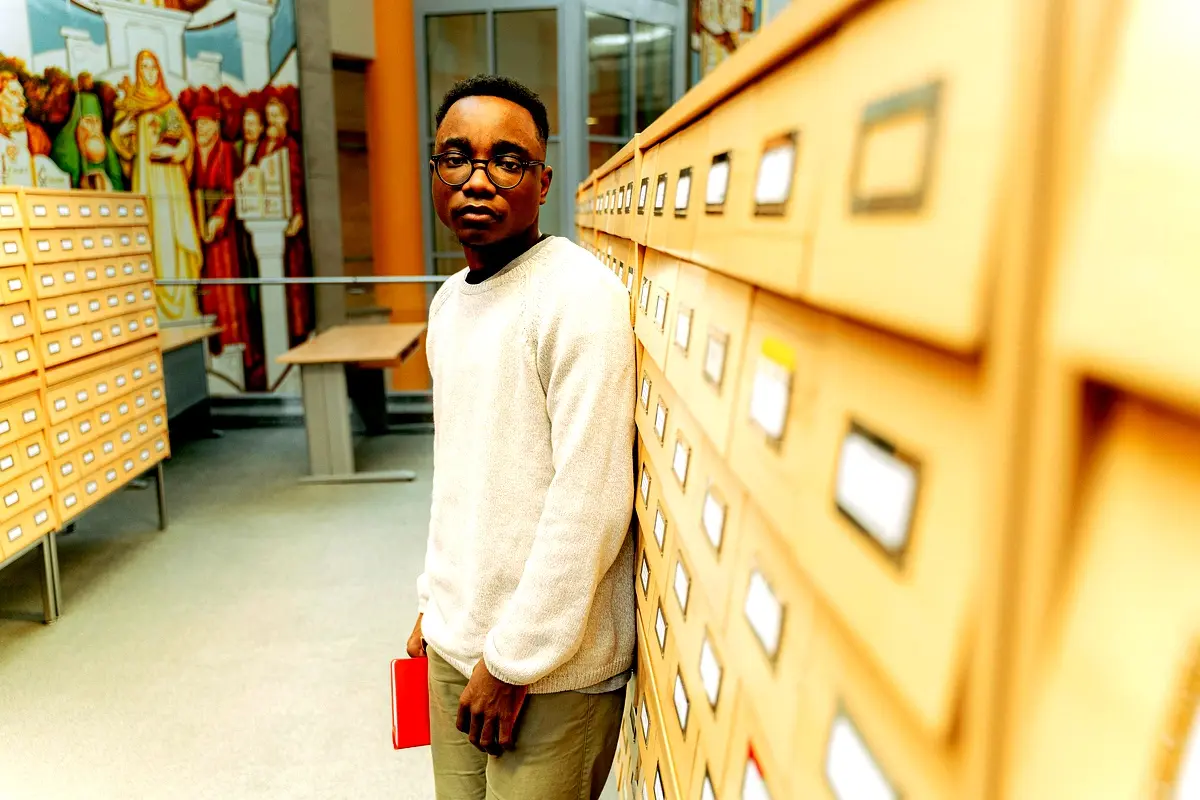
intérêts » américains et étrangers » ainsi
que de rétablir la paix et l’ordre. Suzy Castor parle de 400 marines, et l’amiral Caperton a déjà accosté sur les eaux du Cap-Haitien a reçu l’ordre de débarquer ses troupes… C’est un changement de tactique du côté du gouvernement américain, selon Suzy Castor, de remplacer la voie diplomatique par l’intervention armée.
Il s’agit d’une photo en noir et blanc « de presse » sur un article titré « US occupation 1915 – 1934 », le photographe qui a pris cette photo nous parait inconnu, sans doute le 28 Juillet 1915; son titre est L’Armée américaine a envahi Port-au-Prince.
Cette image, ainsi que l’article lié, ont été diffusés sur la page web intitulée Wikispaces161, le 18 Mai 2012. A remarquer que la photo a été prise depuis en juillet 1915, c’est jusqu’en 2012 qu’on essaie de la publier dans un article. La raison c’est d’utiliser la photo comme support documentaire mais pas une analyse d’image. Et ceci c’est pour montrer le niveau d’occultation qu’a subi cette tranche d’histoire pendant presqu’un siècle.
La photo aborde la question de l’envahissement de la Marine des Etats-Unis en Haïti le 28 juillet vers 17 heures, le tohu-bohu total, confusion entre les Marines et la population haïtienne au premier plan, semble-t-il qu’il avait eu de violences à travers la rue, une autre coté dans la rue parait vide, au second plan un espace bâti, à l’arrière-plan les bateaux s’abritent sous la mer. A noter qu’à chaque point stratégique, les douanes, du pays un stationnement de Marines. Par exemple, les
160 https://ushaititext.wikispaces.com/US+Occupation+1915-1934
161 Ibid, meme page
Cayes, Jérémie, Jacmel, Mirogoâne, Petit-Goâve, Port-au-Prince, Saint-Marc, Gonaïves, Port-de-Paix et Cap-Haïtien toutes ses douanes étaient sous leur contrôle. Les thèmes d’Occupation, rapports occupé/occupant est mis en évidence.
L’image des Marines, se confondant avec la foule, sans doute bien armés, laisse un sentiment de peur chez la population de Port-au-Prince. Les Marines s’imposent comme occupant et manipule la population pour leur faire accepter l’occupation. Dans l’imaginaire haïtien, pendant qu’on ne fait pas circuler ses images, une vague d’indignation a plané chez tout le peuple haïtien bénéficiant du patriotisme dessalinien, chez tous les peuples du continent américain touché par ses débarquements. Selon Suzy Castor, dans le but de masquer la brutale réalité de l’intervention d’une grande puissance dans les affaires d’un petit pays, ces formules tendaient à diffuser en Amérique Latine et en Europe, l’image d’une « mission civilisatrice » (Castor Suzy, n.d., p 31).
L’image présente un sentiment de peur par différents procédés : l’entremêlement entre Marines et des haïtiens accroche tout d’abord notre œil, l’espace urbanisé au second plan; les bateaux qui se trouvent à l’arrière-plan sous la mer caractérisent l’état de domination, de manipulation des haïtiens et le dépouillement du décor accentuent l’effet de malaise, de peur, de domination et d’injustice.
L’image est réaliste, riche en signification mais polysémique. La légende qui, généralement a avancé par des historiens et d’autres chercheurs, accompagne l’image aide à réduire cette polysémie de la photo et la contextualise. Sans la maigre légende, nous ne pouvons pas savoir où l’action se passe, à quelle époque et la problématique soulevée.
Bien que, nous ne savons pas clairement la position géographique qui est mise en cause dans la photo. L’ancrage linguistique complète l’information transmise par la photo et donne des repères sur certains éléments narratifs dans l’image : les sujets impliqués et le contexte de l’intervention militaire.
Le taux d’iconicité du sujet de l’information est élevé, car l’image permet aux lecteurs de reconnaître, d’identifier puis de comprendre ce qui se passe pour les haïtiens manifestant un certain patriotisme de l’époque. Suzy CASTOR a bel et bien présenté une image du débarquement : « Les Nord-Américains débarquèrent à Bizoton, faubourg de la capitale ; guidés par quatre marins haïtiens, ils attaquèrent des points stratégiques de Port-au-Prince. L’arsenal, premier poste attaqué, résiste. Les officiers Joseph Pierre, Edouard François Pierre Sully se firent remarquer par leur héroïsme. Il y a des pertes des deux côtés. Les marines reculent mais rapidement, ils
attaquent d’autres postes qui se rendent sans combat »162. Donc, c’était le rapport de force inéquitable.
Les lignes obliques dominent la photo. Puis, la lecture proposée de la photo se fait en suivant un parcours en Z (le titre, l’image et la légende). L’image est cadrée à la verticale et les éléments qui la composent sont organisés en trois paliers: des spectateurs incorporent les Marines en avant-plan, hors foyer, l’espace urbain où habitent beaucoup de gens et le décor où se trouve les bateaux sous la mer de Port-au-Prince en troisième plan (Géographie des lieux et du temps). Le photographe est placé à droite par rapport à la scène photographiée; l’angle de prise de vue est en plongée, ce qui produit un certain effet d’écrasement des sujets.
La photo est réaliste et objective, elle a une fonction notionnelle et c’est une photo de reportage, pourrait-on dire par rapport à l’époque, de couleur noir et blanc, des types d’architecture existant à l’époque, et le plan de la ville. L’image permet de faire une première référence à des soldats américains (Marines) à cause de grands bouleversements au côté des individus représentés, la qualité de la photo ne nous permet pas d’identifier la couleur de l’uniforme des Marines, mais les bateaux se trouvant sous la mer sont visibles. Il y a une incorporation incontestable entre la population représentée et les Marines. Ceux-ci renvoient à la réalité des interventions militaires états-uniennes dans plusieurs pays du continent américain y compris Haïti.
Ces images représentant l’intervention des Marines en Haïti, bien armés, et des haïtiens (nes) en spectateur ou en mouvement avec tout un sentiment de peur, de choc, de trouble, suggèrent à la fois le danger et l’humiliation. La photo étonne le spectateur et l’émeut par la mise en situation inattendue et le rapport de force démesuré.
Le format de l’espace, des spectateurs et les Marines en désordre total à l’avant-plan crée l’effet d’un marasme socio économico politique (dépression, crise, conflit…) et marasme moral (tristesse, mal, désarroi, inquiétude…) à travers lesquels le spectateur/lecteur regarde, examine, découvre une réalité… Et l’espace urbain au second plan traduit la réalité du plan de la ville de Port-au-Prince, les bateaux qui se trouvent sous le Port de Port-au-Prince traduisent la réalité d’une intervention militaire.
162 (Castor Suzy, n.d., p 65)
La photo joue le rôle ici de preuve, elle est descriptive: elle montre d’abord un environnement
« urbain » ayant des centaines de Marines et des spectateurs en mouvement dans un lieu concentré,
« urbanisé », les bateaux sous le Port traduisant l’envahissement parce que c’était le moyen de transport le plus approprié à l’époque ; elle va aussi témoigner des conditions de peur, de malaise des citoyens haïtiens causés par l’envahissement des Marines en Haïti. Elle fait référence à un ensemble de pays dans l’Amérique Latine qui a été victime d’occupation états-unienne dans la même époque ; l’image des débarquements…
L’effet de contraste ou d’opposition est bien mis en évidence par l’incorporation des Marines avec la population, peu d’acteurs/ spectateurs sont identifiable. En raison du contraste lié au premier plan de la photo, on n’avance aucune hypothèse concernant la position des Marines dans la foule, l’habillement des spectateurs/acteurs, la fumée qui, semble-t-il monte, les zones d’éclairage entre l’avant-plan sombre et l’arrière-plan clair.
Quoi que les Marines aient porté une couleur sombre. Un procédé stylistique d’antithèse met en valeur ce rapport de force entre occupants et occupés (les Marines armés VS les civils comme simple spectateur et acteur dans une certaine mesure). Le contraste entre les Marines en incorporation avec les civils hors-foyer au premier plan a une valeur métonymique, suggérant la fusion des Marines avec les civils comme signe d’accueil, surement les bateaux se trouvant sous la mer à l’arrière-plan expriment les équipements qui ont facilité l’envahissement.
Le photographe a dû faire cette photo avec un téléobjectif : le foyer s’est fait sur l’arrière-plan, donnant ainsi une bonne profondeur de champ à l’image tout en créant un flou en avant-plan. Peu d’effets sont observables car le but de la photo est de témoigner d’une réalité et non d’être esthétique.
Cette image, ainsi que l’article lié, ont été diffusés sur le site de Wikispaces, le 18 Mai 2012. A remarquer que la photo a été prise depuis en juillet 2015, c’est jusqu’en 2012 qu’on essaie de la publier dans un article titré « United States Occupation of Haïti 1915-1934 » portant la signature des auteurs Caroline Snell, Sarah Hegarty, Isabel Spence, Rachel Marolda. Ces auteurs ont utilisé la photo, comme je l’ai dit au-dessus, comme support documentaire. C’est sans doute des auteurs étrangers qui écrivent pour le public états-unien ou les haïtiens qui se trouvent au Etats-Unis, ou dans un cadre plus général tout chercheur ou autre citoyen à travers le monde.
Suzy Castor avance les causes de l’occupation américaine d’Haïti, premièrement la politique étrangère américaine qui est liée à l’expansion économique et politique et les interventions armées dans les caraïbes. Soit en Amérique Latine, Nicaragua, au Honduras, République Dominicaine. Deuxièmement, le poids des facteurs économiques à ce que Suzy Castor parle de péril européen, ensuite le facteur stratégique. Troisièmement, la motivation économique fondamentale163.
L’occupation d’Haïti sous la conduite de l’amiral Caperton « est un modèle d ‘efficacité et de rapidité ». Le 7 aout, déjà, les américains contrôlent tout le territoire national. Les forces haïtiennes sont désarmées, les postes militaires et les casernes sont occupés et le palais national est pris comme quartier général de l’occupation164. Ce rôle dévolu au palais national de Port-au-Prince, jusqu’alors symbole de pouvoir présidentiel mais aussi de l’indépendance du pays, est significatif de la volonté américaine de marquer son autorité politique par la force des armées.
Les lois d’aout et de septembre 1915 sont consacrées à parachever l’occupation et à faire élire un président. En effet, « après le débarquement de 5 compagnies (2 compagnies de marines et 3 fusiliers marins) le 28 juillet, l’amiral Caperton fait venir des renforts au cour de la première quinzaine d’aout et, fin aout, il dispose de plus de 2 000 hommes et officiers. Son adjoint, le capitaine Bach, est chargé de superviser le fonctionnement des services civils de l’administration haïtienne. »
Le 7 aout, déjà, les américains contrôlent tout le territoire. L’amiral Caperton, dans une lettre, le confirme et souligne bien qu’il s’en tient aux objectifs qui lui sont fixés : « j’ai reçu pour instruction du gouvernement des Etats-Unis de donner l’assurance au peuple haïtien que les Etats-Unis n’ont aucun objet en vue, excepté celui d’assurer, d’affermir et d’aider à maintenir l’indépendance haïtienne et l’établissement d’un gouvernement stable et ferme par le peuple haïtien. Toute assistance sera donnée au peuple haïtien dans son effort pour réaliser ces fins. L’intention des Etats-Unis est de retenir leurs forces en Haïti seulement aussi longtemps que ce sera nécessaire pour obtenir ce résultat.»165.
La photo constitue une preuve, un aide-mémoire de l’occupation états-unienne d’Haïti. Elle est le témoignage de l’envahissement des Marines. Selon Dantès Bellegarde, tout comme Suzy Castor
163 (Castor Suzy, n.d., p 39 – 60)
164 (Lucien Georges Eddy 2013, p 23)
165 (Lucien Georges Eddy 2013, p 94)
(p. 39 – 60), Georges Eddy Lucien, Lesly F. Manigat (p 61 – 71) l’ont montré, l’intervention des Etats-Unis en Haïti n’a été inspiré que par des intérêts financiers particuliers ; c’est pour permettre à quelques américains de disposer à leur guide de trésor haïtien et de satisfaire leur instinct de domination que l’occupation militaire d’Haïti a été faite et qu’elle est maintenu166.
Les Nord-Américains sont reçus à bras ouvert par les classes dominantes. Immédiatement, les protestations s’élèvent. Les journaux Haïti Intégrale et La Patrie firent leur apparition. Georges Sylvain organisa l’Union Patriotique…Cependant, seul les cacos encore sur le pied de guerre à Port-au-Prince et au Cap-Haitien, représentaient une vraie force de résistance. « Près de 1 500 cacos se trouvent à Port-au-Prince – écrivait l’Amiral Caperton au secrétaire de la marine le 2 aout…ils demandent l’élection de Rosalvo Bobo à la présidence. Le corps législatif est sur le point de leur donner satisfaction. Seul mon insistance sur le point le retient ».
Dans le contexte artistique, entre 1850 et 1880 l’évolution des possibilités techniques suscite l’engouement pour les expéditions. Les photographies de monuments, de sites archéologiques, de paysages et d’habitants de pays souvent éloignés fascinent les contemporains, déterminés à conquérir le monde par le regard. Ainsi, l’Américain Edward S. Curtis publie ses travaux entre 1907 et 1930, sous le titre The North American Indian.
Au début du XXe siècle, les progrès de la photographie en noir et blanc permettent au grand public de maîtriser des procédés de plus en plus complexes. Les premiers supports couleur commercialisés, des plaques de verre appelées Autochromes Lumière, d’après le procédé mis au point par les frères Auguste et Louis Lumière, sont disponibles en 1907.
Puis, à l’aube du XXe siècle, le développement de la presse et des moyens de reproduction photomécanique favorise considérablement l’essor de la photographie documentaire. De même Lewis Wickes Hine, sociologue américain et défenseur du droit des enfants au travail, émeut ses contemporains par la publication au début du XXe siècle de photographies d’ouvriers, de mineurs, d’immigrants européens et, surtout, d’enfants au travail.
La photographie de reportage était en pleine extension. A ce point, du côté des Etats-Unis, déjà on a accordé une grande importance à la photographie comme support documentaire. L’intervention armée en Haïti s’accompagne avec des photographes et d’autres spécialistes. En fait, cette contextualisation est valable pour tous les cas d’étude.
166 (Bellegarde Dantès 1996, p 22)
La photo décrit une page d’histoire du débarquement des Marines Etats-Uniens, elle montre le déploiement de forces armées des USA. On rappelle des incidents majeurs à Léogane où Charlemagne Peralte, commandant de la sécurité militaire de la région refuse de déposer les armes et le drapeau national, avec Pierre Sully qui en refuse aussi et les Marines l’ont exécuté.
L’image de l’intervention annonce la mainmise des Etats-Unis dans la politique et dans l’économie d’Haïti, où ils font élire le président du Senat Sudre Dartiguenave, authentique représentant de l’élite traditionnelle qui a reçu à bras ouvert les occupants, le 12 Aout avec la complicité de quelque député haïtien pour un mandat de sept ans, selon Suzy Castor.
Immédiatement, des protestations s’élèvent, avec le courant nationaliste de Georges Sylvain à travers les journaux, les cacos sont sur pied de guerre au Cap-Haitien, à Port-au-Prince et dans d’autres villes de province, représentant une forte résistance. Ceux qui vont donner un lourd bilan de l’occupation. Pour approuver juridiquement l’occupation, le Département d’Etat a besoin d’un cadre légal, c’est la convention haïtiano-américaine par lequel ils prennent le contrôle des douanes et de l’administration.
Le projet de cette convention fut envoyé au parlement pour être ratifié sans modification, avance Suzy Castor. Ainsi, 40 % des recettes de l’État passent sous le contrôle direct des États-Unis. L’armée est dissoute au profit d’une gendarmerie. Les officiers sont américains.
L’œuvre est disponible dans les archives du Département d’Etat des Etats-Unis. Les auteurs qui ont utilisé cette photo comme support documentaire se trouvent aux Etats-Unis, l’article est publié en Anglais.
En fait, notre mémoire n’est que le premier travail de recherche sur la photographie en Haïti, c’est pourquoi, nous voulons y poursuivre sur plusieurs points. A savoir, trouver des espaces pour diffuser ces images inédites au grand public, proposer un projet de musée pour la photographie… On peut toujours faire allusion à la théorie de Barthes pour montrer que les premiers discours qui circulent déjà dans l’imaginaire haïtien sur le débarquement des Marines en Haïti vont faciliter le décodage du message de cette photo une fois qu’on en donne le titre.
Tout compte fait, la photo ici est à la fois descriptive (informe sur une situation) et symbolique (joue sur les codes gestuels, chromatique et rhétorique entre occupants et occupés). L’action photographiée semble avoir été saisie sur le vif, pas de trucages techniques et veut attester ainsi de l’authenticité de l’événement. Le premier public visé en est les grandes autorités du Département d’ Etat, le public Etats-Unisien pour en montrer l’expansion au niveau politique et économique
des Etats-Unis dans les autres pays du continent américain. Le deuxième grand public qu’on peut viser c’est le public haïtien et tous les pays amis d’Haïti respectant l’autonomie de chaque pays libre et indépendant ainsi que les organisations progressistes sont les destinataires visés. En autre, on peut avancer que la présence des Marines a semé de troubles dans la société haïtienne, aussi a-t-elle laissé un lourd bilan pour le pays. Enfin, l’image, par sa sobriété et sa légende, montre sans artifices une situation d’humiliation inacceptable en démocratie, ce qui vient confirmer le rôle émotif que peut jouer une image qui informe certes, mais qui cherche aussi à faire réagir, à susciter la réflexion et éventuellement l’engagement.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est l’importance de la photographie documentaire pendant l’occupation américaine d’Haïti?
L’objectif principal est d’examiner comment les photographes créent des images inédites qui dépassent leur fonction documentaire initiale.
Comment la photographie représente-t-elle les Marines américains en Haïti?
L’image des Marines, se confondant avec la foule, laisse un sentiment de peur chez la population de Port-au-Prince et met en évidence les thèmes d’Occupation et de rapports occupé/occupant.
Quel est le contexte de la photo prise lors de l’invasion de Port-au-Prince en 1915?
La photo aborde la question de l’envahissement de la Marine des Etats-Unis en Haïti le 28 juillet, montrant la confusion entre les Marines et la population haïtienne, ainsi que le sentiment de peur et de domination.