L’analyse comparative de l’art de perdre révèle comment la fiction d’Alice Zeniter transforme notre compréhension des événements historiques algériens. En confrontant des choix complexes et des récits alternatifs, cette étude offre des perspectives inédites sur l’engagement et la mémoire collective.
L’insurrection dans les camps :
L’engagement au côté de l’armée française et choisir de faire confiance à De Gaulle pour l’auteure c’est un choix, Ali a fait son choix tout comme Youcef Tadjer qui prenait le maquis en songeant espérant une vie prometteuse, alors qu’il ne reste qu’à assumer les retentissements qui leur échoient.
49 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.143.
50 Ibid.
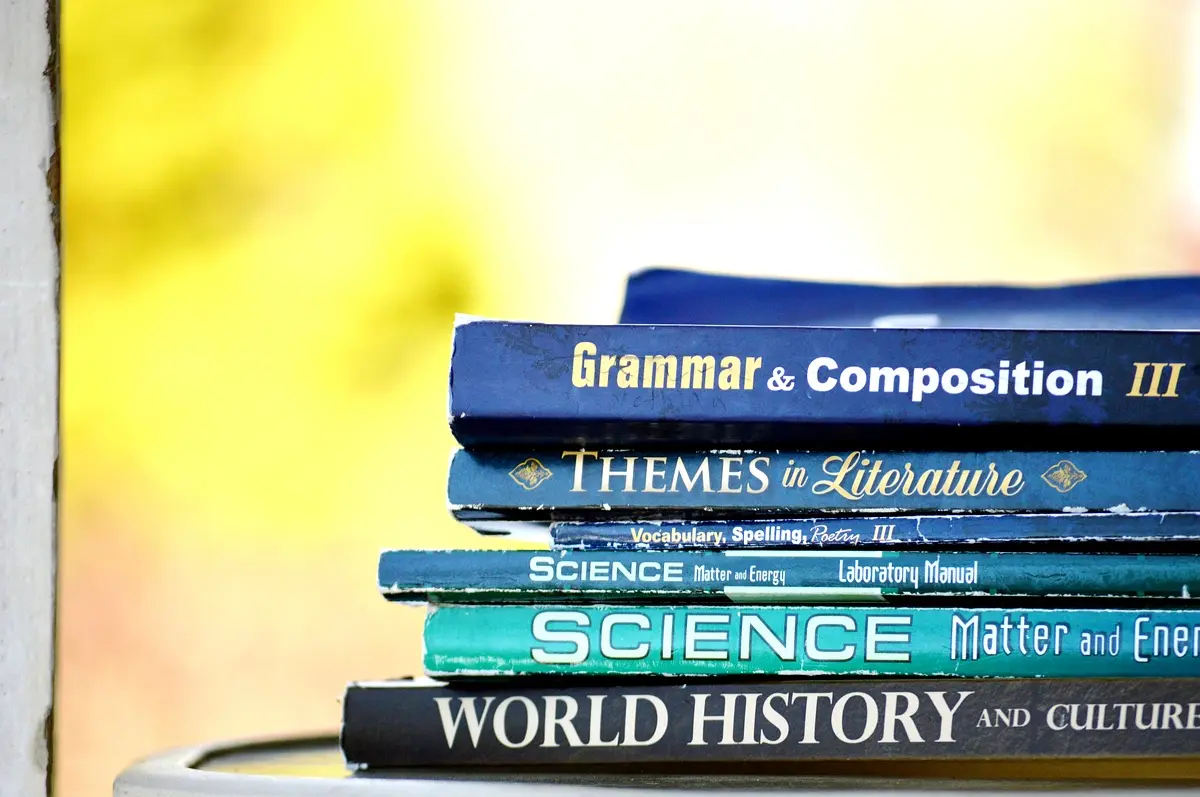
51 Ibid, p. 217.
52 Louis Aragon, Le mentir-vrai, France, Gallimard, folio, 1997.
53 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p.25.
Paradoxalement, la guerre provoque des blessures telles que même si les concernés payent pour les fautes commises auparavant, ses répercussions s’étendent également à leurs descendants. C’est pour cela que nous nous intéresserons dans cette analyse au processus par lequel Alice Zeniter reproduit l’Histoire des protagonistes sur lesquels tombent les rancœurs de la guerre.
Nous estimons que cette partie du corpus qui relate le soulèvement dans les camps est particulièrement d’une similarité évidente avec l’écriture documentaire et historiographique, vu les dates et les évènements authentifiés que comporte cette séquence. Néanmoins, dans un univers romanesque et abondamment fictionnel, elle finit par s’afficher sur l’écran d’ordinateur de Naima qui tente de creuser dans l’histoire de sa famille, alors l’Histoire se mêle avec des représentations fictionnelles telles :
« Naïma regarde sur les images d’archives de jeunes garçons s’agiter entre des baraquements tristement identiques et même si, bien sûr, aucun n’est Hamid, elle ne peut se défaire de l’idée qu’ils auraient pu être son père ou que son père aurait pu être parmi eux »54
Comme nous l’avons déjà mentionné, ce qui distingue l’écrivain de l’historien, c’est que l’écrivain valorise ce qui entoure l’Histoire, les sensations et la liaison familiale n’ont pas moins d’importance que les évènements historiques, alors l’auteure évoque rétrospectivement Hamid le petit, les émotions et les impressions flottantes.
Après des années d’internements dans des camps avec des conditions de vie insupportables, les fils des harkis se révoltent pour être considérés comme des français à part entière, tout court, c’est ce que transcrivent les historiens, et dont les propos ne se divergent pas beaucoup de ceux que retrace Alice Zeniter, à l’exception que celle-ci confond les parcours de ces personnes avec la trajectoire de Naima :
« Quand elle regarde les fils de harkis de Bias ou de Saint-Maurice-l’Ardoise dénoncer la pérennité de leurs prisons avec une surprise douloureuse, Naïma a sur eux l’avantage de savoir déjà que malgré toutes les appellations officielles, il n’existe pas de « transit » ni de « provisoire » dans le réseau des camps d’accueil. »55
Cette phrase est tellement révélatrice en ce qui concerne l’écriture littéraire de l’Histoire ; l’auteure en se servant du privilège de l’omniprésence établit une relation de son présent avec le passé qui est l’origine du problème, un passé qui empêche toute évolution de vie sociale des personnes dans la situation de Naima, passé qui condamne le présent 56et stipule la reconsidération dans une autre perspective loin des idéologies et de l’Histoire officielle.
À cette première tendance s’ajoute la compassion que l’auteure voudrait susciter pour les fils de harkis, en montrant la pénible souffrance dans les camps et en dénonçant la dissimulation des vérités historiques flagrantes ; l’auteure réussit cette stratégie en s’adressant aux émotions et à l’affect plutôt qu’au raisonnement des lecteurs avec une langue sensitive et émouvante :
« « Avant, on vivait dans l’ignorance. Maintenant la France sait », déclare un jeune garçon aux yeux tristes, filmé par FR3. Peut-être, mais qui regarde la télévision par ces chaudes journées d’août 1975 ? se demande Naïma. Éparpillés sur les plages de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée, la plupart des Français construisent des châteaux de sable sans prêter attention aux journaux. »57
Outre l’affectivité que provoque cet extrait, on pourrait distinguer une certaine ironie de la part de l’auteure, une écriture un peu légère et moins sérieuse par rapport à l’écriture historiographique qui repose sur des règles et des pédagogies.
En fait, quand l’auteure écrit l’histoire, elle n’est pas forcément en train de justifier ou légitimer, car elle est toujours dans la fiction, avec la particularité qu’elle traite le sujet avec le prisme du réel :
« Peut-être que c’est ce qui a maintenu les anciens habitants de Bias à proximité du camp pourtant haï : ils n’ont pas pu se décider à dissoudre une communauté dans laquelle ils étaient tombés d’accord sur une version de l’Histoire qui leur conviendrait à tous. Peut-être que c’est un socle de vie commune qu’on oublie trop souvent, mais qui est strictement nécessaire. »58
Machinalement, le mot « peut-être » susceptible d’exclure la fermeté et la certitude qui correspond à l’écriture historiographique, tandis qu’il laisse ouverte toute possibilité de soupçon ou de doute.
56Cours de M.Ouartsi, Problème du roman, L’historicité du texte littéraire, Novembre 2019.
57 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 507.
58 Ibid, p. 510.
________________________
49 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p.143. ↑
52 Louis Aragon, Le mentir-vrai, France, Gallimard, folio, 1997. ↑
53 Cécile Brochard, Expériences de l’histoire, poétique de la mémoire, France, ellipse, 2019, p.25. ↑
54 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 505. ↑
56Cours de M.Ouartsi, Problème du roman, L’historicité du texte littéraire, Novembre 2019. ↑
57 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 507. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment Alice Zeniter aborde-t-elle l’Histoire dans ‘L’Art de Perdre’?
Alice Zeniter reproduit l’Histoire des protagonistes sur lesquels tombent les rancœurs de la guerre, en mêlant des éléments fictionnels avec des événements authentifiés.
Quelle est la relation entre fiction et histoire dans ‘L’Art de Perdre’?
L’auteure utilise la fiction pour combler les lacunes historiques et offrir une perspective alternative sur les événements, valorisant les sensations et les liaisons familiales.
Pourquoi l’écriture d’Alice Zeniter est-elle considérée comme une écriture littéraire de l’Histoire?
L’écriture littéraire de l’Histoire par l’auteure établit une relation de son présent avec le passé, permettant une reconsidération des événements loin des idéologies et de l’Histoire officielle.