Le rejet de comptabilité en droit fiscal constitue une décision cruciale, permettant à l’administration de contester la validité des documents comptables et de redresser les bases d’imposition. Cet article analyse les implications de cette pratique sur la charge de la preuve et les droits des contribuables.
B- L’ambiguïté du rejet de comptabilité
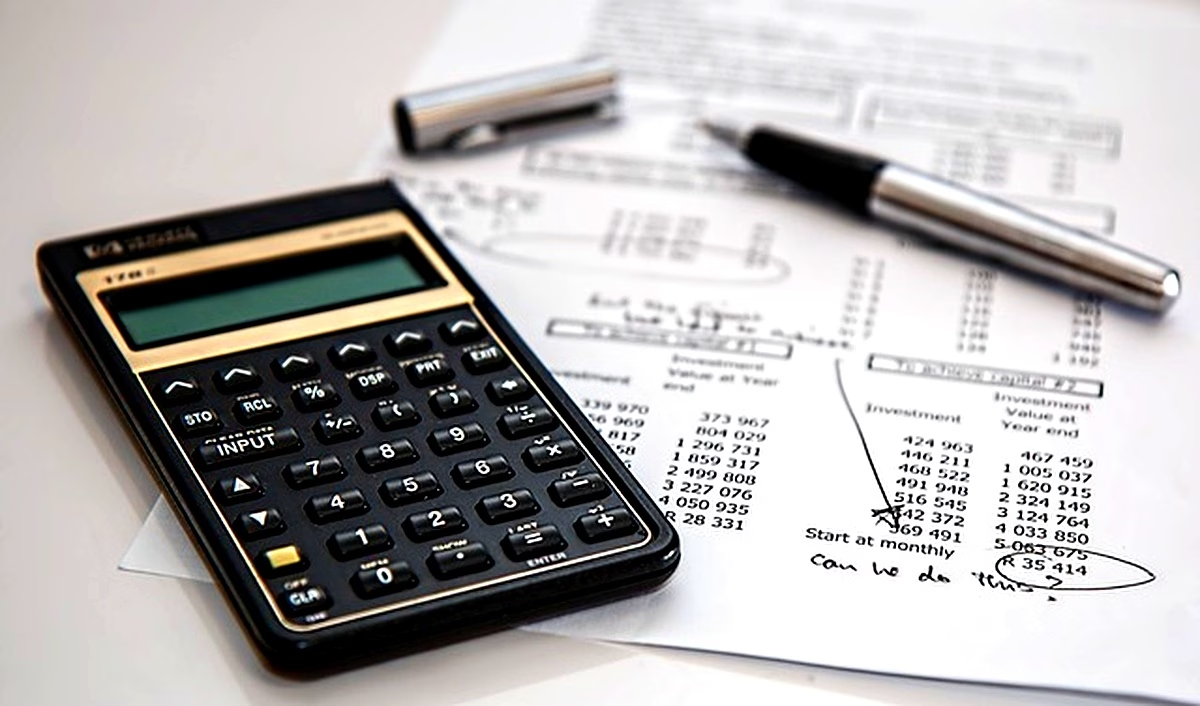
Le rejet de comptabilité – pouvoir reconnu à l’administration pour écarter une comptabilité jugée irrégulière et sans valeur probante1 – est « une décision grave de conséquences puisqu’elle permet de procéder au redressement des bases d’imposition sur des bases extra-comptables »2 et elle entraîne un renversement de la charge de la preuve au détriment du contribuable3.
Ainsi, il est important pour le contribuable de savoir les cas dans lesquels l’administration peut rejeter sa comptabilité. Fixer les conditions de rejet de comptabilité est en définitive fixer les conditions du recours aux présomptions et les conditions du renversement de la charge de la preuve. Les ambiguïtés qui entourent la notion de rejet de comptabilité peuvent se répercuter sur les garanties des contribuables.
Malgré sa gravité vis-à-vis des droits des contribuables, le rejet de comptabilité – dont l’utilisation est étroitement liée à la procédure de taxation d’office4 – demeure, en droit tunisien, une notion aux contours flous, même après la récente réforme fiscale5.
1 Jugement fiscal, n°36 en date du 9 octobre 2002, rendu par le T.P.I. de Sfax, chambre fiscale (inédit), voir en annexe n°2 de ce mémoire :
ﺎﻨ ﻥﻤ ﺭﻘﺘ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻥﺃﻭ ﺔﺼﺎﺨ ﻙﻟﺫ ﺕﺎﺒﺜﺇ ﻻﺇ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ لﻴﻭﻤﺘ ﻲﻓ ﻡﻫﺎﺴﺘ ﻡﻟ ﺀﺍﺩﻷﺎﺒ ﺏﻟﺎﻁﻤﻟﺍ ﺔﺠﻭﺯ ﻥﺃ ﻲﻋﺩﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻤ ﻪﻨﺃ ﺙـﻴﺢ
ﺔﻴﺢ
. »
| ﺔﻴﺤﺎﻨ ﻥﻤ ﺭﻘﺘ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻥﺃﻭ ﺔﺼﺎﺨ ﻙﻟﺫ ﺕﺎﺒﺜﺇ ﻻﺇ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ لﻴﻭﻤﺘ ﻲﻓ ﻡﻫﺎﺴﺘ ﻡﻟ ﺀﺍﺩﻷﺎﺒ ﺏﻟﺎﻁﻤﻟﺍ ﺔﺠﻭﺯ ﻥﺃ ﻲﻋﺩﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻤ ﻪﻨﺃ ﺙـﻴﺢ | … » | |
| . »ﺹﺎﺨ ﻁﺎﺸﻨ ﺀﺍﺩﻷﺎﺒ ﺏﻟﺎﻁﻤﻟﺍ ﺔﺠﻭﺯﻟ ﻥﺃ ﻯﺭﺨﺃ | ||
2 Voir sur la question :
- Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, « Notion de comptabilité probante », R.J.F. n°11, 1986.
- Françoise GARGOURI (née BEAUVAIS), « Le rejet de comptabilité », mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’expertise comptable, 1987.
- Philippe COLIN :
- « Comment éviter un rejet de comptabilité », Les Petites Affiches, 14 novembre 1984, n° 129 ;
- « L’audit fiscal et l’examen de la comptabilité par l’Administration Fiscale », Les Petites Affiches, 2 juillet 1984, n°79 ;
- « La vérification de comptabilité », Les Petites Affiches, 23 janvier 1984, n° 10.
- Fayçal DERBEL, « Comptabilité et vérification fiscale », R.C.F., n°49, 2000.
3 C’est-à-dire en retenant soit des données forfaitaires, soit des indices théoriques, soit des présomptions, A.YAICH, « La lettre fiscale », n°7, 2001, www.profiscal.com.
Comme l’a souligné Fayçal DERBEL, « le rejet d’une comptabilité équivaut à une absence de comptabilité et l’administration se trouve fondée à déterminer le bénéfice imposable au moyen de toutes présomptions de fait ou de droit », article précité, p.39.
4 Le contribuable taxé d’office suite à un rejet de comptabilité, rencontre des difficultés au niveau de l’administration de la preuve de l’exagération d’imposition d’office, voir infra, partie II, chapitre II, section I, paragraphe 2.
5 Habib AYADI, « Droit fiscal », C.E.R.P., Tunis, 1989, p.489.
6 Le C.D.P.F. – promulgué en l’an 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2002- n’a pas réglementé le rejet de comptabilité, ce qui est regrettable.
Dans la législation fiscale tunisienne, la notion de rejet de comptabilité apparaît en filigrane. « Les cas susceptibles d’entraîner le rejet de la comptabilité n’ont pas été définis et précisés au niveau de la réglementation fiscale en vigueur »6.
Le défaut d’un encadrement juridique du rejet de comptabilité a favorisé les abus de l’administration en la matière. Le rejet de comptabilité est devenu la source d’une « présomption de culpabilité ». En effet, les agents vérificateurs ont tendance à recourir d’une manière abusive et fréquente au rejet de comptabilité7. D’ailleurs, c’est de l’aveu de l’administration elle-même, il y a recours non fondé au rejet de comptabilité. Selon la note commune n° 16, du 2 mai 1967 : « En dépit des recommandations réitérées contenues dans les notes communes, les notices de vérification continuent à parvenir à la direction, trop squelettiques et ne contenant guère que des précisions vagues ou sommaires… Les rejets de comptabilité infondés, les affirmations gratuites et les coefficients appliqués bien loin d’être étayés par la réalité, demeurent toujours les leitmotive routiniers des notices »8.
De son côté, le T.A. se contente souvent d’utiliser des expressions assez vagues pour confirmer les rejets de comptabilité : « Considérant que le rejet de comptabilité était justifié par l’existence de plusieurs vices entachant sa régularité »9. De même, le rejet de comptabilité a été confirmé à plusieurs reprises par des décisions jurisprudentielles de la commission spéciale de taxation d’office10.
Il va sans dire que le rejet non-fondé d’une comptabilité entraîne un renversement abusif de la charge de la preuve au contribuable et une mise en échec injustifiable de la présomption d’exactitude de la déclaration.
Par ailleurs, et aussi étonnant que cela puisse paraître, l’administration fiscale fait recours à la taxation d’office, et provoque ainsi le renversement de la charge de la preuve au contribuable, même en cas de comptabilité déclarée régulière11. Il en résulte inévitablement une mise en échec injustifiable de la présomption d’exactitude de la déclaration et un renversement abusif de la charge de la preuve au détriment du contribuable12.
En droit fiscal tunisien, et contrairement au droit français13, le renversement de la charge de la preuve peut sanctionner des contribuables en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations comptables14.
« Cela fait penser aux exécutions d’otages innocents : on tire à vue sur n’importe qui, peu importe qu’il soit fraudeur ou non, tant pis si ce n’est pas un fraudeur ; il faut que cela serve d’exemple pour les fraudeurs ! »15.
1 « Les cas de rejet de comptabilité ne sont pas explicitement énumérés de manière claire et précise dans un texte légal. La seule disposition en la matière est prévue par l’article 66 du code de l’IRPP et de l’IS qui dispose que les contribuables qui ne se soumettent pas aux obligations prévues par l’article 62 dudit code peuvent être taxés d’office », Fayçal DERBEL, article précité, p.38.
2 H.AYADI, « Droit fiscal », éd. C.E.R.P, Tunis 1989, Série Droit Public n°6, p.265.
3 Voir cette note commune en annexe n°3 de ce mémoire.
4 T.A., 4 novembre 1991, req. n°933 ; T.A., 4 novembre 1991, req. n°934 ; T.A., 20 avril 1992, req. n°1027 ; T.A., 20 avril 1992, req. n°1028 ;
5 Le B.O.D.I. n°5 du 1er trimestre 1970 a repris quelques extraits de décisions justifiant le rejet de la comptabilité par l’administration.
6 C’est-à-dire sans rejet de comptabilité.
7 Cela entraîne aussi une atteinte au principe de la supériorité de la preuve comptable sur la preuve extra-comptable ; sur cette question voir infra partie II, chapitre I, section II.
8 En droit français, le renversement de la charge de la preuve est conçu en tant que sanction contre un contribuable en situation irrégulière et en plus il doit être justifié par une défaillance grave : défaut de déclaration, défaut de comptabilité, comptabilité comportant de graves irrégularités.
9 Cas d’une taxation d’office suite à un rejet non fondé d’une comptabilité et cas d’une taxation d’office en cas de comptabilité déclarée régulière.
10 P. AMSELEK, in « La taxation d’office à l’impôt sur le revenu », op. cit, p. 148.
Au terme de ces réflexions relatives au rejet de comptabilité, un constat se dessine et un souhait se fait sentir. Le constat est que la législation fiscale tunisienne ne fixe pas les critères de rejet de comptabilité et elle ne distingue pas, au niveau du renversement de la charge de la preuve, entre le contribuable tenant une comptabilité et celui qui n’en tient pas. Le souhait consiste en une double proposition :
1- La nécessité d’une distinction, au niveau du renversement de la charge de la preuve, entre les contribuables tenant une comptabilité et ceux qui n’en tiennent pas bien qu’ils y soient tenus
Comme l’a précisé le conseil économique et social, « il est nécessaire de distinguer entre celui qui tient une comptabilité et offre ainsi à l’administration un moyen de contrôle et celui qui ne la tient pas »16.
Ainsi, pour le contribuable qui ne tient pas une comptabilité bien qu’il y soit tenu, le défaut de comptabilité entraîne le renversement de la charge de la preuve à son encontre, à titre de sanction d’une défaillance grave.
En revanche, pour le contribuable tenant une comptabilité, c’est l’administration qui doit supporter la charge de la preuve. En effet, « les comptabilités régulièrement tenues bénéficient d’une présomption d’exactitude (du moins en ce qui concerne les éléments portant sur les éléments d’actif) et les mentions qui y figurent peuvent être combattues par l’administration, à condition qu’elle apporte la preuve de ses assertions »17.
Dans cette perspective, la C.S.T.O., en 1970, a pris soin de préciser que, « les énonciations d’une comptabilité complète s’imposent à l’administration qui a la charge de prouver leur inexactitude »18.
Ainsi, si l’administration n’arrive pas à prouver l’irrégularité de la comptabilité ou si elle déclare que la comptabilité est régulière, il ne peut y avoir renversement de la charge de la preuve au contribuable. C’est dans ce sens que s’est exprimé, fort heureusement, le T.A. dans un important arrêt du 23 octobre 199519 :
ﻑﻴﻅﻭﺘ ﻰﻠﻋ ﺽﺭﺘﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻀﺘﻘﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺓﺩﻨﻴﺘﺎﺒﻟﺍ ﺔﻠﺠﻤ ﻥﻤ 59 لﺼﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺩﻘﺘﻨﻤﻟﺍ ﺎﻫﺭﺍﺭﻗ ﻲﻓ ﺔﻨﺠﻠﻟﺍ ﺕﺩﻨﺘﺴﺍ ﺙﻴﺢ »
.ﻩﺩﺭﺍﻭﻤ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﺕﺒﺜﻴ ﻥﺃ ﻭﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﻑﻅﻭ ﺎﻤﻴﻓ ﻁﻁﺸﻟﺍ ﺕﺒﺜﻴ ﻥﺃ ﺎﺴﺃﺭ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺔﻴﻨﻭﻨﺎﻘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜﺸﻟﺍ ﺎﻬﻐﻴﺼﻟ ﺓﺩﻗﺎﻓ ﺀﺍﺩﻷﺎﺒ ﺏﻭﻠﻁﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﺎﺴﺤ ﺕﻨﺎﻜ ﻰﺘﻤ ﻻﺇ ﻩﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻍﻭﺴﻴ ﻻ ﺭﻭﻜﺫﻤﻟﺍ ﺹﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺙﻴﺤﻭ
ﺱﻔﻨ ﻥﻤ
58 لﺼﻔﻟﺎﺒ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻭﺼﻨﻤﻟﺍ ﻥﺌﺍﺭﻘﻟﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁ ﺝﺎﻬﺘﻨﺍ ﺕﺍﺀﺍﺩﻷﺍ ﺓﺭﺍﺩﻹ ﻪﻌﻤ لﻭﺨﻴ ﺎﻤﻤ ﺎﻬﺘﻘﻴﻘﺤﻟ ﺓﺩﻗﺎﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ
. »…ﺓﺭﻭﻜﺫﻤﻟﺍ ﺔﻠﺠﻤﻟﺍ
A la lecture de cet arrêt, il apparaît que le texte attribuant la charge de la preuve au contribuable taxé d’office, n’est applicable qu’en cas de comptabilité irrégulière. A contrario, si la comptabilité est régulière, ce qui est le cas en l’espèce, l’administration ne peut pas recourir aux présomptions et il n’y a pas renversement de la charge de la preuve. Il s’agit d’un arrêt très important dans lequel le T.A. bloque le renversement de la charge de la preuve en cas de comptabilité régulière. Cette position est louable.
1 L’avis du conseil économique et social concernant le projet de loi relatif à la promulgation du C.D.P.F., p. 12.
2 C.E. 7/01/1985, n°42202, R.J.F. 3/85, n°366, D.F. 85, n°14, comm.695 ; D.F. 85, n°25, comm.1183, conclusions FOUQUET, C.E. 04/04/1990, n°60128-82326-82781 L.T.M. Nautilus R.J.F. 6/90, n°736 et n°58269 Socapex, R.J.F. 6/90, n°646).
« Lorsque le contribuable est astreint à la tenue d’une comptabilité, si celle-ci est régulière en la forme, elle est réputée sincère et probante ; si elle entend l’écarter, notamment en vue de procéder à un redressement selon une méthode extra-comptable, l’administration supporte la charge d’apporter la preuve de son irrégularité formelle et, à défaut, de son insincérité », Daniel RICHER, « Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal », p. 314.
3 Décision n°161, publiée au BODI n°5- 1er trimestre 1970, p.19.
A. YAÏCH, « La doctrine administrative dans le cadre des nouvelles réformes », thème n°41, « Charge de la preuve en matière de contentieux fiscal », p.163, 164.
4 T.A., 23 octobre 1995, req. n°1186 (inédit), voir en annexe n°2 de ce mémoire.
En droit français, les irrégularités comptables étaient sanctionnées par la procédure de rectification d’office20. Mais, dans un mouvement de renforcement des droits du contribuable et de l’amélioration des relations entre ce dernier et l’administration, la loi de finances pour 198721 supprime la procédure de rectification d’office ainsi que son aspect le plus critiquable, c’est-à-dire l’attribution de la charge de la preuve au contribuable.
La procédure contradictoire est donc étendue à l’ensemble des reconstitutions du chiffre d’affaires et des bénéfices22, avec attribution de la charge de la preuve à l’administration fiscale. Selon l’article L. 192 du L.P.F., relatif à la procédure contradictoire : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’un redressement, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission.
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69 ».
Il en découle qu’en France, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de comptabilité régulière et même en cas de comptabilité irrégulière23. Le contribuable ne supporte la charge de la preuve qu’en cas de défaut de comptabilité ou en cas de comptabilité comportant de graves irrégularités. Mais même dans ce dernier cas, l’administration est tenue, devant le juge, de prouver l’existence de graves irrégularités. Aux termes de l’article L. 192 du L.P.F. : « La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge »24. Cette donnée ne fait en réalité que rappeler un principe général selon lequel l’administration doit toujours prouver que le contribuable était en situation de subir une procédure exceptionnelle25. En outre, elle confirme l’idée qu’en France le renversement de la charge de la preuve au contribuable reste une exception et il est conçu en tant que sanction d’une défaillance grave26.
1 Art. L. 75 du L.P.F.
2 « La loi de finances pour 1987 a été complétée par des textes ultérieurs comme la loi du 8 juillet 1987 relative à la charge de la preuve et plus encore par l’instruction de la DGI du 6 mai 1988 qui apporte des compléments substantiels sur les éléments de mise en œuvre de la procédure, en instaurant des critères de rejet des comptabilités ». Jean-Baptiste GEFFROY, « Grands problèmes fiscaux contemporains », P.U.F., 1993, p. 308.
- Loi n°861317 du 30/12/1986, D.F.87, n°2-3, comm.48 ; instruction DGI du 6/05/1988, B.O.D.G.I. 13 L-7-88, D.F. 88, n°20-21 ID et CA 9453.
- Loi n°87-5002, du 8/07/1987, article 10 modifiant l’article L.192 du L.P.F. ; D.F. 87 n°31-32, comm.1489.
3 Jean-Baptiste GEFFROY, « Grands problèmes fiscaux contemporains », P.U.F., 1993, p. 308, 309.
4 Voir le tableau résumant les règles d’attribution de la charge de la preuve en droit fiscal français, en annexe n°4 de ce mémoire.
5 L’amendement sénatorial, mettant à la charge de l’administration la preuve des graves irrégularités de la comptabilité a été jugé comme étant une solution nécessaire. L’administration, à partir de ce nouveau principe, ne pourra plus adopter de position trop facilement rigide, générale ou absolue relative à la valeur des comptabilités. Bâtonnier A. VIALA, « Le nouveau régime de la preuve dans les rapports entre le contribuable et l’administration fiscale, Lois des 30 décembre 1986 et 9 juillet 1987 », Gaz. Pal. 1987, 2ème sem., p.808.
6 J.-P. CASIMIR, « Le code annoté des procédures fiscales », éd. La ville-Guerin, 1996, p. 302.
7 Dans les propositions de réforme formulées par le rapport Aicardi, l’accent a été mis sur la nécessité d’« éliminer les exceptions injustifiées à la règle de base selon laquelle si le contribuable s’est acquitté de ses obligations déclaratives et le cas échéant comptables, c’est à l’administration qu’il appartient d’établir l’inexactitude des chiffres déclarés ».
Bâtonnier A. VIALA, article précité, p.805.
________________________
1 Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, « Notion de comptabilité probante », R.J.F. n°11, 1986. ↑
2 A.YAICH, « La lettre fiscale », n°7, 2001, www.profiscal.com. ↑
3 Fayçal DERBEL, « Comptabilité et vérification fiscale », R.C.F., n°49, 2000. ↑
4 Habib AYADI, « Droit fiscal », C.E.R.P., Tunis, 1989, p.489. ↑
5 Le C.D.P.F. – promulgué en l’an 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2002- n’a pas réglementé le rejet de comptabilité, ce qui est regrettable. ↑
6 Fayçal DERBEL, article précité, p.38. ↑
7 H.AYADI, « Droit fiscal », éd. C.E.R.P, Tunis 1989, Série Droit Public n°6, p.265. ↑
8 Note commune n°16 du 2 mai 1967. ↑
9 T.A., 4 novembre 1991, req. n°933 ; T.A., 4 novembre 1991, req. n°934 ; T.A., 20 avril 1992, req. n°1027 ; T.A., 20 avril 1992, req. n°1028. ↑
10 Le B.O.D.I. n°5 du 1er trimestre 1970. ↑
11 C’est-à-dire sans rejet de comptabilité. ↑
12 Cela entraîne aussi une atteinte au principe de la supériorité de la preuve comptable sur la preuve extra-comptable. ↑
13 En droit français, le renversement de la charge de la preuve est conçu en tant que sanction contre un contribuable en situation irrégulière et en plus il doit être justifié par une défaillance grave : défaut de déclaration, défaut de comptabilité, comptabilité comportant de graves irrégularités. ↑
14 Cas d’une taxation d’office suite à un rejet non fondé d’une comptabilité et cas d’une taxation d’office en cas de comptabilité déclarée régulière. ↑
15 P. AMSELEK, in « La taxation d’office à l’impôt sur le revenu », op. cit, p. 148. ↑
16 L’avis du conseil économique et social concernant le projet de loi relatif à la promulgation du C.D.P.F., p. 12. ↑
17 C.E. 7/01/1985, n°42202, R.J.F. 3/85, n°366, D.F. 85, n°14, comm.695 ; D.F. 85, n°25, comm.1183, conclusions FOUQUET, C.E. 04/04/1990, n°60128-82326-82781 L.T.M. Nautilus R.J.F. 6/90, n°736 et n°58269 Socapex, R.J.F. 6/90, n°646). ↑
18 Décision n°161, publiée au BODI n°5- 1er trimestre 1970, p.19. ↑
19 T.A., 23 octobre 1995, req. n°1186 (inédit). ↑
20 Art. L. 75 du L.P.F. ↑
21 Loi n°861317 du 30/12/1986, D.F.87, n°2-3, comm.48 ; instruction DGI du 6/05/1988, B.O.D.G.I. 13 L-7-88, D.F. 88, n°20-21 ID et CA 9453. ↑
22 Jean-Baptiste GEFFROY, « Grands problèmes fiscaux contemporains », P.U.F., 1993, p. 308, 309. ↑
23 Voir le tableau résumant les règles d’attribution de la charge de la preuve en droit fiscal français, en annexe n°4 de ce mémoire. ↑
24 L’amendement sénatorial, mettant à la charge de l’administration la preuve des graves irrégularités de la comptabilité a été jugé comme étant une solution nécessaire. L’administration, à partir de ce nouveau principe, ne pourra plus adopter de position trop facilement rigide, générale ou absolue relative à la valeur des comptabilités. Bâtonnier A. VIALA, « Le nouveau régime de la preuve dans les rapports entre le contribuable