La réactivité des oxydes métalliques est cruciale lors des traitements hydrométallurgiques, influençant la dissolution et la sorption à l’interface solide-liquide. Cette étude met en lumière la récupération du ZnO à partir du catalyseur ZnO/Al2O3 en utilisant des lixiviants naturels pour minimiser l’impact écologique.
Réactivité à l’interface solide liquide des oxydes métalliques
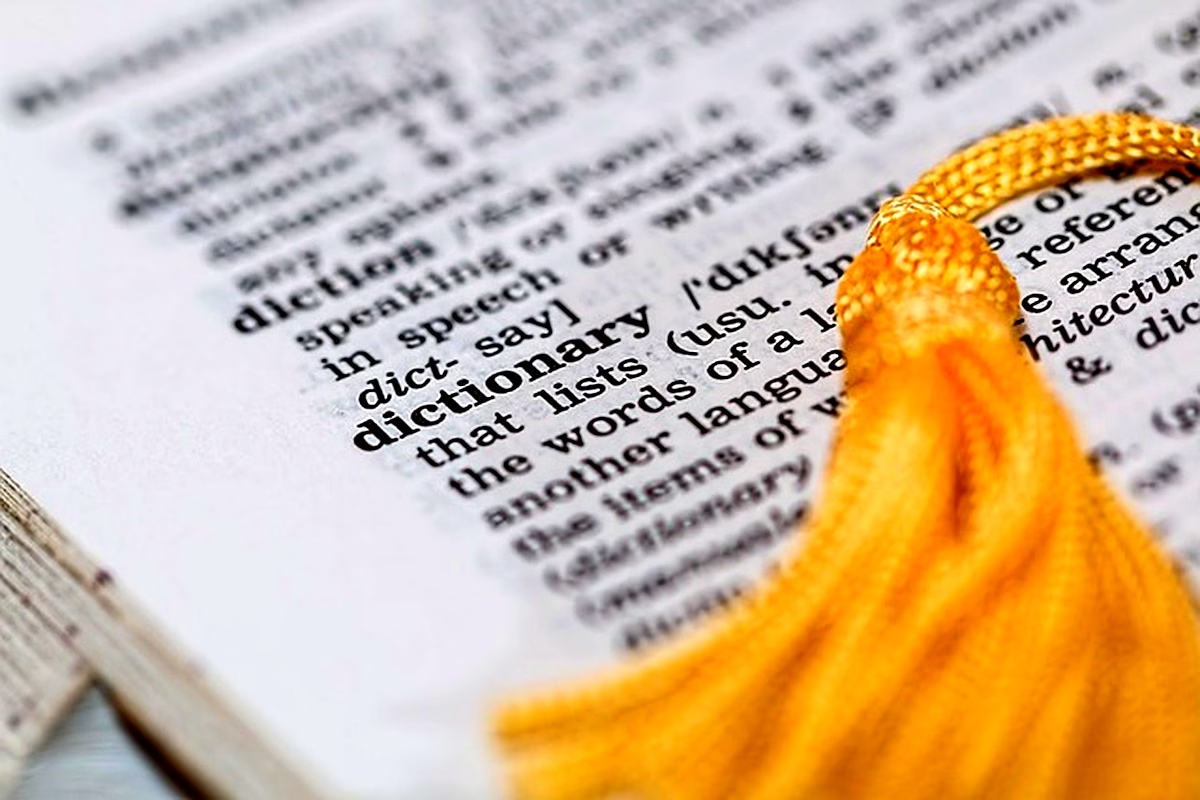
Lorsqu’un solide est mis en contact avec une phase aqueuse, la réactivité de sa surface se traduit par deux phénomènes principaux : la dissolution qui correspond à un transfert en solution des constituants du solide et la sorption qui correspond à un transfert des espèces en solution sur la surface du solide. Deux points essentiels caractérisent la surface des particules d’oxydes métalliques en solution et dominent leurs propriétés physico-chimiques.
1) La surface est fortement hydratée
2) Cette hydratation créée des groupes fonctionnels qui sont à l’origine de la charge électrique de cette surface. La dissolution de l’oxyde se traduit par le détachement de ces groupes fonctionnels1.
En l’absence d’eau, la surface d’un oxyde métallique est caractérisée par la présence d’atomes métalliques de faible coordinence impliquant une acidité de Lewis. Lorsqu’elle est hydratée, les molécules d’eau se combinent avec ces sites métalliques pour créer des groupements hydroxyles ≡Me-OH qui forment une monocouche plus ou moins complète (étape 1 de la Figure IV.6). Ces groupements sont facilement ionisables et peuvent se protoner ou se déprotoner créant ainsi une charge de surface (étape 2 de la Figure IV.6). Cette charge dépend du degré d’ionisation des groupements ≡Me-OH qui peuvent par réaction acide-base prendre une charge positive, négative ou neutre suivant la nature de l’oxyde, la composition, le pH et la force ionique de la solution.
Les groupements hydroxyles sont amenés à créer des complexes qui vont se détacher de la surface puis passer en solution. Les complexes les plus fortement liés aux atomes métalliques de la surface, avec perte partielle ou totale de leur sphère d’hydratation, sont appelés complexes de sphère interne. Les complexes liés à la surface par des forces électrostatiques sont appelés complexes de sphère externe. Enfin, les complexes totalement hydratés se détachent de la surface formant ainsi une couche diffuse. Ce phénomène est illustré dans la Figure IV.7.
[9_img_1]
Source : [14]
Fig. IV.6. Représentation schématique de l’hydratation de la surface d’un oxyde et de l’apparition de la charge de surface
[9_img_2]
Source : [14]
Fig.IV.7. Illustration du mécanisme de détachement des atomes métalliques de la surface d’un oxyde en milieu aqueux (la position, les charges électroniques et le nombre de molécules d’hydrogène et d’oxygène ont été choisis arbitrairement
Malgré le fait que les principales étapes de la dissolution des minéraux soient assez bien connues, les mécanismes qui caractérisent chacune d’elles, ainsi que les différents facteurs qui les affectent restent plus difficiles à préciser. La théorie de l’état transitoire (TST), qui fournit un cadre théorique, et l’approche de la chimie de coordination qui permet de caractériser la spéciation surfacique, peuvent être utilisées conjointement pour caractériser les réactions qui contrôlent la dissolution2.
La TST, qui a été développée par Eyring en 19353 puis appliquée aux interactions solide/solution par Lasaga en 19814 et Aagard & Hegelson en 19825, stipule que dans toute réaction chimique se produisant à la surface d’un solide, les réactifs sont en équilibre avec une espèce de plus haute énergie appelée complexe activé.
Plusieurs hypothèses sont postulées:
1) la sorption des réactifs est rapide
2) le détachement des atomes de métal du réseau cristallographique, c’est-à-dire la rupture des liaisons métal-oxygène, est l’étape cinétiquement limitante dans la réaction de dissolution
3) on néglige la réaction entre les molécules d’eau et les sites de surface de charge neutre dans la mesure où l’activité de l’eau est constante pendant la réaction.
La TST s’attache à caractériser les mécanismes de formation et de décomposition du complexe activé pour mieux quantifier les cinétiques globales des réactions. Elle a tout d’abord été établie pour l’étude des réactions chimiques élémentaires.
La chimie de coordination de surface proposée par Stumm67 prend pour hypothèse que la vitesse de réaction est proportionnelle à la concentration des groupes surfaciques complexés présents à la surface des solides. Cette approche repose sur l’observation que d’un point de vue chimique, la dissolution et la recristallisation des phases solides sont caractérisées par un changement de coordinence des réactifs.
Parmi les modèles développés pour rendre compte des phénomènes observés aux interfaces solide/solution, les modèles de complexation de surface apparaissent les plus à même pour décrire les processus gouvernant les réactions de dissolution. Ces modèles reposent sur une description à l’échelle moléculaire des interactions solide/solution et décrivent précisément la répartition des ions à l’interface.
Ils postulent l’existence de sites réactionnels en nombre fini et bien localisés sur la surface du solide, susceptibles de pouvoir fixer ou libérer des protons, permettant ainsi des échanges de protons (ou d’ions) entre surface et solution. Ces échanges conduisent à une modification de la charge superficielle du solide qui est compensée par les ions présents en solution.
L’existence de charges positives ou négatives modifie donc la répartition des ions en solution et conduit ainsi à la création d’une différence de potentiel entre surface et solution. Dans le cadre de la chimie de coordination, la compréhension des mécanismes de dissolution exige de connaître la chimie de la région interfaciale séparant le solide et la solution.
On peut ainsi caractériser la charge de surface, mais aussi la nature et la concentration des ions adsorbés à la surface en fonction du pH, de la température et de la chimie du milieu réactionnel. Elle se prête aussi à une interprétation thermodynamique dans le cadre de la théorie de l’état transitoire, les espèces adsorbées à la surface permettant de caractériser les précurseurs du complexe activé.
Revue bibliographique
De nos jours les travaux de recherche sur la lixiviation concernent de plus en plus la récupération des métaux à partir des déchets issus de l’industrie minière, la plupart ayant pour but l’amélioration de l’extraction du métal ciblé, comme on le verra ci-après pour les cas du zinc et du cadmium.
Une étude de la lixiviation d’oxyde de zinc a été réalisée dans différentes mines en Belgique, par quatre solvants : l’acide sulfurique, l’acide sulfureux, l’hydroxyde de sodium et l’ammoniac. Les résultats de lixiviation ont montré que la mise en solution au moyen de l’acide sulfurique donnait les meilleurs rendements. Aussi, l’hydroxyde de sodium offrait un bon rendement s’il est utilisé à des concentrations élevées. Plus du 90% du zinc sont dissout en 5 jours en utilisant H2SO4 à 35g/L et en 2,5 jours avec H2SO4 à 200g/L.
Les résultats ont montré que les silicates et les ferrites dans certaines mines sont difficiles à lixivier par H2SO4 à cause de formation du silica-gel. Ces problèmes montrent que le choix du solvant est fonction de la nature du minerai.
D’un autre coté, la lixiviation peut se faire par l’hydroxyde de sodium avec une concentration pouvant aller jusqu’à 240g/L mais la grande viscosité de la solution empêche le déroulement de la réaction dans de bonnes conditions.
Récupération hydrométallurgique du zinc à partir des cendres de traitement de galvanisation10
La récupération du zinc à partir des cendres de traitement de galvanisation a été étudiée sur des cendres qui contiennent 75,1% de zinc, 20% de chlore, 3,3% d’aluminium, 1,2% du fer ainsi que du silicium, du magnésium, du manganèse et du plomb (la concentration de ces derniers ne dépassent pas 0,3%).
La récupération a été réalisée par voie hydrométallurgique au moyen d’une lixiviation acide. L’agent lixiviant utilisé est l’acide sulfurique, avec une concentration du 10% et un rapport liquide/solide de 8/1 à la température ambiante. Après une heure de réaction 98% de zinc ont été dissout. Après l’étape de lixiviation, l’élimination des impuretés a été effectuée par précipitation en prenant comme agent neutralisant de l’oxyde de zinc ainsi que du charbon actif.
Lixiviation alcaline du zinc à partir des poussières métalliques provenant d’un four électrique11
La lixiviation alcaline du zinc à partir des poussières métalliques provenant d’un four électrique a été étudiée. Ces poussières métalliques sont constituées de 37,08% de fer, 12,2% du zinc ainsi que d’autres métaux tels que Cr, Cd, Pd et Al. Le zinc se trouve sous deux formes : la Franklinite (ZnFe2O4) et la zinicite (ZnO).
Le zinc a été mis en solution au moyen d’hydroxyde de sodium. Différentes techniques ont été mises en œuvre : une lixiviation en présence d’agitation, une lixiviation sous pression, une lixiviation précédée d’un prétraitement aux micro-ondes et une lixiviation assistée par ultrason. La température ainsi que la concentration de NaOH étaient les deux variables testées.
Les expériences ont montré que le taux de récupération du zinc était de 74%. Ceci est atteint après quatre heures de réaction à une température de 90°C, avec une concentration d’hydroxyde de sodium de 6M et avec un rapport solide/ liquide=1/10. Il a été observé que les prétraitements assistés par micro-ondes ainsi que par ultrasons n’amélioraient pas la récupération du zinc.
Dissolution d’un mélange d’oxydes métalliques contenant ZnO12
Le traitement des boues issues de certains procédés tels que « electroplating » et « mechanoplating » a été réalisé. Ces boues sont constituées de Zn, Fe, Ca et Si avec des quantités allant de 1 jusqu’à 10% de Al, Ba, Mg, Mn avec des pourcentages inférieurs à 0,1%. La dissolution de ces minéraux dangereux est réalisée en deux étapes : la première attaque est effectuée au moyen de l’acide sulfurique à un pH de 3-4 à la température ambiante et la seconde est mise en œuvre avec de l’acide sulfurique 0,5M à une température de 40°C et la majorité des métaux trivalents reste dans le résidu.
Cette étape est suivie d’une précipitation à l’aide de l’hydroxyde de zinc. Le précipité obtenu est calciné à T=800-1000°C, puis soumis à une deuxième étape de mise en solution. Le zinc extrait est neutralisé à pH=7 pour aboutir à un hydroxyde de zinc raffiné.
5. Le recyclage du zinc des poussières d’aciéries13
Les aciéries électriques rejettent et récupèrent, en moyenne, 20 kg de poussières par tonne d’acier recyclé. Ces poussières contiennent de 15 à 30 % massique de zinc avec des teneurs sensiblement égales en fer et environ 5 % de plomb. Le zinc provient principalement du recyclage de l’acier zingué. Lors du traitement de l’acier, le zinc, volatilisé, se retrouve sous forme d’oxyde ZnO et de ferrite ZnFe2O4 dans les poussières qui sont récupérées. Il existe un procédé développé par le groupe Arcelor mais non encore commercialisé appelé procédé REZEDA.
Les poussières sont lixiviées par une solution aqueuse de soude d’environ 7 mol.L-1. 65 % du zinc et 90 % du plomb contenu passent en solution qui contient ainsi environ 40 g. L-1 de Zn et 5 g. L-1 de Pb. Le plomb et la plupart des autres impuretés présentes sont extraits par cémentation à l’aide de poudre de zinc.
La solution de Zn2+ subit ensuite une électrolyse et donne de la poudre de zinc à 99,7 % de Zn. La solution qui après électrolyse contient environ 15 g. L-1 de Zn est recyclée en lixiviation. La poudre de zinc obtenue trouve ses principales applications en cémentation, dans les peintures anticorrosion et en catalyse.
Ce procédé est analogue à celui employé lors du traitement des minerais naturels. Dans ce dernier cas, la lixiviation acide est préférée car elle donne sur les cathodes, lors de l’électrolyse, directement du zinc massif au lieu de poudre en milieu alcalin, les utilisations du zinc massif étant plus importantes que celles des poudres.
Lixiviation du cadmium à partir des résidus (Ni-Cd) issus des unités de production du zinc14
Un gâteau contenant un mélange Cd-Ni est continuellement produit au cours des étapes de purification dans les unités de production électrolytiques du zinc. 50kg de ce résidu sont jetés chaque jour dans les décharges sauvages de l’Iran. Ce gâteau peut contenir jusqu’à 55% en Zn, 2% en Cu, 4% en Ni, 16% en Cd et 1,5% en Pb. Aussi, et afin de récupérer les métaux, une méthode d’extraction basée sur la lixiviation par l’acide sulfurique a été utilisée. Une quantité de ce gâteau a été séchée à 110°C pendant 24h ensuite broyée et tamisée.
L’analyse minéralogique de l’échantillon a montré que le cadmium existe majoritairement sous forme oxyde (CdO). L’étude des paramètres de lixiviation a concerné les effets de la concentration de l’acide sulfurique, de la température, de la granulométrie de l’échantillon, du rapport liquide/solide et de la vitesse d’agitation. Les résultats ont montré que les conditions optimales pour récupérer 85% du cadmium sont ; 1,7M H2SO4, 25°C, 125g/L, et 400tr/min.
Les résultats ont montré aussi que la vitesse de la réaction n’était pas sensible à la variation de la température et que la cinétique de dissolution du CdO était contrôlée par la diffusion à travers la couche de produits.
Etude de la lixiviation du cadmium à partir de 13 types de sols15
Le cadmium à travers les activités humaines s’est accumulé de manière dangereuse dans le sol destiné à l’agriculture dans le basin de Sichuan dans le sud de la chine. L’extraction du cadmium dans un réacteur Batch et en colonne a été réalisée afin de déterminer l’influence de paramètres tels que les propriétés du sol, la spéciation chimique, le temps de contact sol-eau, et le rapport sol/eau sur l’extraction du cadmium.
Les tests ont permis d’extraire 86 et 95% du cadmium par méthode batch et en colonne respectivement. Il a été trouvé également que le taux d’extraction est inversement proportionnel au pH du sol et à la quantité de matière organique présente dans le sol, et proportionnel à la quantité de cadmium dans le sol.
Cette dépendance peut être exprimée comme suit :
Quantité extraite de Cd (µg/g de sol) = -1,21 pH – 0,253 MO (g/kg) + 20,8 masse de Cd (mg/kg)
Conclusion
Depuis Noyes et Whitney les chercheurs n’ont cessé de s’intéresser et d’étudier la dissolution de différents matériaux solides dans différents milieux. Les études ne se sont pas limitées au domaine de la chimie, mais se sont étalées à d’autres domaines comme la pharmacie où la solubilité des médicaments dans le corps humain est très importante pour un effet optimal sur la santé. De même, en hydrométallurgie, la connaissance du comportement des métaux au cours de la lixiviation permet leur extraction de manière optimale à partir des minerais. Le modèle cinétique développé par Levenspiel a été appliqué aux particules réelles comme il a été rapporté par de nombreux auteurs.
Références
- Dokoumetzidis, A., Macheras, P., 2006. A century of dissolution research: From Noyes and Whitney to the Biopharmaceutics Classification System, International Journal of Pharmaceutics 321, 1–11.
- Noyes, A.A., Whitney, W.R., 1897. The rate of solution of solid substances in their own solutions. J. Am. Chem. Soc. 19, 930–934.
- Bruner, L., Tolloczko, S., 1900. Uber die Auflösungsgeschwindigkeit Fester Körper. Z. Phys. Chem. 35, 283–290.
- Brunner, E., 1904. Reaktionsgeschwindigkeit in heterogenen Systemen. Z. Phys. Chem. 43, 56–102.
- Nernst,W., 1904. Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit in heterogenen Systemen. Z. Phys. Chem. 47, 52–55.
- Hixson, A.W., Crowell, J.H., 1931. Dependence of reaction velocity upon surface and agitation. Ind. Eng. Chem. 23, 923–931.
- Wilderman, M., 1909. Uber die Geschwindigkeit molekularer und chemischer Reaktionen in heterogenen Systemen. Erster Teil. Z. Phys. Chem. 66, 445–495.
- Zdanovskii, A.B., 1946. The role of the interphase solution in the kinetics of the solution of salts. Zhur. Fiz. Khim. (USSR) 20, 869–880.
- Danckwerts, P.V., 1951. Significance of liquid-film coefficients in gas absorption. Ind. Eng. Chem. 43, 1460–1467.
- Levich, V.G., 1962. Physicochemical Hydrodynamics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NY.
- Yagi, S., Kunii, D., 1955. Studies on combustion of carbon particles in flames and fuidized beds. In: Fifth Symposium (International) on Combustion, Reinhold, New York, pp. 231–244.
- Yagi, .S and Kunii, D., 1961. Fluidized-solids reactors with continuous solids feed I, Residence time of particles in fluidized beds. Chemical Eng. Sci., 16, 364-371.
- Levenspiel, O., 1999. Chemical Reaction Engineering, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York.
- Bellefleur, A., 2012. Cinétique de reaction et solubilité des produits de corrosion dans les conditions physic-chimiques du circuit primaire des réacteurs à eau sous pression (REP), thèse de doctorat, Université de Toulouse.
- Claire, C., 2006. Etude expérimentale de la cinétique et des mécanismes d’altération de minéraux apatitiques. Application au comportement d’une céramique de confinement d’actinides mibeurs. Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier, Toulouse III.
- Eyring, L., 1935. The activated complex in chemical reactions, Journal of Chemical Physics, 3, 107-115.
- Lasage, A.C., 1981. Transition State theory. In kinetics of Geochemical Processes, (Ed. A.C. Lasaga and R.J. Kirkpatrick); Review in Mineralogy, Vol. 8, 135-169.
- Aagaadd, P., Helgeson, H., 1982. Thermodynamic and kinetic constraints on reaction rates among minerals and aqueous solutions II. Theoretical considerations, American Journal of Science, 282, 237-285.
- Stumm W., Kummert R., Sigg, L., 1980. A ligand exchange for adsorption fort the adsorption of organic and inorganic ligands at hydrous oxides interface. Croatica Chimica Acta, 53, 291-312.
- Stumm W., Furrer, G., Kunz, B., 1983. The role of the surface coordination in precipitation and dissolution of minerals, Croatica Chimica Acta, 56, 593-611.
- Alane, N., 2007. Récupération des composants des catalyseurs ZnO/Al2O3 et R62 (Pt-Re/Al2O3) par lixivation, mémoire de magister
- Frenay, J, 1985. Leaching of oxidized zinc ores in various media, hydrometallurgy, 15, 243-25.
- Dvorak, P., al, 2005. Hydrometallurgical recovery of zinc from hot galvanizing ask, hydrometallurgy 77, 29-33
- Dutra, A.J.B., 2006. Alkaline leaching of zinc from electric arc furnace steel dust, Minerals Engineering 19, 478-485.
- Rizet, L., Charpentier, P.E., 2000. Métallurgie extractive -hydrométallurgie. Techniques de l’Ingénieur, M 2235, 1-14.
- Safarzadeh ,M.S., Moradkhani,D., Ojaghi-Ilkhchi, M., 2009. Kinetics of sulfuric acid leaching of cadmium from Cd–Ni zinc plant residues. Journal of Hazardous Materials 163, 880–890
- Zheng,S., Chen, C., Li, Y., Li, S., Liang, J., 2013.Characterizing the release of cadmium from 13 purple soils by batch leaching tests. Chemosphere. 91(11), 1502-1507.
________________________
1 [14] Bellefleur, A., 2012. Cinétique de reaction et solubilité des produits de corrosion dans les conditions physic-chimiques du circuit primaire des réacteurs à eau sous pression (REP), thèse de doctorat, Université de Toulouse. ↑
2 [15] Claire, C., 2006. Etude expérimentale de la cinétique et des mécanismes d’altération de minéraux apatitiques. Application au comportement d’une céramique de confinement d’actinides mibeurs. Thèse de doctorat, Université Paul Sabatier, Toulouse III. ↑
3 [16] Eyring, L., 1935. The activated complex in chemical reactions, Journal of Chemical Physics, 3, 107-115. ↑
4 [17] Lasage, A.C., 1981. Transition State theory. In kinetics of Geochemical Processes, (Ed. A.C. Lasaga and R.J. Kirkpatrick); Review in Mineralogy, Vol. 8, 135-169. ↑
5 [18] Aagaadd, P., Helgeson, H., 1982. Thermodynamic and kinetic constraints on reaction rates among minerals and aqueous solutions II. Theoretical considerations, American Journal of Science, 282, 237-285. ↑
6 [19] Stumm W., Kummert R., Sigg, L., 1980. A ligand exchange for adsorption fort the adsorption of organic and inorganic ligands at hydrous oxides interface. Croatica Chimica Acta, 53, 291-312. ↑
7 [20] Stumm W., Furrer, G., Kunz, B., 1983. The role of the surface coordination in precipitation and dissolution of minerals, Croatica Chimica Acta, 56, 593-611. ↑
8 [21] Alane, N., 2007. Récupération des composants des catalyseurs ZnO/Al2O3 et R62 (Pt-Re/Al2O3) par lixivation, mémoire de magister. ↑
9 [22] Frenay, J, 1985. Leaching of oxidized zinc ores in various media, hydrometallurgy, 15, 243-25. ↑
10 [23] Dvorak, P., al, 2005. Hydrometallurgical recovery of zinc from hot galvanizing ask, hydrometallurgy 77, 29-33. ↑
11 [24] Dutra, A.J.B., 2006. Alkaline leaching of zinc from electric arc furnace steel dust, Minerals Engineering 19, 478-485. ↑
12 [25] Rizet, L., Charpentier, P.E., 2000. Métallurgie extractive -hydrométallurgie. Techniques de l’Ingénieur, M 2235, 1-14. ↑
13 [5] Nernst,W., 1904. Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit in heterogenen Systemen. Z. Phys. Chem. 47, 52–55. ↑
14 [26] Safarzadeh ,M.S., Moradkhani,D., Ojaghi-Ilkhchi, M., 2009. Kinetics of sulfuric acid leaching of cadmium from Cd–Ni zinc plant residues. Journal of Hazardous Materials 163, 880–890. ↑
15 [27] Zheng,S., Chen, C., Li, Y., Li, S., Liang, J., 2013.Characterizing the release of cadmium from 13 purple soils by batch leaching tests. Chemosphere. 91(11), 1502-1507. ↑