La présomption d’exactitude fiscale repose sur des fondements logiques tels que la structure du système déclaratif et les principes de bonne foi et d’innocence. Cet article analyse les déséquilibres dans la charge de la preuve et les implications pour l’administration fiscale.
D-Les fondements logiques de la présomption d’exactitude de la déclaration
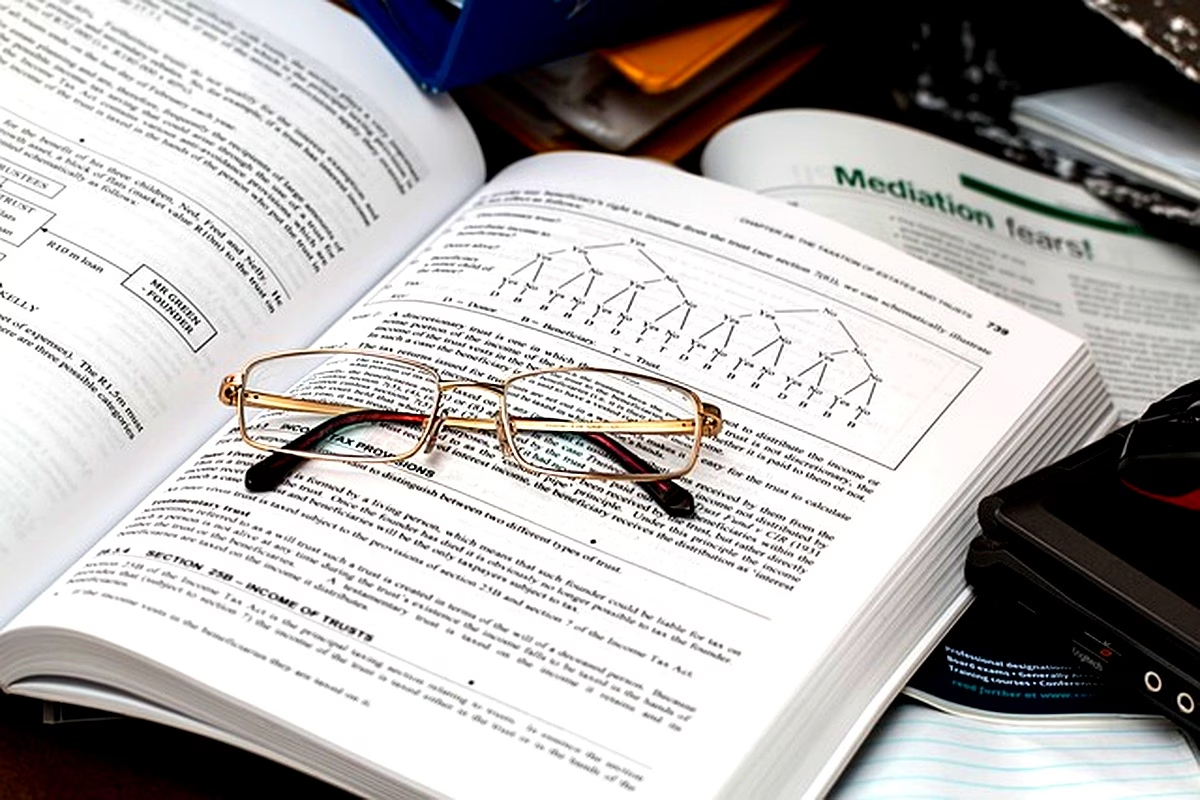
La logique s’allie au bon sens pour justifier la présomption d’exactitude de la déclaration. Plusieurs fondements peuvent être avancés à l’appui de cette présomption. Il s’agit de : la logique du système déclaratif (1), l’opposabilité de la déclaration au contribuable (2), la présomption de bonne foi (3) et la présomption d’innocence (4).
1) La logique du système déclaratif
Le choix du système déclaratif impose que les déclarations du contribuable bénéficient d’une présomption d’exactitude1 pour trois séries de raisons.
D’abord, le système déclaratif repose sur une participation active du contribuable au processus de l’imposition2. Il repose sur la bonne volonté et la sincérité du contribuable3. Ainsi, il est nécessaire, à défaut de preuve contraire, de considérer que le contribuable se plie de bonne foi à ses obligations4. L’absence de présomption d’exactitude attachée à la déclaration « ne débouche en effet aucunement sur une relativisation de la déclaration mais bien sur sa destruction »5.
Ensuite, on ne doit pas perdre de vue que l’existence d’une présomption d’exactitude attachée à la déclaration du contribuable permet de préserver une certaine cohérence du système déclaratif6. Si la déclaration n’est pas présumée sincère, l’administration devrait donc naturellement contrôler toutes les déclarations, or cela est difficilement envisageable.
Enfin et non de moindres, l’efficacité du système déclaratif est subordonnée à l’acceptation de l’obligation fiscale. « L’absence d’adhésion du contribuable au système fiscal en place et son hostilité à l’égard de l’Etat, constituent de sérieux obstacles à une mise en œuvre sincère et loyale de ce système »7. Or, le mutisme législatif sur la présomption d’exactitude de la déclaration et sur son corollaire, l’attribution de la charge de la preuve à l’administration fiscale, n’est pas de nature à favoriser l’adhésion du contribuable au système fiscal et son acceptation de l’obligation fiscale.
2) L’opposabilité de la déclaration au contribuable
« La déclaration engage le contribuable »8. Les termes de la déclaration sont tenus pour vrais contre celui-ci9. A cet égard, la déclaration constitue pour le fisc une véritable preuve qui peut être opposée au contribuable. Ainsi, la sous-évaluation d’un immeuble acquis peut se retourner contre l’acquéreur en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique10.
L’attribution à la déclaration d’une force probante contre son auteur peut, à notre sens, être une justification supplémentaire de la présomption d’exactitude de la déclaration. Etant donné que le fisc peut opposer la déclaration au contribuable lui-même, cela présuppose qu’elle est présumée exacte. Donc, la déclaration fait foi contre le contribuable, mais aussi elle fait foi pour le contribuable. « Le rejet de la présomption d’exactitude attachée à la déclaration transforme celle-ci en un simple renseignement…l’économie du régime de la déclaration contrôlée s’écarte sensiblement de ce cadre explicatif »11.
3) La présomption de bonne foi
La bonne foi est un principe général qui s’applique en droit fiscal12. Selon l’article 558 du C.O.C. « la bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n’est pas prouvé »13. « Les contribuables, dont la bonne foi est présumée, souscrivent des déclarations réputées sincères et complètes »14.
4) La présomption d’innocence
L’article 12 de la constitution tunisienne dispose : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ». Cet article qui concerne plus particulièrement la matière pénale, trouve pleinement sa place dans le domaine fiscal car le contribuable qui fait l’objet d’une procédure de contrôle est considéré comme fraudeur, donc coupable par l’administration avant même que n’aboutisse la procédure15.
La transposition de la présomption d’innocence en doit fiscal se justifie par le caractère contraignant de ce droit. « En matière répressive c’est à l’accusation de supporter la charge de la preuve de la culpabilité et non à la personne poursuivie de faire la preuve de sa bonne foi, donc de son innocence, et ceci à notre sens dans toute procédure contraignante, qu’elle soit pénale ou administrative »16 ou fiscale.
« Il ne serait pas abusif que la présomption d’innocence qui est un principe constitutionnel fondamental de la procédure pénale et qui est même inscrit dans la déclaration des droits de l’homme de 1789, soit transposée en matière fiscale. Lorsque la loi fiscale établit une présomption de fraude, elle renverse complètement la présomption d’innocence ; c’est une entorse considérable au principe fondamental de la matière… Abolir la présomption d’innocence ou la présomption de non-revenu, pour instituer exactement la présomption inverse…c’est vraiment aller trop loin »17.
Partant de ces prémisses, l’on est en droit de s’interroger sur la situation du contribuable contrôlé, en droit tunisien. Est-il présumé innocent et de bonne foi ?
Il est regrettable de relever que le pouvoir de contrôle reconnu à l’administration fiscale ne tient pas compte de la présomption d’innocence et celle de bonne foi. En effet, « devant les difficultés de pouvoir reconstituer la réalité du revenu imposable plusieurs années après, les agents vérificateurs inclinent souvent à poser en principe que leurs interlocuteurs sont des fraudeurs »18. Le contribuable, étant a priori regardé comme un fraudeur, peut être amené par là-même à se comporter en tant que tel, l’innocence risquant de lui être préjudiciable19.
Il convient d’avoir présent à l’esprit que le contribuable devrait être considéré et réputé comme un contribuable honnête. Ce n’est que lorsque sa situation fiscale est « mûrement examinée » et que son intention d’éluder l’impôt est établie, qu’il doit être traité comme un fraudeur20. Or, par son mutisme sur la présomption d’exactitude de la déclaration et son corollaire l’attribution de la charge de la preuve à l’administration fiscale, le législateur a ouvert le champ à l’arbitraire du fisc. On se demande alors s’il n’y a pas eu passage d’une présomption d’exactitude de la déclaration à une présomption d’inexactitude ?
Selon le professeur Néji BACCOUCHE, « aujourd’hui, l’environnement fiscal favorable suppose… une administration soumise au droit et particulièrement soucieuse des droits du contribuable qui doit être considéré, notamment lors du contrôle fiscal, comme un partenaire et non comme un » fraudeur présumé » »21. Ainsi, il est indispensable que la loi intervienne pour consacrer expressément, à l’instar du droit comparé, la présomption d’exactitude de la déclaration et son corollaire le principe d’attribution de la charge de la preuve à l’administration fiscale. En effet, « aujourd’hui, la grande question en matière de fiscalité n’est plus de savoir si un gouvernement fait mieux ou moins bien que ses prédécesseurs : la question est de savoir s’il fait mieux que ses voisins et concurrents »22.
Le moment est venu de rétablir un équilibre qui, de toute évidence, a été rompu. Comme l’énonce André BARILARI dans un ouvrage consacré au consentement à l’impôt, ce consentement doit, de nos jours, être accru d’une nouvelle dimension, celle du consentement au contrôle23. Le consentement au contrôle passe, inévitablement, par une consécration et un renforcement de la présomption d’exactitude de la déclaration, qui joue un rôle important dans l’attribution de la charge de la preuve à l’administration fiscale.
Paragraphe II : Le rôle de la présomption d’exactitude de la déclaration dans l’attribution de la charge de la preuve à l’administration
La présomption d’exactitude de la déclaration joue un rôle important en matière de preuve qui consiste dans l’attribution de charge de la preuve à l’administration. Ce rôle peut être justifié par l’opposabilité de la déclaration à l’administration fiscale (A) et par la nature de la présomption d’exactitude de la déclaration (B).
A- L’opposabilité de la déclaration à l’administration fiscale
Le fait de produire une déclaration entraîne son opposabilité à l’administration24. En effet, à chaque fois qu’un écrit bénéficie d’une présomption d’exactitude, le contenu de ces documents est opposable à l’administration jusqu’à preuve contraire25. A cet égard, « la déclaration couvre le contribuable et constitue une présomption en sa faveur »26, puisqu’elle fait supporter la charge de la preuve à l’administration27.
B – La nature de la présomption d’exactitude de la déclaration : une présomption simple
La présomption d’exactitude de la déclaration est une présomption simple. Le caractère simple d’une présomption implique la possibilité d’apporter la preuve contraire. Ainsi, l’administration fiscale supporte la charge de la preuve de l’inexactitude de la déclaration. Comme on l’a déjà précisé, ce principe de dévolution de la charge de la preuve au fisc est un principe bien établi en droit comparé28. D’ailleurs, en droit fiscal français, plusieurs décisions du juge de cassation « censurent le non-respect par le juge du fond des règles d’attribution initiale de la charge de la preuve, en réalité d’attribution du risque de la preuve »29.
Il convient de préciser que l’effet normal d’une présomption simple est de permettre à celle des parties contre laquelle elle joue d’apporter personnellement et intégralement la preuve contraire, et en principe par la voie juridictionnelle. Or, sur ce point, la présomption d’exactitude de la déclaration déroge à la règle générale. La voie juridictionnelle n’est pas, en matière fiscale, l’instrument normal de la preuve contraire30.
Il est significatif de relever que la preuve contraire revêt une spécificité en droit fiscal. En effet, « c’est au cours d’une phase pré-juridictionnelle que se noue la preuve contraire des déclarations dont l’appréciation est ainsi confiée à l’administration elle-même »31. L’administration fiscale, lors de la phase du contrôle, est à la fois juge et partie. Il va sans dire que la charge de la preuve qui lui incombe est une charge de la preuve pré-juridictionnelle, donc sans risque de la preuve32. Et c’est là l’une des manifestations du déséquilibre entre le fisc et le contribuable.
Certes, la charge incombant à l’administration lors du contrôle est utile, puisqu’elle permet de traiter le contribuable en tant que citoyen « honnête ».Mais, elle mérite d’être étendue au stade juridictionnel33. La preuve de l’inexactitude de la déclaration incombe à l’administration mais elle ne doit pas être fournie seulement à ce stade de la procédure34, elle devra l’être surtout au moment où le contribuable conteste le redressement par l’introduction d’une réclamation35.
« Est-ce à dire que l’administration doit supporter toujours et intégralement la charge de la preuve »36?
________________________
1 Sophie LAMBERT-WIBER, thèse précitée, p.292. ↑
2 B. DALBIES, « La preuve en matière fiscale », thèse précitée. ↑
3 N. BACCOUCHE, « Droit fiscal », E.N.A. 1993, p.145. ↑
4 M-C BERGERES, « Le principe des droits de la défense en droit fiscal », thèse Bordeaux 1975, p.49. ↑
5 M-C BERGERES, « La valeur juridique de la déclaration contrôlée », article précité, p.246. ↑
6 Sophie LAMBERT-WIBER, « Contribution du droit civil à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit fiscal », thèse, université de Rouen, 1996, p.293. ↑
7 Habib AYADI, « Droit fiscal », éd. C.E.R.P, Tunis 1989, Série Droit Public n°6, p.178. ↑
8 F-P DERUEL, « La preuve en matière fiscale », thèse précitée, p.219. ↑
9 C.E. 27 novembre 1931, req. 6619. ; C.E. 26 mars 1953, req. 96650. ↑
10 N. BACCOUCHE, « Droit fiscal », E.N.A. 1993, p.145. ↑
11 M-C BERGERES, « Le principe des droits de la défense en droit fiscal », thèse précitée, p.51. ↑
12 Emmanuel KORNPROBST, « La notion de bonne foi , application au droit fiscal français », thèse, L.G.D.J., 1980, 3éme partie, p.267. ↑
13 Article 2268 code civil français : « La bonne foi est toujours présumée ». ↑
14 H. AYADI, « Droit fiscal, Taxe sur la Valeur Ajoutée, Droits de consommation et contentieux fiscal », C.E.R.P., Tunis, 1996, p.173. ↑
15 Neila CHAABANE, « Les garanties du contribuable devant le juge fiscal », in actes de colloque sur le contentieux fiscal, faculté des sciences juridiques de Tunis, le 21 et 22 avril 1995, p.3. ↑
16 Thierry S. RENOUX, « La réforme de la justice en France : le juge et la démocratie », Gaz. Pal.- recueil janvier- février 2000, doctrine p.189. ↑
17 Jean FOYER, Rapport final de synthèse in « La taxation d’office à l’impôt sur le revenu », ( actes des journées d’études organisées par la société française de droit fiscal à Strasbourg 3 et 4 mai 1979), Annales de la faculté de Droit et des Sciences Politiques et de l’institut de recherches juridiques, politiques et sociales de Strasbourg, Tome XXXI, L.G.D.J. 1980, p.160. ↑
18 H. AYADI, « Droit fiscal », C.E.R.P., Tunis, 1989, p. 265. ↑
19 P. BELTRAME, « La résistance à l’impôt et le droit fiscal », R.F.F.P. n°5, 1984, p.29. ↑
20 Jamel AJROUD, mémoire précité, p.2. ↑
21 Néji BACCOUCHE, « L’environnement fiscal de l’entreprise à l’heure de l’internationalisation de l’économie : Le cas tunisien », in journées de l’entreprise 9 et 10 novembre 2001, Port El Kantaoui, édition préliminaire p.90. ↑
22 « Vers une société de confiance », Synthèse des propositions des forums, mardi 26 juin 2001. ↑
23 Alain ZENNER « Pour une nouvelle culture fiscale, simplification des procédures fiscales et lutte contre la grande fraude fiscale », Plan d’action du commissaire du gouvernement Alain ZENNER, mars 2001, p.5. ↑
24 Jean- Pierre KASZEWICZ, « Nouveaux aperçus sur l’autonomie du droit fiscal » , Thèse 1974, p.250. ↑
25 Dalbies BERANGERE, « La preuve en matière fiscale », Aix- Marseille, thèse 1992, p. 14. ↑
26 Jean WILMART, « Réflexions sur la décomposition et le déplacement de la preuve en droit fiscal », in mélanges en hommage à Léon Graulich, Liège 1957, p.165. ↑
27 Yves LHERMET, « Le face à face des contribuables et du fisc », R.F.F.P. 1984, n°6, p.160. ↑
28 Th. Afschrift, « Traité de la preuve en droit fiscal », Larcier 1998, p.69. ↑
29 Sophie LAMBERT-WIBER, « Contribution du droit civil à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit fiscal », thèse, université de Rouen, 1996, p.309. ↑
30 F-P DERUEL, « La preuve en matière fiscale », thèse 1962, Paris, p.228. ↑
31 F-P DERUEL, ibid. p.228, 229. ↑
32 C.L. LOUVEAUX, « La preuve en matière d’impôts directs », BRUYLANT, Bruxelles 1970, p.53. ↑
33 F-P DERUEL, « Quelques aspects du problème de la preuve en matière fiscale », D.F., 1962, n°37, p.44. ↑