La présomption d’exactitude en droit fiscal constitue un fondement essentiel de la charge de la preuve, attribuée à l’administration fiscale. Cet article analyse les déséquilibres dans son application et les implications des présomptions légales sur l’administration fiscale et les contribuables.
Section I :
Le fondement de la charge de la preuve incombant à l’administration fiscale : la présomption d’exactitude de la déclaration
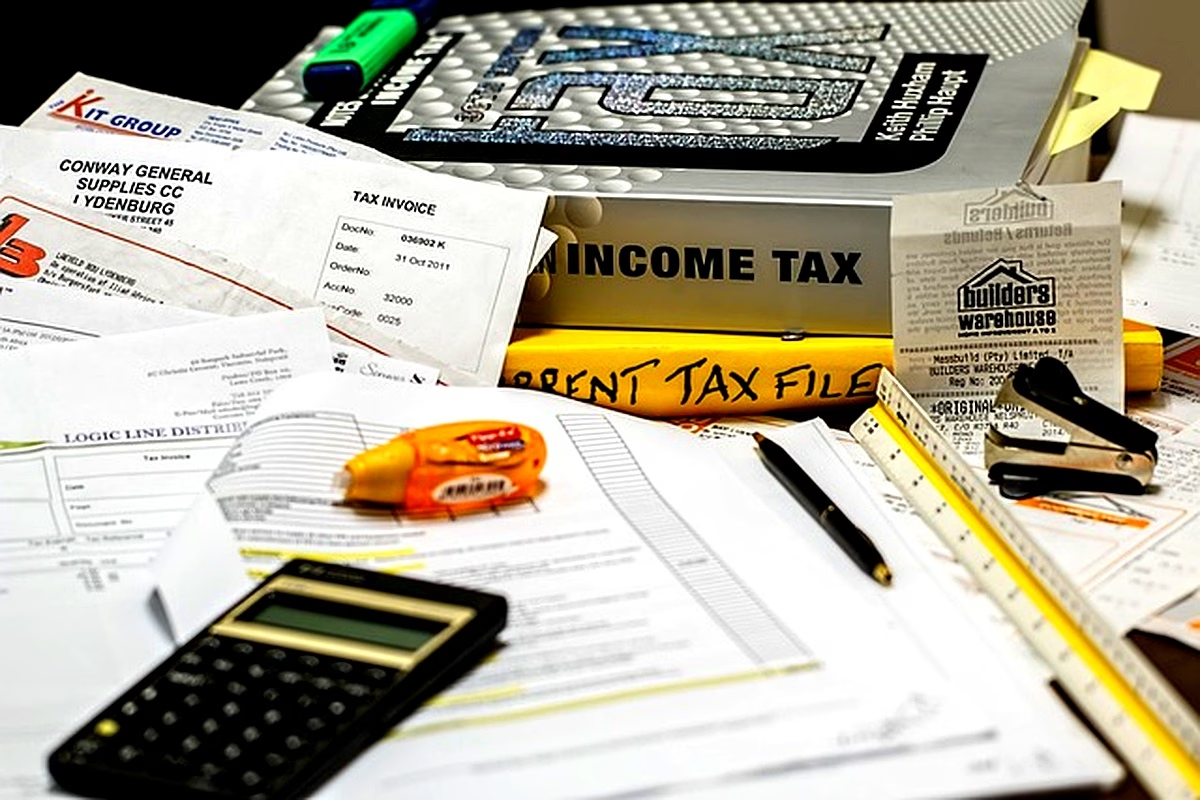
Plusieurs fondements peuvent justifier l’attribution de la charge de la preuve à l’administration fiscale, parmi lesquels figure la présomption d’exactitude de la déclaration1.
En droit fiscal français, le lien entre la présomption d’exactitude de la déclaration et la charge de la preuve est reconnu de la manière la plus expresse par le conseil d’Etat2. Il a été jugé que l’administration, qui veut imposer un contribuable sur des bases différentes de celles résultant d’une déclaration souscrite dans les formes et délais légaux, doit prouver que la déclaration est inexacte3.
En droit tunisien, le choix du système déclaratif exige la reconnaissance d’une charge de la preuve reposant sur l’administration fiscale, fondée sur la présomption d’exactitude de la déclaration. Dans cette perspective, on va procéder à la recherche du fondement de la présomption d’exactitude de la déclaration (paragraphe I), puis son rôle dans l’attribution de la charge de la preuve à l’administration fiscale (paragraphe II).
Paragraphe I : Les fondements de la présomption d’exactitude de la déclaration
Plusieurs fondements peuvent justifier la présomption d’exactitude de la déclaration. Ils sont à la fois : juridique (A), jurisprudentiel (B), théorique (C) et logiques (D).
A- Le fondement juridique de la présomption d’exactitude de la déclaration
En droit fiscal tunisien, il n’y a pas un texte juridique qui consacre expressément la présomption d’exactitude de la déclaration. Le code des droits et procédures fiscaux, tout en consacrant la déclaration spontanée de l’impôt en tant que devoir fiscal4, ne prévoit pas une présomption d’exactitude attachée à la déclaration.
On ne peut que regretter ce laconisme législatif dans un nouveau code qui se proclame code des droits des contribuables. Cela constitue un pas en arrière par rapport à la charte du contribuable. La charte, qui régissait les relations entre l’administration fiscale et les contribuables avant l’adoption et l’entrée en vigueur du C.D.P.F.5, consacrait explicitement dans son introduction la présomption d’exactitude de la déclaration : « le système fiscal tunisien se caractérise par le dépôt spontané des déclarations par les contribuables. Ces déclarations sont présumées exactes ».
En dépit de la valeur juridique controversée de la charte du contribuable6, la consécration de la présomption d’exactitude de la déclaration constituait -du moins théoriquement- une garantie pour le contribuable, surtout que le contenu de cette charte était opposable à l’administration7. La non-codification de cette présomption dans le C.D.P.F. est surprenante, surtout que l’objectif proclamé par ce code est, aux dires des pouvoirs publics eux-mêmes, de favoriser la déclaration spontanée de l’impôt8. Un tel objectif ne peut se réaliser qu’en assurant aux contribuables les garanties nécessaires.
On ne peut que regretter la disparition de la charte9, surtout que le code des droits et procédures fiscaux n’a pas repris toutes ses dispositions. Le législateur aurait pu, à l’instar du droit comparé, consacrer d’une manière solennelle la présomption d’exactitude de la déclaration. En droit fiscal belge, la présomption d’exactitude de la déclaration a un fondement légal consistant dans l’article 245 du CIR de 1992. Cet article dispose que « le fisc prend pour base de l’impôt le chiffre des revenus déclarés, à moins qu’il ne le reconnaisse inexact »10. Il s’agit d’une véritable présomption légale. En droit fiscal français, la présomption d’exactitude de la déclaration trouve son fondement dans la charte du contribuable11 et dans la loi du 15 juillet 191412. En plus, par une lecture a contrario d’un article du C.G.I., d’aucuns ont considéré que la déclaration est présumée exacte. Il s’agit de l’article 1649 quinquies A du C.G.I., selon lequel les redressements ne se conçoivent que lorsque la déclaration produite paraît être inexacte. Selon M-C BERGERES « ne doit-on pas, par là-même, a contrario, accorder une présomption d’exactitude à la déclaration régulièrement souscrite »13.
La consécration législative de la présomption d’exactitude de la déclaration serait une solution heureuse, qui inciterait les contribuables à l’accomplissement de leur devoir de déclaration. D’ailleurs, l’esprit de la législation fiscale tunisienne va dans ce sens, puisque le législateur a prévu plusieurs mesures pour encourager les contribuables au respect de leur obligation déclarative14.
B-Le fondement jurisprudentiel de la présomption d’exactitude de la déclaration
Pour la jurisprudence fiscale Belge, l’idée d’une présomption d’exactitude de la déclaration fiscale a été retenue par la cour de cassation qui a utilisé l’expression de ‘présomption d’exactitude’ dans plusieurs arrêts15. Pour ne citer qu’un exemple, dans un arrêt du 18 mai 1954, la cour de cassation belge a considéré qu’« une déclaration régulière fait foi jusqu’à preuve du contraire, sa force probante est fondée sur une présomption de sincérité »16. L’administration belge elle-même reconnaît qu’ « une déclaration régulièrement établie et déposée fait (…) foi jusqu’à preuve du contraire (…) Sa force probante est fondée sur une présomption d’exactitude »17.
Dans la jurisprudence fiscale française, le conseil d’Etat considère que « les déclarations faites par les contribuables bénéficient d’une présomption d’exactitude et de sincérité, ce qui permet l’établissement de l’impôt sur des bases en principe exactes »18.
En Tunisie, le T.A. a décidé que l’administration supporte la charge de la preuve des inexactitudes et des omissions relevées dans les déclarations19. A contrario, le T.A. accorde une présomption d’exactitude à la déclaration.
C-Le fondement théorique de la présomption d’exactitude de la déclaration
Certains auteurs ont tenté de fournir une justification théorique à la présomption d’exactitude qui est attachée à la déclaration du contribuable. A titre d’exemple, nous exposerons les explications avancées par M. Boulanger et G. Jèze20.
Selon M. Boulanger la présomption de sincérité de la déclaration trouve son fondement dans le serment produit par le contribuable à l’appui de cette pièce21. La bonne foi du contribuable était concrétisée par le serment. Il s’agissait d’une référence à l’honneur du contribuable.
Cependant, ce fondement ne peut plus être invoqué dans la mesure où la référence au serment a disparu des textes relatifs à l’impôt22. « La relativisation ou l’exclusion du serment demeure d’ailleurs une constante en droit fiscal »23.
Pour G. Jèze la présomption d’exactitude de la déclaration est liée à son caractère obligatoire. Pour cet auteur, la déclaration du contribuable, lorsqu’elle est exigée par la loi, doit être présumée exacte par l’administration24.
Cependant, quelle que soit la valeur des différents arguments théoriques avancés, force est de constater que l’existence d’une présomption de sincérité attachée à la déclaration du contribuable se justifie surtout par des fondements logiques.
________________________
1 Concernant les autres fondements, tel que le critère de demandeur effectif, l’article 554 du C.O.C. etc., voir infra, Partie I, Chapitre II. ↑
2 C.E, 24 juillet 1929, 1er esp., Lebon, p.213 ; M.-C. BERGERES, « Le principe des droits de la défense en droit fiscal », thèse, 1975, p.51. ↑
3 C.E, 13 novembre 1987, n°69967, R.J.F 1/88, n°102 ; Bérangère DALBIES, « La preuve en matière fiscale », thèse, université d’Aix-Marseille III, 1992, p.15. ↑
4 L’article 2 de la loi de promulgation du C.D.P.F. dispose que : « l’accomplissement du devoir fiscal suppose la déclaration spontanée de l’impôt… ». Il importe de préciser que le droit tunisien consacre le système de la déclaration. La loi 62-72 du 31 décembre 1962, portant institution d’une déclaration unique de revenus, prévoit des pénalités à l’égard des contrevenants aux prescriptions relatives à la déclaration. L’article 59 du CIR consacre l’obligation de souscription et de dépôt de déclaration annuelle. ↑
5 L’article 7 de la loi de promulgation du C.D.P.F. a abrogé l’article 63 du C.I.R qui constituait le fondement juridique de l’existence de la charte du contribuable. ↑
6 Sur la question voir : – Habib AYADI, « Droit fiscal, Taxe sur la Valeur Ajoutée, Droits de consommation et contentieux fiscal », C.E.R.P., Tunis, 1996, p.182-188. -Néji BACCOUCHE, « Contrôle et contentieux fiscal en Tunisie », Etudes Juridiques fac de droit de Sfax, n°4, p.17 et s. – Walid GADHOUM, « L’insuffisance de la protection du contribuable lors du contrôle fiscal », mémoire pour l’obtention du diplôme des études approfondies en droit des affaires, faculté de droit de Sfax, 1997, p. 28-32. – Hichem BEN ABDALLAH, « La charte du contribuable », mémoire pour l’obtention du D.E.A en droit public, université de Tunis III, faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 1991-1992, p.5 et s. – Med. Habib LTIFI, « La protection du contribuable en matière de contrôle fiscal », mémoire Tunis, 1998, p. 79-86. ↑
7 L’article 63 du C.I.R. disposait que : « l’administration met à la disposition des contribuables une charte dite « charte du contribuable », fixant leurs droits et obligations conformément à la législation en vigueur. Le contenu de cette charte est opposable à l’administration ». ↑
8 Les débats de la chambre des députés concernant le projet de loi relatif à la promulgation du C.D.P.F., n°39, séance du mercredi 26 juillet 2000, p. 2081, 2087. ↑
9 Sur la question de la suppression de la charte du contribuable, on consultera avec profit Jamel AJROUD, « Le principe du contradictoire pendant la vérification fiscale dans le nouveau code tunisien des droits et procédures fiscaux : Etude comparative avec le droit français », mémoire D.E.A. finances publiques et fiscalité, Université d’Aix-Marseille III, 2000-2001, p.44 à 47. Selon cet auteur, « L’existence concomitante des deux textes est possible, voire utile ». ↑
10 Voir sur ce point, C. L. LOUVEAUX, « La preuve en matière d’impôts directs », Bruxelles 1970, p.5. ↑
11 L’introduction de la charte française du contribuable prévoit que « l’examen de vos déclarations s’inscrit dans le cadre normal de notre système déclaratif. L’administration a pour mission de s’assurer de la régularité de vos déclarations qui sont présumées exactes et sincères ». -Au Canada, la déclaration des droits du contribuable canadien consacre la présomption d’honnêteté. En ses termes : « vous avez le droit d’être présumé honnête jusqu’à preuve du contraire ».Voir annexe n°4 de ce mémoire. -En Espagne, la charte des droits et garanties du contribuable espagnol consacre la présomption d’exactitude de la déclaration. voir annexe n°4 de ce mémoire. ↑
12 Christophe DE LA MARDIERE, « La déclaration fiscale », R.F.F.P. 2000, n°71, p.136, 137. ↑
13 M-C BERGERES, « Le principe des droits de la défense en droit fiscal », thèse Bordeaux 1975, p.44. ↑
14 Pour inciter les contribuables à l’accomplissement de leur devoir de déclaration : 1-Le législateur a subordonné l’octroi des avantages fiscaux au respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, l’article 111 du C.D.P.F. dispose que « Les avantages fiscaux ne peuvent être octroyés qu’aux personnes qui ont déposé toutes leurs déclarations fiscales… ». 2- Le législateur a facilité l’accomplissement de l’obligation fiscale La loi n°2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001 prévoit dans ses articles 57 et 58 la possibilité d’utilisation des moyens électroniques pour l’accomplissement des obligations fiscales. « Facilitation de l’accomplissement de l’obligation fiscale », Le décret n°2001-2802 du 6 décembre 2001, portant fixation de la procédure de dépôt de déclaration, états ou relevés fiscaux sur support électronique. 3- Le législateur a donné aux contribuables la possibilité de déposer des déclarations rectificatives avec des conditions avantageuses : *La loi n°2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001, articles 25, 26, 27, 28 et 29. *La loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002, article 39 : Prorogation des dispositions des articles 25, 26, 27, 28 et 29 4- le législateur a offert aux contribuables l’opportunité de régulariser leur situation avec le fisc. *La loi n°2002-1 du 8 janvier 2002, portant assouplissement des procédures fiscales, a, dans son article 5, donné aux contribuables défaillants la possibilité de déposer leurs déclarations d’une façon spontanée avant l’expiration du mois de juin 2002. – Dans le même ordre d’idées, le conseil économique et social a insisté sur la nécessité « d’encourager les contribuables transparents et qui déposent leurs déclarations dans les délais ». L’avis du conseil économique et social concernant le projet de loi relatif à la promulgation du C.D.P.F. (1998 Inédit ), p.3 ↑
15 Cass., 25 janvier 1949, cass., 18 mai 1954, cass. , 28 septembre 1965, cass. , 12 décembre 1974, cités par Th. Afschrift, « Traité de la preuve en droit fiscal », op. cit., p.70. ↑
16 Cité par C.L. LOUVEAUX, « La preuve en matière d’impôts directs », op. cit., p. 51. ↑
17 Th. AFSCHRIFT, ibid., p.70. ↑
18 C.E. 22 octobre 1976, D.F. 1977, n°16, 677, conclusions Lobry. Voir aussi, C.E. 21 novembre 1960 : « si l’administration entend rectifier les bases déclarées, elle supporte la charge de démontrer, au moins initialement, que la déclaration est inexacte », Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, p.442. C.E. 13-11-1987, « L’administration qui veut imposer un contribuable sur des bases différentes de celles résultant d’une déclaration souscrite dans les formes et délais légaux, doit prouver que la déclaration est inexacte », B. DALBIES, « La preuve en matière fiscale », thèse précitée, p.15. ↑
19 T.A. 10 mai 1993, req. n°1055 ; H. AYADI, « Droit fiscal, Taxe sur la Valeur Ajoutée, Droits de consommation et contentieux fiscal », C.E.R.P., Tunis, 1996, p.173, n°353. Cette jurisprudence fiscale sera développée dans la section I du chapitre II de la partie I de ce mémoire. ↑
20 Sophie LAMBERT-WIBER,, « Contribution du droit civil à une approche renouvelée de la charge de la preuve en droit fiscal », thèse, université de Rouen, 1996,p.291. ↑
21 En droit français, « La déclaration souscrite sous la foi du serment fut introduite par l’article 86 du décret du 15 octobre 1926 portant codification des textes législatifs relatifs à l’assiette des impôts sur le revenu « tous les contribuables passibles de l’impôt étaient tenus de souscrire et de renouveler chaque année, sous la foi du serment, une déclaration de leur revenu, avec l’indication, par nature du revenu des éléments qui le composent » ; CE 25 mars 1935, M-C BERGERES, « Le principe des droits de la défense en droit fiscal », thèse, université de Bordeaux I 1975, p.48. ↑
22 Sophie LAMBERT-WIBER, thèse précitée, p.292. ↑
23 M-C BERGERES, « Le principe des droits de la défense en droit fiscal », thèse précitée, p.48. voir aussi infra partie II, chapitre II, section II. ↑
24 Pour G. Jèze la présomption d’exactitude de la déclaration est liée à son caractère obligatoire. Pour cet auteur, la déclaration du contribuable, lorsqu’elle est exigée par la loi, doit être présumée exacte par l’administration. ↑