Cette étude révèle comment l’utilisation autonome du manuel scolaire en FLE transforme les activités écrites en classe de 4ème année primaire. Découvrez les défis rencontrés par les élèves et les solutions pratiques pour améliorer leur compréhension des consignes.
Partie pratique
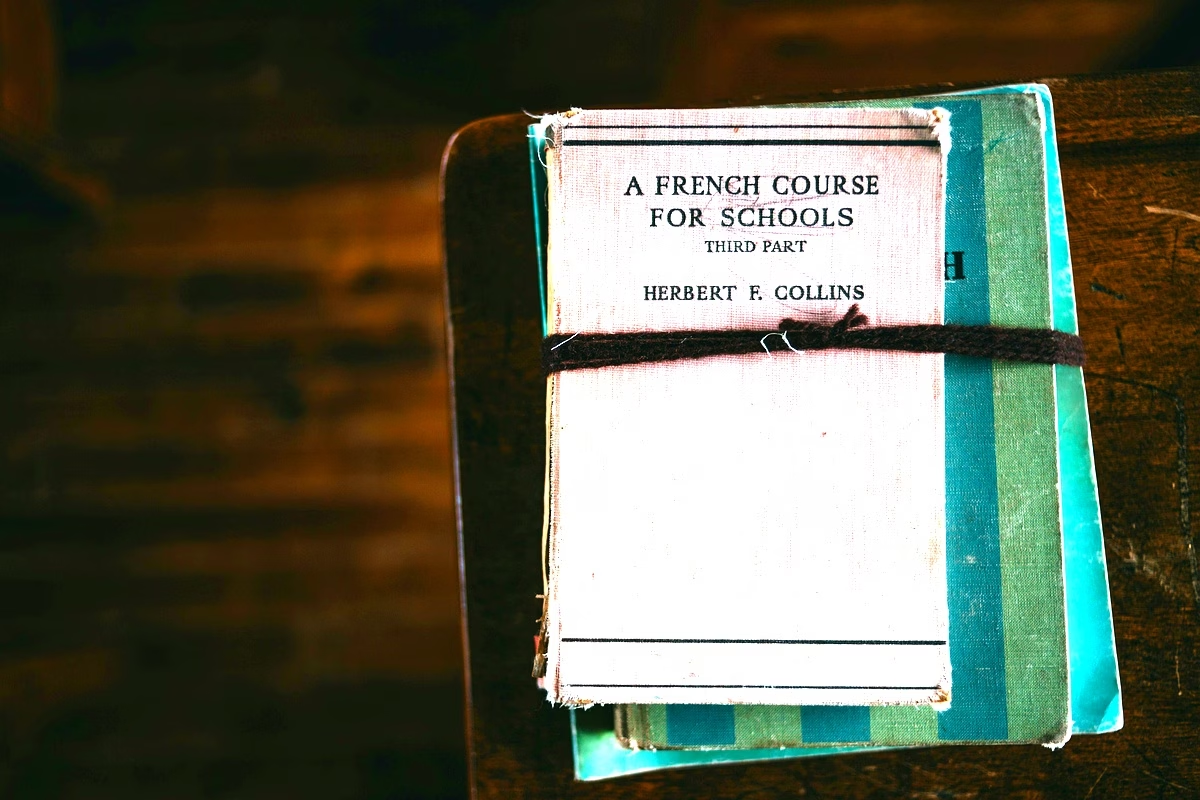
- Définition de la méthodologie utilisée.
- Echantillon choisi.
- L’application des activités écrites par l’échantillon choisi.
- Analyse et synthèse.
Partie pratique ………………………………..………………………..……………………………..
1. Définition de la méthodologie choisie:
La Méthodologie de la Recherche Expérimentale :
Est un ensemble de méthodes et modes de raisonnement destinés à tout expérimentateur désirant faire de la planification expérimentale.
Elle a pour objet de lui permettre d’optimiser l’efficacité de sa recherche expérimentale quelle que soit sa branche d’activité.
Pour ce faire, elle va l’aider à exprimer au mieux son problème et lui proposer des stratégies expérimentales (enchaînements de plans d’expériences dans le temps) optimales en fonction des objectifs qu’il s’est fixé et des moyens dont il dispose.
Les objectifs peuvent être d’explorer un domaine expérimental inconnu (recherche exploratoire dans le domaine de variation d’un ensemble de facteurs), d’isoler les facteurs influents (criblage),d’élaborer des modèles descriptifs ou prévisionnels des phénomènes étudiés (étude quantitative des facteurs, étude quantitative des réponses),d’effectuer des optimisations, de mettre au point des formulations avec ou sans contraintes (mélange),d’améliorer la qualité de produits…
Pour trouver certaines réponses aux questions que les chercheurs se posent, il faut parfois faire une expérimentation, c’est-à-dire faire une expérience afin de prouver si la théorie est correcte. Il existe plusieurs éléments importants dans la recherche expérimentale : la théorie, l’hypothèse, les variables indépendantes et dépendantes et les contrôles expérimentaux. Cela permet d’étudier les relations de cause à effet et, de cette façon, de décrire le comportement.
LA THEORIE: La plupart des recherches commencent par une théorie. Les chercheurs ont une idée et des arguments en tête afin de confirmer leur première idée. Les théories sont des explications du comportement humain élaborées à la suite de recherches, d’observations, d’études comparatives, etc.
L’HYPOTHESE: Après avoir étudié les théories du comportement humain, le scientifique va mettre en place une hypothèse, c’est-à-dire qu’il va expliquer tel ou tel comportement, pensée, etc. avant de la vérifier. L’hypothèse se base sur l’observation ou/et l’expérience personnelle. Une hypothèse peut être fondée ou non. Elle n’est qu’une explication possible d’un comportement et doit être vérifiée dans le cadre d’une étude scientifique.
VARIABLE: Après avoir formulé une hypothèse, l’expérimentateur élabore une méthode de recherche lui permettant de la vérifier. Ce travail consiste à choisir les éléments qui pourront être modifiés et feront l’objet d’une manipulation directe. Ces éléments seront appelés « variables ». Les variables peuvent être le temps, le poids, la distance, les points obtenus à un test, le nombre de réactions, etc. L’expérimentateur doit maintenir constantes les variables afin qu’il n’y ait pas de réaction chez le sujet.
Partie pratique ………………………………..………………………..……………………………..
VARIABLE INDEPENDANTE: C’est un facteur qui est choisi et manipulé par l’expérimentateur et qui est totalement indépendant de ce que fait le sujet.
VARIABLE DEPENDANTE: C’est un comportement mesurable observé chez un sujet et qui est influencé par la variable indépendante.
LES CONTROLES EXPERIMENTAUX: Toute expérience exige qu’au moins deux groupes soient présents afin de les comparer l’un à l’autre. Car sans comparaison, il est impossible de faire un constat ! La variable indépendante peut être un des facteurs de comparaison. Les sujets d’un groupe sont placés dans les mêmes conditions que ceux de l’autre groupe, mis à part qu’ils n’auront pas affaire à la variable indépendante. Cette situation est appelée « condition contrôlée ».
LA REPARTITION DES SUJETS DANS DES GROUPES: L’expérimentateur peut généralement faire des groupes au hasard, mais s’il veut pourtant avoir un échantillon représentatif, il peut faire un pré test afin d’évaluer certains facteurs qui pourraient modifier le résultat de l’expérience.
LES PARTIS PRIS ET LES BIAIS POSSIBLES DANS LA RECHERCHE :
Les expérimentateurs ont tendance à influencer le résultat de l’expérience selon leur degré d’investissement. Afin d’éviter ce genre d’erreur, L’expérimentateur peut enregistrer l’expérience et faire appel à une personne neutre afin de ne pas participer directement à l’élaboration de l’expérience.
Il est aussi possible de faire en sorte que l’expérimentateur ne sache pas lequel des deux groupes est le groupe témoin et lequel est le groupe expérimental. Il faut aussi faire attention au biais de l’échantillon, c’est-à-dire à sa tendance à ne pas être vraiment représentatif de la population étudiée. Il est très important de s’assurer que l’échantillon est représentatif car les résultats seront appliqués pour l’ensemble de la population, les chercheurs vont généraliser.
PROTOCOLE: Façon dont l’expérience se déroulera. AVANTAGES : Cela donne des résultats très précis, cela permet de trouver les causes du comportement.
INCONVENIENTS: Les sujets peuvent être perturbés à la fin de l’expérience et ce genre de méthode de recherche prend beaucoup de temps et coûte beaucoup d’argent.
L’échantillon choisi :
Nous avons choisi douze élèves (de manière arbitraire) d’une classe de 4eme AP d’une école située dans une région semi urbaine.
L’application des activités (exercices):
Dans notre modeste travail nous avons fait des observations des élèves (L’échantillon choisi), qui ont des difficultés d’aborder les consignes des activités écrites du le manuel scolaire. Pour vérifier notre hypothèse nous avons procédé une expérience dans deux jours .Le premier jour en donnant aux élèves une activité écrite englobe des consignes choisies au hasard du manuel de la 4eme AP P 56 Proj 2 Séq 2, P 64 Proj 2 Séq 3, P72 Proj2 Séq 4, P23 Proj 4 Séq1.Les élèves font l’exercice. La durée une heure. Le deuxième en présentant une autre activité écrite qui porte des consigne suggérées et reformulées selon les critères qui conviennent avec le niveau et les besoins des élèves. Les apprenant font l’exercice .la durée une heure.Après corriger toutes les copies, nous avons fait une comparaison entre les résultats obtenus dans les deux activités.
| Elèves | Note obtenue dans la 1ere activité | Note obtenue dans la 2eme activité |
|---|---|---|
| A B C D E F G H I J K L | 2.25/10 1.75/10 0.25/10 0.25/10 0.75/10 0.5/10 0.75/10 1.5/10 1.25/10 0.25/10 1/10 0.75/10 | 6.5/10 5.5/10 4/10 4/10 4.75/10 4.25/10 2.75/10 4.5/10 4/10 2/10 4.75/10 4.2510 |
4. Analyse et synthèse:
Après avoir corrigé les copies des deux activités, nous avons remarqué que les élèves ont obtenus de bons résultats dans la deuxième activité (exercice avec consignes suggérées et adaptées selon le niveau des élèves) par rapport aux résultats de la première activité (exemples relevés du manuel scolaire 4 AP). Nous avons constaté que les élèves éprouvent des difficultés à comprendre les consignes du manuel scolaire. Par contre ils ont bien assimilé les consignes reformulées. Et les notes portées sur le tableau ci-dessus élucident la progression des résultats.
Donc, nous pouvons dire qu’il faut amener progressivement l’élève à décrypter correctement la consigne pour qu’il accède à une certaine autonomie dans son travail et qu’il s’implique dans son apprentissage.
Conclusion
Le manuel scolaire constitue une dimension capitale du bagage scolaire. C’est un outil de travail prévilégié, essentiel pour mener à bien les activités d’enseignement apprentissage pour l’apprenant, l’enseignant mais aussi les parents qui peuvent faire le suivi de l’apprentissage de leurs enfants. Pour ce faire, on mettra en revanche l’accent sur les activités écrites dans le but de d’amener l’apprenant à exercer ces activités sur de nombreux objets d’apprentissage et d’une façon autonome pour assurer la transférabilité des compétences. Cette fonction d’intégration se réaliserait à partir de la mise en pratique de diverses formes de consignes.
Ces consignes posent souvent des difficultés de compréhension aux élèves, elles doivent faire l’objet d’une action approfondie. Il faut faire un véritable travail autour des consignes pour aider les élèves à être des décodeurs de consignes, y compris de mauvaises consignes (mal formulées), mais aussi d’éveiller leur sens critique, c’est-à-dire réfléchir sur le sens, la pertinence de celles-ci. Les élèves vont se retrouver en autonomie face à la lecture de consignes dans les différentes évaluations (examens concours…) qui jalonnent leur scolarité.
Pour cela deux directions de travail s’imposent :
– La première s’adresse à l’enseignant, à qui il appartient d’effectuer un contrôle vigilant et précis des consignes qu’il propose. En effet, une consigne se doit de répondre à des objectifs précis et de s’adapter au niveau du public auquel elle est destinée. nous pensons qu’un des meilleurs moyens est de se questionner sur la formulation de chaque consigne afin de s’assurer que celle-ci est suffisamment claire et précise pour les élèves. D’autre part, nous avons pu constater que cette réflexion portée sur les consignes permet au moment de sa passation d’être plus en confiance et d’avoir imaginé les éventuels questionnements qu’elle pouvait susciter chez les élèves.
Travailler sur la consigne proprement dite ne suffit pas, il faut aussi que l’enseignant conduise les élèves à adopter des conditions propices à l’écoute au moment de la présentation des consignes. Les stratégies à envisager sont différentes suivant le niveau de classe :
pour la première année du FLE (3emeAP), nous avons remarqué que les actions les plus efficaces pour ramener les élèves au calme sont celles qui revêtent un caractère ludique (chansons à geste, relaxation). Une fois la consigne présentée, il est important également de vérifier que celle-ci a été correctement comprise avant de mettre les élèves en activité. Pour effectuer cette vérification, l’enseignant dispose d’un moyen : celui de demander aux élèves de reformuler la consigne.
– Il est important aussi d’apporter aux élèves une aide méthodologique pour affronter plus facilement les consignes. Si la reformulation de la consigne par un élève est une aide pour le maître, elle l’est aussi pour les élèves qui ainsi se l’approprient plus facilement. En première année du FLE, l’utilisation des pictogrammes présente différents avantages pour les élèves : en cas d’oubli de la consigne, les élèves peuvent y avoir recours pour se la rappeler ; ils permettent d’anticiper sur le matériel à utiliser ; ils répondent aux sujets visuels qui ont besoin d’images pour se représenter le travail à réaliser. L’utilisation des pictogrammes peut être poursuivie jusqu’à fin du cycle primaire pour aider les élèves non lecteurs.
Malgré la mise en place de plusieurs actions, des difficultés persistent. Certains élèves ont des problèmes à réaliser de façon autonome le travail même si au préalable tout un travail sur la consigne a été réalisé. Nous croyons que d’autres stratégies doivent être envisagées pour ces élèves comme par exemple leur réserver un accompagnement plus important ou bien différencier les activités.
Rendre les impulsifs plus réflexifs : lire tous les mots de la consigne, examiner les relations entre les mots, analyser la question… Faire un travail de lecture des différents énoncés de consignes : constituer la liste des verbes utilisés pour formuler une consigne, expliciter le sens des conjugaisons (infinitif, impératif), distinguer consigne fermée et consigne ouverte… Ainsi s’ouvre un vaste champ pour les études dirigées, tout au long de la scolarité .Mais il est difficile d’évaluer l’efficacité de ce travail sur les consignes sur une période de trois semaines. La courte expérience que nous avons pu avoir nous a confortée dans l’idée d’engager un vrai travail sur les consignes. Cependant, nous pensons que celui-ci doit s’inscrire sur le long terme et qu’il n’aura de véritable efficacité qu’à condition d’être relayé et réinvesti au quotidien dans la classe.
Progressivement les élèves pourront ainsi accéder à une certaine autonomie, qu’ils continueront à développer au collège et au lycée. C’est donc un travail de longue haleine qui doit débuter dès le cycle primaire.
Enfin, nous souhaitons que nous avons donné à chaque chapitre sa propre valeur scientifique et littéraire .Nous aimerions bien que notre travail serait une aide précieuse à ceux qui veulent à la fois approfondir dans ce thème ou qui veulent s’informer.