L’incarnation romanesque de la femme dans l’œuvre de Mohammed Dib révèle une représentation complexe de la femme algérienne, explorant son statut et son évolution à travers les romans ‘La Grande maison’ et ‘Un Été africain’. Cette étude met en lumière l’interaction entre l’imaginaire collectif et la réalité sociale.
PARTIE II
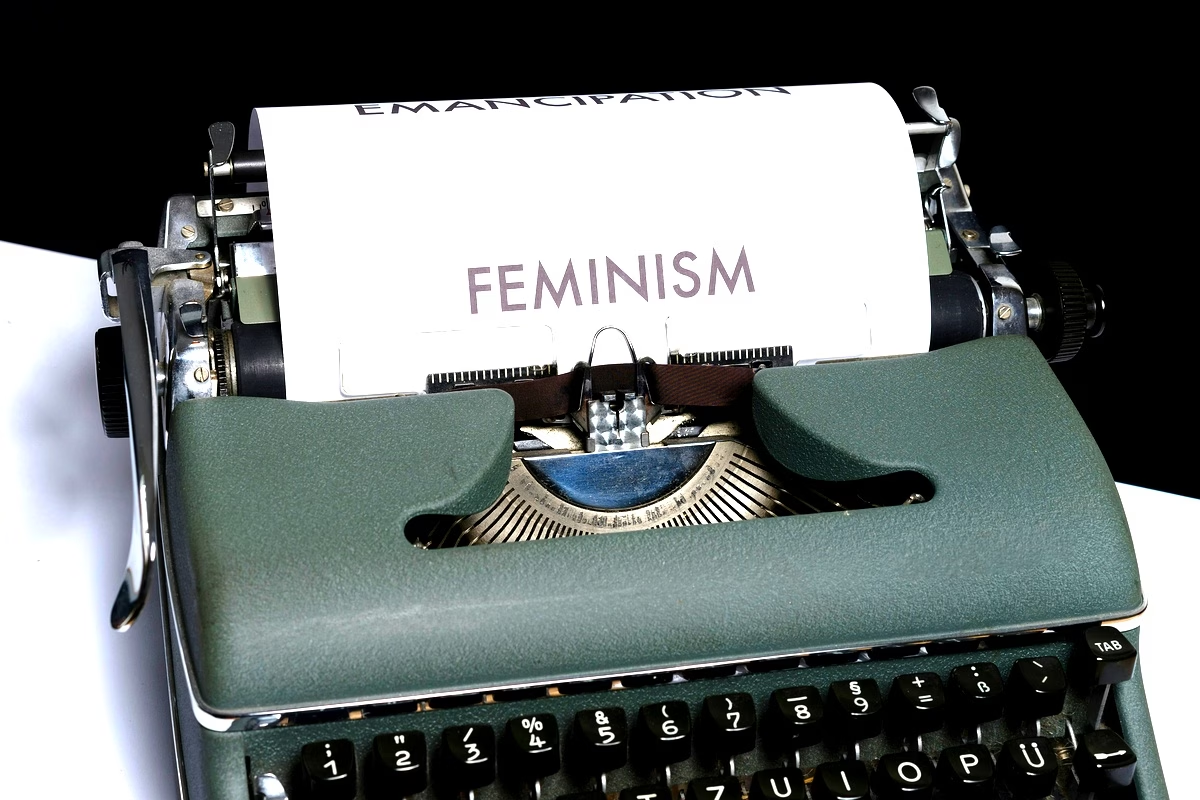
LA FEMME DANS L’INCARNATION ROMANESQUE
L’IMAGE DE LA FEMME DANS L’ŒUVRE DIBIENNE.
Chapitre 01
Jamais le statut de la femme dans la société n’a posé plus de question à l’échelle mondiale qu’il n’en pose aujourd’hui. Jamais il n’est apparu plus clairement que l’évolution des structures sociales y était liée. […] À l’Est comme à l’Ouest, les déclarations de principe, les discussions passionnées qui ont lieu dans la vie politique, les mouvements d’opinion, la presse sont autant de preuves de l’ampleur et de l’importance du problème.
De nombreuses études sociologiques ont déjà mis en relief divers aspects de l’évolution du statut de la femme. Le travail professionnel, la participation de la vie politique, le rôle social, le rôle familial, etc. ; ont donné lieu à la publication d’ouvrages et d’articles divers dans beaucoup de pays.1
Le réel amer qu’a vécu la femme algérienne, et qu’elle vit encore jusqu’à présent dans plusieurs régions, a poussé les écrivains à s’intéresser à cette catégorie du peuple méprisée et marginalisée. En mettant en lumière un être qui a vécu longtemps dans l’ombre, et cela à travers son adaptation et son incarnation dans les différentes productions littéraires notamment la romanesque, Lucien Goldmann écrit : « la forme romanesque est la transposition sur le plan littéraire de la vie quotidienne dans la société.
»2. Considérées comme personnages romanesques, les femmes algériennes évoquent des images multiples d’un discours social et culturel et attirent l’attention sur les représentations de l’identité féminine et la façon dont cette identité a changé et continue de changer.
Toutefois, il est nécessaire de montrer que l’incarnation romanesque de la femme est une arme à double tranchant : d’une part les images qu’on se fait de cette femme, les représentations, les modèles, les aspirations et les valeurs qui y sont liées jouent un rôle considérable dans la transformation et l’évolution des structures sociales, ainsi du statut de la femme ; d’autre part, cette incarnation ne fait qu’enraciner des images abusives, dégradantes héritées de l’imaginaire collectif et parfois de l’imaginaire de certains écrivains.
L’image de la femme dans le roman maghrébin d’expression française :
La littérature maghrébine d’expression française est apparue dans les années cinquante en tant que littérature nationale engagée, elle est née en Algérie d’abord pour s’étendre ensuite aux autres pays maghrébins. Elle est représentée par des grands écrivains comme : Feraoun, Mammeri, Dib, Kateb Yacine, Chraïbi et d’autres, qui ont montré que l’utilisation de la langue française ne les avait nullement empêchés de rester Maghrébins au service de leurs pays, pour dénoncer la colonisation et défendre leur liberté.
Ainsi, le roman est le genre littéraire qui a été bien favorisé par ces écrivains ; ce choix leur a permis de prendre la parole pour revendiquer des droits et des libertés qui ont été longtemps niés. Ainsi le thème de la femme et la situation qu’elle a vécue a été fortement étudiée dans cette littérature, mais le personnage féminin dans ce roman maghrébin reste toujours lié aux images héritées de l’imaginaire, de traditions et de mœurs rigides du Maghreb, dans une tentative visant à s’inscrire dans une histoire culturelle. À cet égard Sonia RAMZI-ABADIR affirme :
Le thème de la femme est pour l’écrivain maghrébin le moyen de se réinsérer et d’insérer de façon plus ou moins voilée son œuvre dans une histoire culturelle au sens le plus large qu’on puisse donner au terme que les conditions objectives lui ont arraché.3
Les images de la femme que ces écrivains maghrébins donnent à voir, apparaissent toujours comme des images réduites à la figure de la mère, à la femme-objet gardienne des traditions et des mœurs. Ainsi, Mouloud Feraoun dans son œuvre Le Fils du pauvre nous reflète l’image de la femme minorisée et mystifiée dans une société qui tend à l’estimation et la valorisation du garçon comme sauveur et emblème de sa famille.
Mouloud Mammeri quant à lui, nous dévoile dans son œuvre La Colline oubliée les maux d’une société purement masculine et défend le fait que la femme et l’homme doivent vivre ensemble. Kateb Yacine par son roman Nedjma présente plusieurs images de la femme, réelle, symbolique et « la Mère-patrie ou le sein maternel.
»4. Pour sa part, l’écrivain marocain Driss CHARAIBI nous peint une image de la femme inspirée de sa condition dans une sorte de révolte contre toutes les valeurs politique, sociale, culturelle et religieuse. Chaque femme est à l’image de sa mère opprimée ; l’écrivain affirme :
Il y avait autre chose : ma mère. La femme dans les livres, dans l’autre monde, celui des Européens, était chantée, admirée, sublimée. Je rentrais chez moi et j’avais sous les yeux et dans ma sensibilité une autre femme, ma mère, qui pleurait jour et nuit, tant mon père lui faisait la vie dure. Je vous certifie que pendant trente trois ans, elle n’est jamais sortie de chez elle. Je vous certifie qu’un enfant, moi, était son seul confident, son seul soutient.5
Ce thème de la révolte contre toutes les valeurs et contre le pouvoir du père est aussi présent dans l’écriture de Rachid BOUDJEDRA, dont le roman La Répudiation est centré sur le thème de la femme répudiée, inspirée encore du réel qu’a vécu sa mère. Boudjedra affirme : « je m’étais proposé de raconter une destinée concrète, celle de ma mère».6
Toutefois si cette écriture de révolte a essayé de refléter l’injustice envers la femme, elle n’en demeure pas moins mystifiante pour la femme aussi, dans la mesure où elle a comme objectif principale de mal exprimer et mal représenter la religion et ne fait qu’être une autre oppression de la femme par l’écriture elle même. Hafid GAFAÏTI affirme dans son ouvrage Les Femmes dans le roman algérien :
Ce qui frappe dans La Répudiation c’est ce que les femmes sont essentiellement vues à travers leurs corps. Elles ne sont jamais mises en valeur en tant qu’entité : elles n’existent qu’en tant que mère, maîtresse, sœur, cousine, objet sexuel ou organe reproducteur. […]Dans d’autres œuvres comme celle de Kateb Yacine, Mohamed Dib, Assia Djebar par exemple, même si la condition des femmes dans la société n’est pas fondamentalement différente, nous en avons une représentation plus équilibrée qui ne manque pas de n’en offrir les autres facettes. Ainsi, dans les romans de ces auteurs nous les percevons dans leurs multiples dimensions, sociales, culturelles ou personnelles.7
Boudjedra nous présente dans son roman des images négatives et dégradantes des femmes vues seulement à travers leurs corps, sales, obscènes, et dégoûtantes. Ce n’est que le caractère animal de la femme qui règne sur son roman. Cette image de la femme victime et déshumanisée est aussi présente chez Tahar Ben JELLOUN qui nous brosse dans son roman Moha le fou, Moha le sage des portraits de femmes « étranglées, niées, piétinées […] des vies confisquées, des regards qui se baissent »8.
Face à cette dépersonnalisation et cette mystification, la femme découvre une autre arme pour défendre sa personnalité et sa liberté à travers l’écriture. Ce champ était jusqu’alors réservé aux hommes seuls alors que la femme s’écroule dans le silence. L’écriture était par elle et pour elle un miroir à travers lequel elle tente de projeter et refléter les maux de la société où elle vit. C’est ce qu’affirme Christiane ACHOUR :
Elle [la femme] a besoin de s’évader de ce qui lui est familier, de s’inventer des histoires inédites. Elle a besoin de prendre les marques de son identité, elle a besoin d’affirmer sa présence au monde et en conséquence, la façon la plus honnête et la plus authentique de le faire c’est de partir de son expérience personnelle. En plus, l’écriture représente une sortie publique de la femme hors des espaces qui lui sont permis, et la trajectoire qu’elle doit suivre alors, est la plupart du temps difficile, pleine d’obstacles. Elle a besoin de l’écriture pour la fixer noir sur blanc et nourrir aussi l’inconscient collectif des femmes.9
Ainsi, apparaît la littérature féminine algérienne avec plusieurs femmes écrivaines comme Leila SEBBAR, Taos AMROUCHE, Aicha LEMSINE, Assia DJEBAR, Malika MOKADDEM, Latifa BENMASOUR, Hawa DJABALI, Maissa BEY et bien d’autres.
Pour sa part, Aicha LEMSINE justifie ce choix de la représentation de la femme : « si l’accent est mis sur les femmes, c’est parce que c’est ce qui a été interdit, parce que culturellement, elles ont été reléguées dans l’espace domestique »10. Les femmes semblent le sujet dominant dans l’écriture de Aicha Lemsine dans tous ses romans tels que La Chrysalide, Ciel de Porphyre, Ordalie des voix.
Ainsi, dans La Chrysalide l’écrivaine nous raconte à travers l’histoire d’une famille algérienne comme mille autres, l’injustice et la douleur qui sont le lot quotidien de la femme algérienne. Lemsine s’élève contre le mariage forcé, la répudiation et la polygamie dans une remise en question du système régissant la destinée de la femme algérienne.
De même, Assia Djebar pour sa part a eu l’audace d’introduire des nouveaux thèmes au sein de cette écriture féminine comme la découverte du corps par la femme et la naissance du couple ; c’est ce qu’affirme Charles BONN :
Rares sont ceux qui, comme Assia Djebar permettent à une catégorie donnée de la population, et plus encore aux femmes de retrouver dans un livre la quotidienneté de leur existence actuelle, même si certains aspects, pourquoi pas ? Doivent en paraître futiles.11
Avec Assia Djebar nous assistons à une prise de conscience de la femme traditionnelle. Elle nous brosse dans son roman Les Enfants du nouveau monde une nouvelle image de la femme qui s’affirme en personnage entier pour revendiquer ses droits et sa liberté. Toutefois, cette image de la femme majeure, de la femme sujette demeure rare dans la littérature maghrébine de langue française. Jean DEJEUX affirme :
La littérature maghrébine ne rend pas compte de tous les aspects de cette prise de conscience des Algériennes et de leur promotion, ou de leur entrée dans la cité. […] il faudrait encore bien d’autres romans et essais.12
À vrai dire, la femme est toujours présente dans les romans maghrébins d’expression française, mais cette présence paraît dans la majorité des cas vidée de signification. Les personnages féminins sont presque effacés dans leur rôle dynamique de personnage actif. L’élément essentiel dans la conscience collective de ces écrivains semble être la famille dont la femme est la gardienne et la conservatrice. De ce fait, est-ce que cette image est la même que celle qu’a connue la femme algérienne dans l’écriture algérienne arabe ?
________________________
1 Chombart de LAUWE, Images de la femme dans la société, in Revue internationale des sciences sociales, Vol.XIV n°1, 1962, Paris, UNESCO, 1962, p.6. ↑
2 Lucien GOLDMANN, Pour une sociologie du roman, Paris, Gallimard, 1995, cité in : http://www.site-magister.com/grouptxt4.htm ↑
3 Sonia RAMZI-ABADIR, Op.Cit. p.80. ↑
4 Yacine KATEB, cité par Jean DEJEUX in : Littérature Maghrébine de langue française, Naaman, Sherbrooke, 1974, p.237. ↑
5 Jean DEJEUX, Op.Cit. p.286. ↑
6 Rachid BOUDJEDRA, cité par Sonia RAMZI-ABADIR, Op.Cit. p.85. ↑
7 Hafid GAFAÏTI, Les Femmes dans le roman algérien : histoire, discours et texte, Paris, L’Harmattan, 1996, p.252. ↑
8 Tahar Ben JELLOUN, Moha le fou, Moha le sage, Paris, Seuil, 1978, p.51. ↑
9 Christiane ACHOUR, cité par Keira Sid Larbi ATTOUCHE in, Paroles de Femmes, Alger, ENAG, 2001, p. 90. ↑
10 Aicha LEMSINE, cité par Keira Sid Larbi ATTOUCHE, Op.Cit. p.19. ↑
11 Charles BONN, La littérature Algérienne de langue française et ses lectures. Imaginaire et discours d’idées, Naaman, Sherbrooke, 1974, p.111/112. ↑
12 Jean DEJEUX, Femmes écrivains dans la littérature algérienne de langue française, in IBLA, 1972, 2, n°144, p.315/336, cité par Sonia RAMZI-ABADIR, Op.Cit. p.85/86. ↑