Les implications politiques de l’enseignement géographique révèlent comment les tensions entre le curriculum et les pratiques pédagogiques en Côte d’Ivoire façonnent la compréhension de l’espace urbain. Découvrez comment cette analyse peut transformer votre approche de l’enseignement géographique et enrichir la formation des élèves.
Des pratiques ordinaires en classe de géographie en côte d’ivoire peu fondées
sur la conceptualisation
Pour analyser les pratiques des enseignants, j’ai d’abord cherché à dégager les occurrences du fait urbain dans le curriculum prescrit, car les enseignants interrogés affirment tous s’appuyer sur le curriculum prescrit pour construire le cours à dispenser.
À l’aide du logiciel Iramuteq, j’ai isolé le concept d’urbain et j’ai réalisé un graphique sur les occurrences de ce concept dans les programmes scolaires de géographie en Côte d’Ivoire.
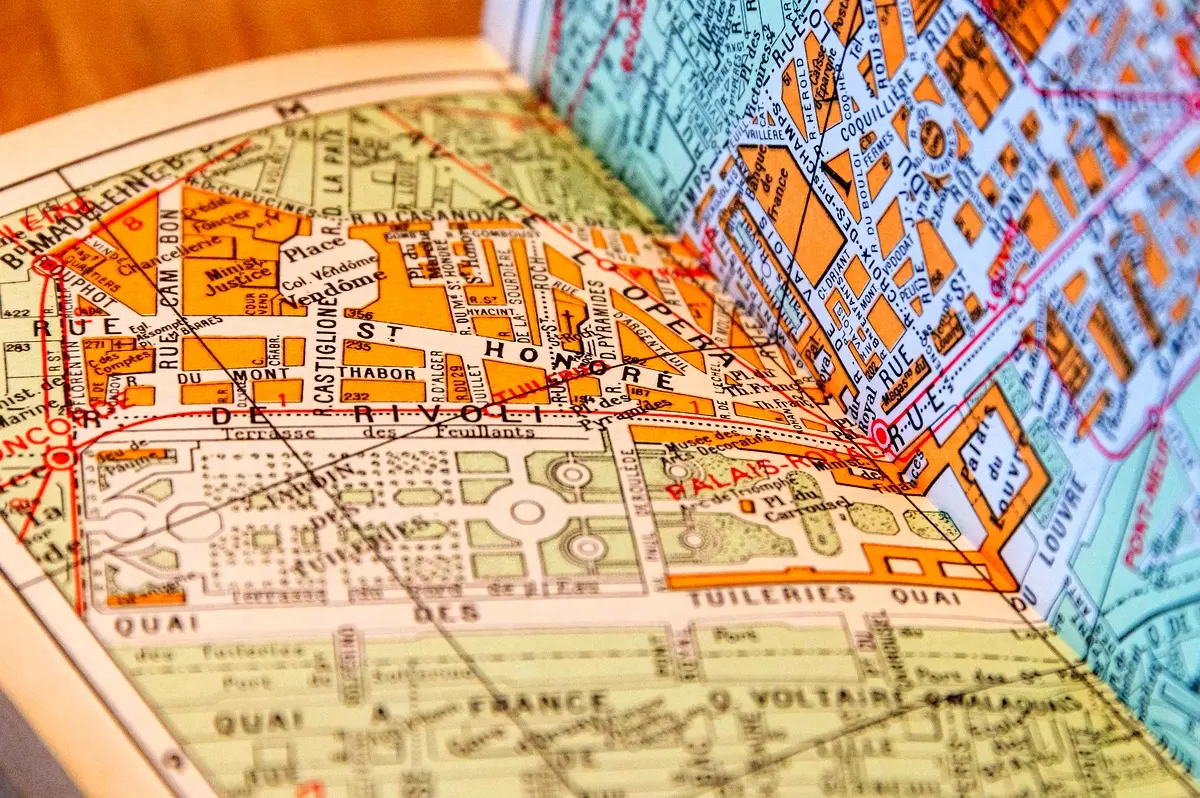
Graphique 1 : le fait urbain dans le curriculum prescrit ivoirien
[9_implications-politiques-de-enseignement-geographique-en-cote-ivoire_1]
L’analyse de ce graphique montre que le fait urbain est abordé particulièrement dans les programmes de première et de seconde en Côte d’Ivoire que dans les autres classes. En classe de première, le fait urbain est beaucoup plus abordé. En classe de première, l’outil concordancier23 révèle que ce concept est associé à celui du paysage (paysage urbain) et en classe de seconde au concept de milieu (milieu urbain). Ma recherche s’est intéressée à la classe de première, car c’est en classe de première qu’un thème24 porte essentiellement sur l’urbanisation. L’observation a porté sur la leçon 1 au programme de géographie en Côte d’Ivoire dont voici les instructions officielles à l’endroit des enseignants :
COMPETENCE 2 : Traiter des situations relatives à l’urbanisation dans le monde
THEME 2 : L’URBANISATION DANS LE MONDE
Leçon 1: L’urbanisation dans les pays en développement: l’exemple de la Côte d’Ivoire.
23 Chemin qui permet d’accéder au segment de texte où apparait la forme
24 Thème ici doit être compris comme chapitre contenant deux ou trois leçons du programme
Durée: 04 heures
Exemple de situation d’apprentissage :
Au cours d’une exposition de photographies aériennes sur des villes de Côte d’Ivoire au Centre Culturel Jacques Aka, les élèves de 1ère A4 du lycée municipal Djibo Sounkalo découvrent sur une des images la ville de Bouaké en 1934. Emerveillés par cette découverte, l’un d’entre vous affirme: « Mais Bouaké en 1934 a la même étendue que mon village aujourd’hui. Donc mon village sera une grande ville plus tard ». De retour au lycée, vous entreprenez de faire des recherches au CDI de l’établissement pour connaître le fait urbain, analyser l’urbanisation en Côte d’Ivoire afin de déceler les problèmes urbains et proposer des solutions.
Tableau 5 : tableau des habilités et contenus de la leçon de géographie sur l’urbanisation en Côte d’Ivoire
| Tableau des habilités et contenus de la leçon de géographie sur l’urbanisation en Côte d’Ivoire | |
|---|---|
| HABILETES | CONTENUS |
| Définir | L’urbanisation |
| Décrire | Les caractéristiques de l’urbanisation en Côte d’Ivoire |
| Montrer | La place de la ville d’Abidjan dans le paysage urbain de la Côte d’Ivoire |
| Expliquer | Le processus de l’urbanisation en Côte d’Ivoire |
| Analyser | Les problèmes de l’urbanisation en Côte d’Ivoire |
| Proposer | Des solutions aux problèmes urbains en Côte d’Ivoire |
| Apprécier | Le rôle des impôts dans la résolution des problèmes urbains |
| Exploiter | Des documents relatifs à l’urbanisation de la Côte d’Ivoire. |
La présence du concept de paysage urbain est révélatrice de l’absence de modernisation du savoir et un déficit de renouvellement curriculaire de la géographie scolaire ivoirienne. Pour Brunet cité par Allemand et al. « le paysage est un piège où se prennent les imprudents » (Allemand et al., 2005, p. 43). En effet, le paysage, un concept essentiel de la géographie classique, a su être réinventé pour devenir un concept de la géographie contemporaine. Ce même concept appartient à des paradigmes différents de la géographie. Un paysage de la
géographie classique avec une conception radicalement opposée au paysage tel que le conçoit la géographie contemporaine. Max Sorre, disciple de Vidal, affirme : « toute la géographie est dans l’analyse du paysage » (Simon, 2015, p. 3). L’analyse paysagère permet de rendre compte de la singularité des lieux. Elle s’attache à décrire les différents paysages, les formes et les activités et les transformations humaines d’un lieu.
Elle s’intéresse à la description des sociétés. Le paysage permet de rendre compte des genres de vie (Simon, 2015). Pour Robic, l’analyse paysagère s’intéresse au visible. À ce propos, Isabelle le Fort, estime que la vue est l’organe par excellence de la science géographique (Simon, 2015). C’est une démarche empirique fondée sur l’observation et la description des contrées.
La géographie devient une science de synthèse rendant compte de la particularité de chaque lieu. À cette conception du paysage s’oppose celle de Augustin Berque. Pour ce dernier, l’analyse paysagère permet de rendre compte des « dimensions esthétiques, mentales et sociales de l’espace » (Allemand et al., 2005, p. 46). En effet, l’analyse paysagère s’intéresse à l’invisible, aux représentations des sociétés sur leur espace porteur de valeurs et de sentiments.
Anne Cauquelin souscrit à l’analyse de Berque en affirmant : « Il s’agit bien ici, avec le paysage, d’un a priori (la forme symbolique qui filtre et cadre nos perceptions du paysage) [et] cet a priori est inclus dans un système d’orientation et de valeurs accordées, produit d’une genèse » (Allemand et al., 2005, p.
45). En ce sens, le paysage n’est plus seulement un objet réel mais une fabrication et production. C’est à ce paysage que s’intéresse la géographie contemporaine. La géographie scolaire ivoirienne, invitant une description du paysage s’inscrit dans la géographie classique car elle renvoie à la morphologie de la ville, à la description et à la typologie des villes.
Cette approche est analogue à celle prônée par la géographie tropicale qui s’est intéressée à la localisation, aux monographies des villes et à décrire leur fonction. Cette analyse confirme l’absence de modernisation du savoir et un déficit de renouvellement curriculaire de la géographie scolaire ivoirienne.
Les observations ont porté sur la leçon 1 de géographie en classe de première sur l’urbanisation. J’ai observé quatre enseignants de lycée, selon une grille d’observation construite à partir de la médiation sociocognitive des apprentissages de Britt-Mari Barth (en annexe). Les résultats de ces observations sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 6 : démarche méthodologique des enseignants observés
| Démarche méthodologique | E1 | E2 | E3 | E4 |
|---|---|---|---|---|
| Définit les objectifs de la séance | X | X | X | X |
| L’enseignant part des représentations des élèves sur les villes | ||||
| L’enseignant amène les élèves à identifier les attributs essentiels de l’espace urbain | ||||
| L’enseignant définit les relations entre les concepts sur les espaces urbains | ||||
| L’enseignant prend en charge la conceptualisation | X | X | X | X |
| Utilise un modèle transmissif | X | X | X | |
| Utilise un modèle socioconstructiviste des savoirs pour faire émerger les concepts | X |
L’analyse du tableau montre que les enseignants ont utilisé une approche pédagogique différente. E1, E2, E3 ont utilisé un modèle transmissif des savoirs pendant que E4 a utilisé un modèle socioconstructiviste des savoirs. E1, E2, E3 n’ont pas utilisé de support de cours. Au niveau de l’approche pédagogique, E1, E2, E3 ont dicté le cours.
Mais E4 a exploité le texte avec ses élèves par un cours dialogué. En effet, après chaque question posée aux élèves, ils valident la réponse et demande aux élèves de noter les informations (le cours) puis il les complète. Les élèves de E4 sont placés en activité de recherche d’informations dans le texte.
E4 utilise la boucle didactique. Seul E4 a essayé de solliciter les élèves pendant la séance de cours. Il a déroulé son cours, selon la boucle didactique.
E1, E2, E3 ont utilisé un modèle transmissif du savoir, car ils estiment qu’il est difficile d’appliquer la méthode active au regard du manque de matériel didactique et de la nécessité de terminer les cours. E1 affirme à ce propos : « c’est l’APC que je fais, mais on ne tire pas les documents, je ne me peux pas prendre mon argent pour tirer pour les élèves, bon je fais un peu d’effort pour expliquer, c’est ça ». E4 a privilégié un cours dialogué. Ce type d’enseignement s’inscrit dans une succession de boucle didactique. L’enseignant pose des questions à partir d’un document, l’élève y répond, l’enseignant par la suite valide puis complète les informations.
Les réponses sont tirées du texte et ne favorisent pas un réel apprentissage des élèves, car les savoirs produits sont des savoirs factuels ou des savoirs de « basse tension intellectuelle » (Thémines, 2016, p. 129). Ainsi, pour Lautier et Allieu-Mary, cela suppose que
« l’enseignant contrôle de fait l’argumentation didactique en disant le “vrai” et assoit, par son propos, l’“autorité” des savoirs comme la sienne ; l’élève, le plus souvent privé de réelle prise en charge énonciative, est invité à l’“adhésion” d’un “texte” à apprendre » (Doussot, 2014, p. 580). Dans les deux cas présentés, les enseignants prennent en charge la conceptualisation.
Le savoir est construit par les enseignants et transmis aux élèves. L’absence de support pour les cours de E1, E2, E3 montre la prise en charge de la conceptualisation par l’enseignant. En ce qui concerne E4, même s’il a utilisé un texte, il n’a permis la construction du savoir, car le texte n’est qu’un prétexte pour justifier la mise en œuvre d’une méthode active, mais finalement, c’est l’enseignant qui a transmis les savoirs déjà construits aux élèves.
Au niveau des ressources pédagogiques utilisés par les enseignants, l’analyse de la grille d’observation a montré que seul E4 a utilisé un texte. Et aucun enseignant n’a utilisé de carte comme proposé dans les instructions officielles. Alors que la carte est un outil important pour le géographe, elle permet d’exprimer le savoir sous une forme concrète.
Les enseignants ont utilisé de nombreux concepts : hiérarchie urbaine, réseau urbain, ville géante et multifonctionnelle, armature urbaine, ville macrocéphalie. Malheureusement, les concepts ne sont pas mis en relation et leurs attributs ne sont pas définis. Il faut rappeler que ces enseignants ont dispensé à quelques mots près les mêmes contenus.
Quand l’enseignant évoque un concept, il en donne la définition aux élèves qui doivent la noter. Pour ces enseignants, les concepts ne sont pas perçus comme des éléments structurants du savoir. Ils les évoquent sommairement. Pourtant, les réponses de E2 et E4 relatives à la question de qu’est-ce qu’un concept pour vous ?
montrent que ces enseignants ne savent pas l’utilité d’un concept E4 : « j’ai pas tout de suite chercher le mot ou concept, mais je pense que c’est c’est le mot sur lequel tout le Monde se met d’accord sur le sens voilà. » E2 : « le concept. C’est on m’a dit.
Un mot important qu’on va utiliser, qui englobe plusieurs caractéristiques relatives à un phénomène donné, un phénomène géographique. ». Les réponses de E1 et E2 sont restées assez évasives sur cette question, par exemple pour E3 : « on parle d’un concept, je pense qu’on fait allusion à une création, faire une création”
Cette définition assez évasive du concept montre que les enseignants ont également du mal à définir le savoir à enseigner et à le structurer autour des concepts. Ils sont cependant unanimes sur la pertinence de la structuration des apprentissages autour des concepts.
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les principales compétences abordées dans l’enseignement de l’urbanisation en Côte d’Ivoire?
Les compétences abordées incluent la définition de l’urbanisation, la description des caractéristiques de l’urbanisation en Côte d’Ivoire, l’explication du processus d’urbanisation, et l’analyse des problèmes urbains.
Comment le concept de paysage urbain est-il perçu dans le curriculum de géographie ivoirien?
Le concept de paysage urbain révèle l’absence de modernisation du savoir et un déficit de renouvellement curriculaire de la géographie scolaire ivoirienne.
Pourquoi l’enseignement de la géographie en Côte d’Ivoire est-il considéré comme centré sur un modèle transmissif?
L’enseignement est souvent centré sur un modèle transmissif, ce qui crée des tensions entre les instructions officielles et les pratiques pédagogiques des enseignants.