La gouvernance et IDE en Algérie sont influencés par la qualité des institutions, comme le montre l’analyse des réformes institutionnelles entre 2000 et 2016. Cette étude met en lumière comment ces réformes façonnent le climat d’investissement et réduisent les incertitudes pour les investisseurs.
La Qualité institutionnelle perçue par les investisseurs :
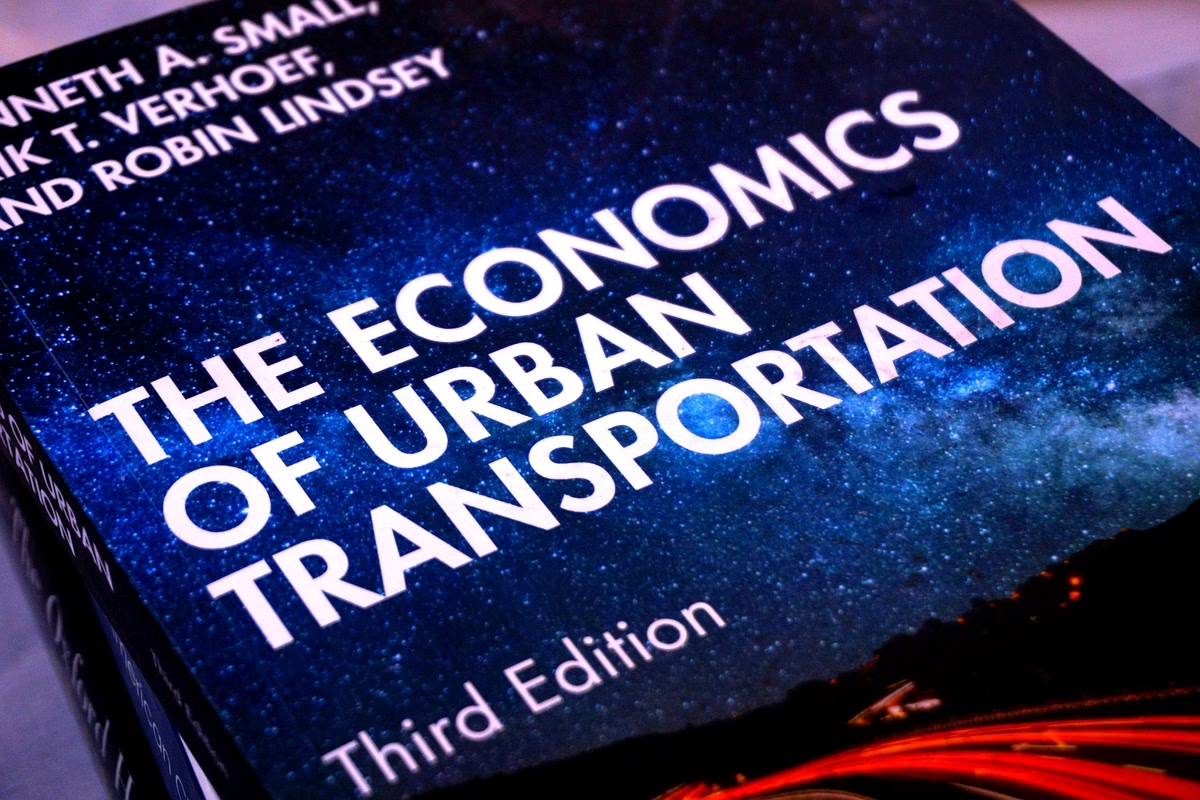
Dans l’économie, la présence des institutions de qualité réduit les incertitudes qui se produisent à cause de l’incomplétude des informations portant sur le comportement des individus dans l’interaction. Cela facilite la coopération compréhensive et mutuelle entre les acteurs du marché. Le respect des droits de propriétés, l’état de droit sont les éléments proéminents des institutions [Rodrik et al. 2004]. Ces éléments permettent un fonctionnement des opérations dans une échelle plus large et une utilisation plus efficace de la technologie, qui augmente par la suite la productivité, la compétitivité et facilite le changement structurel, contribuant à une meilleure division nationale et internationale du travail. Ceci est prouvé par les travaux empiriques suivants :
En analysant les pays dont le niveau de règlementation est excessif, [Busse et Croizard 2008] concluent que les règlements trop stricts dans ces pays n’incitent pas vraiment l’entrée d’IDE. De manière similaire, [Daniele et Marani 2006] suggèrent que les pays de la région MENA devraient conduire des réformes légales et institutionnelles afin d’améliorer leur attractivité vis-à-vis des IDE.
[Bénassy, Quéré et al. 2005] tentent aussi d’étudier la place des institutions dans les déterminants de l’entrée d’IDE, dont l’efficacité du pouvoir public tels que le système des impôts, la facilité d’entreprendre, l’absence de la corruption, la protection des droits de propriété et le respect de la justice, est un déterminant majeur de l’entrée d’IDE.
Ces travaux viennent s’ajouter à celui de [Globerman et Shapiro 2002], qui a pu démontrer que ces variables ne possèdent pas seulement des impacts sur l’entrée d’IDE, mais aussi sur le flux sortant1. En plus ces variables sont atteintes en mettant en premier plan un concept de la gouvernance.
La bonne gouvernance et la théorie des institutions :
La bonne gouvernance devrait permettre de conduire des réformes économiques dans des conditions de stabilité politique. Elle s’est développée comme une véritable méthode de traitement des problèmes sociaux, économiques et politiques et de réforme de l’État, destinée à créer les conditions favorables aux mécanismes du marché. Les mesures ainsi proposées visaient à l’instauration de normes et d’institutions assurant un cadre prévisible et transparent pour la conduite des affaires publiques et obligeant les responsables à rendre des comptes. Cette bonne gouvernance est ainsi apparue comme garant de la qualité institutionnelle d’un pays.
Donc, elle est considérée comme le processus par lequel les décisions dans les affaires de l’Etat sont prises et appliquées. Elle est donc le fruit de la structure institutionnel d’un pays et perçue comme l’aspect pratique de l‘environnement institutionnel. La bonne gouvernance reflète alors, la façon dont l’environnement institutionnel solide est assuré car, pour considérer une gouvernance comme bonne, il faut des pré-requis qui sont sur la qualité de l’environnement institutionnel [Dixit, 2009]. Ces pré-requis sont : l’action collective, l’enfoncement du contrat, et la sécurité des droits de propriété.2
| Tableau N° 2-03 : comparaison de définitions de la gouvernance données par les organismes de développement et celles de l’institution dans la théorie économique | |
|---|---|
| Gouvernance | Institution |
| Banque mondiale : « la capacité et l’efficacité dans la gestion des services publics, la redevabilité, la prévisibilité, le cadre général du développement, et enfin l’information et la transparence » | Veblen : « une régularité du comportement ou une règle, généralement acceptée par les membres du groupe de la société, qui spécifie le comportement dans une situation spécifique et qui peut faire respecter par soi- même ». |
| OMC : « un ensemble de transaction par lesquelles des règles collectives sont élaborées, décidées, légitimées, mises en œuvre contrôlées » | Commons : « l’action collective dans le contrôle, la libération et l’expansion de l’action individuelles ». |
| FMI : « tous les aspects de la conduites des affaires publiques y compris les politiques économiques et le cadre réglementaire ». | North : « les contraintes qui résultant de l’action des individus, structurent les interactions humaines ». |
| PNUD : « l’exercice de l’autorité économique, politique et administratif afin de gérer les affaires du pays dans tous les niveau ». | Williamson : « les différentes modes de gouvernance qui encadrent et coordonnent des transactions économiques ». |
Sources : Williamson, 1985 ; North, 1990 ; Camdessus, 1997 ; Lamy et Laïdi, 2001 et ONU, 2006.
Grace à la promotion de la notion de gouvernance et les différentes méthodes pour mesurer son degré développées par des organismes internationaux, les investisseurs perçoivent la qualité des institutions d’un pays à travers elle. La bonne gouvernance apparait comme le garant de la solidité de l’environnement institutionnel d’un pays. [Becchetti et Kobeissi 2009] étudie le rôle de la gouvernance et de l’environnement institutionnel sur la fusion-acquisition transfrontaliers, mais aussi le cas de [Masron et Abdullah 2010] portant sur la qualité institutionnelle comme déterminant d’entrée d’IDE en ASEAN, et le cas de [Méon et Sekkat 2007] qui reviennent sur la relation entre la gouvernance et l’IDE.
Le climat de l’investissement et attractivité d’IDE :
Le climat de l’investissement est l’ensemble des facteurs propres à la localisation de l’entreprise, qui influent sur les opportunités de marché ou le désir des entreprises d’investir à des fins productives, de créer des emplois et de développer leurs activités. Les politiques et le comportement des pouvoirs publics ont une influence très importante en raison de l’incidence qu’ils ont sur les coûts, les risques et les obstacles à la concurrence Ce bon climat de l’investissement permet aussi un juste partage des effets positifs des gains de productivité entre l’ensemble du corps social3.
Les coûts et risques comme facteurs incontournables :
Le caractère prospectif de l’investissement met en relief l’importance de la stabilité et de la sécurité, et des droits de propriété en particulier : les réglementations, le niveau d’impôt, le respect de droits de propriété ainsi que les financements, l’infrastructure et la main-d’œuvre sont des éléments clés des activités d’investissement4.
Les coûts d’établissement et de fonctionnement d’une entreprise ont aussi une dimension temporelle. Les enquêtes effectuées par la BM auprès des entreprises mettent en lumière les énormes différences qui existent au niveau des délais nécessaires pour le dédouanement des marchandises et l’obtention d’une ligne téléphonique, ainsi que le temps passé par les entreprises à traiter avec les agents de l’État.
Dans un contexte de mondialisation, l’analyse du risque pays est devenue un élément essentiel de la décision d’investissement. L’État a un rôle important à jouer en instaurant un environnement stable et sûr, notamment en protégeant les droits de propriété [Banque Mondiale, 20035]. L’incertitude de la politique de l’État, l’instabilité macroéconomique et les réglementations arbitraires peuvent aussi hypothéquer les possibilités d’investissement et refroidir les investisseurs. Ces risques liés à la politique gouvernementale sont le principal sujet de préoccupation des entreprises dans les pays en développement quant au climat de l’investissement.
Les obstacles à la concurrence :
En ce qui concerne la concurrence, il est évident que les entreprises préfèrent moins de concurrence. Mais les obstacles à la concurrence qui favorisent certaines entreprises signifient aussi que les consommateurs et d’autres entreprises ne pourront profiter de certaines opportunités et ils devront donc supporter des coûts plus lourds. Ces obstacles peuvent en outre réduire les incitations qu’ont les entreprises protégées d’innover et d’accroître leur productivité.
Les pouvoirs publics peuvent influer directement sur les obstacles, via les réglementations qui régissent l’entrée et la sortie, et sur la politique adoptée à l’égard des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. Si la pression de la concurrence est difficile à évaluer globalement, les enquêtes auprès des entreprises montrent comment cette pression, telle que la ressentent les entreprises, peut varier de façon très importante d’un pays à l’autre [Banque Mondiale, 2004].
Les entreprises n’investissent qu’en fonction des coûts, des risques et des obstacles à la concurrence qu’implique les possibilités d’investissement. Par conséquence, en combinant des politiques officielles dans différents domaines, les pouvoirs publics peuvent agir sur ces trois facteurs clés. Main d’œuvre et marché du travail, finance et infrastructure, crédibilité des puissances publiques et légitimité du pouvoir, capacité institutionnelles locales… sont autant d’exemples possibles.
Il est primordial pour un pays de s’attaquer à ces causes potentielles d’échec de leurs politiques afin qu’une politique soit susceptible de réussir et de pouvoir instaurer un climat de l’investissement plus favorable à attirer les IDE6.
Le climat de l’investissement privilégié :
Les investisseurs privilégient souvent les pays qui suivent une politique économique favorable à l’économie de marché, ouverte sur l’extérieur et ils craignent les décisions discrétionnaires des gouvernements et de leurs administrations. L’existence de programmes de privatisation constitue un signal positif, non seulement parce qu’ils ouvrent des opportunités d’investissement, mais aussi, parce qu’ils manifestent clairement une orientation politique favorable à l’initiative privée (Michalet, 1999). Dans le but de promouvoir les investissements, une fois établies ces conditions pré-requises, un pays s’efforcera de promouvoir l’existence de facteurs déterminants susceptibles de crédibiliser son attractivité.
Toute politique d’attractivité doit s’évertuer à conjuguer les critères propres à la crédibilité et à la lisibilité du climat de l’investissement. A cette fin, les gouvernements doivent mettre en place des innovations institutionnelles adjuvantes [Tamokwe Piatie, 2007]. Les investisseurs attendent des dispositifs qui les assurent contre les différents risques.
Les mesures qui offrent au pays un avantage concurrentiel institutionnel en matière d’investissements directs étranger doivent alors assurer la crédibilisation, l’incitation et la protection qui remplissent les critères de viabilité, d’efficacité, d’efficience et de robustesse.
En effet, les recherches de [North et Weingast 1989] montrent que la Grande Bretagne a pu mettre en place un dispositif de manière autonome en permettant en quelque sorte au parlement de jouer un rôle d’arbitre entre les intérêts du monarque et ceux des détenteurs de capitaux, leur situation actuelle porte à croire qu’une telle approche sera difficilement fructueuse dans les pays en développement.
Ainsi, dans la concurrence pour l’attrait des investissements le problème qui se pose aux pays est double [Tamokwe Piatie,2007]. Non seulement il leur faut concevoir et mettre en place des institutions ou structures administratives contraignantes, mais en plus, ils doivent en même temps donner des gages de crédibilité pour regagner la confiance des investisseurs généralement gelée par de longues années de gaspillage.
Une réponse à ce double défi consiste en l’implémentation d’un dispositif institutionnel novateur, incitatif et soutenable.
Conclusion :
Une forte expansion des flux d’investissements internationaux a permis l’accélération des mouvements d’échanges entre différentes zones, avec une variété accrue de ses formes et une évolution quantitative de son contenu. Les pays deviennent promoteurs de la mondialisation de la production en créant un climat d’investissement favorable. Pour les pays d’accueils, le recours à l’investissement direct étranger (IDE) constitue un enjeu suffisamment important de développement local, de formation du capital fixe, et de progrès technique dû à la technologie qu’il incorpore.
Les IDE permettent aux pays hôtes (PH) un accroissement des échanges, la création de pôles de compétitivité par des phénomènes d’agglomération d’activités, le transfert de technologie, la mise à niveau des firmes locales, et la création d’emplois. Conscientes de ces effets, les économies en développement ont mis en place des mesures d’attractivité pour bénéficier de l’installation des firmes étrangères. Pour la question de l’attractivité des territoires, nous privilégions les modèles macroéconomiques qui cherchent à identifier quels sont les facteurs qui expliquent le choix de la localisation et les volumes d’IDE reçus par une économie. De plus en plus, la qualité des institutions devient un facteur explicatif des différences entre pays. Une meilleures qualité institutions s’avèrent un moyen efficace d’attractivité. Nous tenterons de spécifier le rôle joué par les institutions et les mesures d’attractivité en Algérie dans la détermination de la localisation des IDE.
Les critères de viabilité, d’efficacité, d’efficience et de robustesse sont alors essentiels dans la mesure où ils assurent le bon fonctionnement d’une situation d’équilibre mutuellement bénéfique. Mais à part ces critères, la perception de la stabilité politique, l’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, l’imprévisibilité de la justice et l’absence de la corruption sont aussi des facteurs pris en compte par les investisseurs.
On peut conclure qu’actuellement le rôle des institutions dans le développement d’une nation est généralement admis. L’IDE participe, lui aussi dans le processus du développement dans la mesure où il importe non seulement le financement mais aussi le savoir-faire et la technologie. La question qui s’est posée était de savoir si la décision des investisseurs étrangers était conditionnée par les facteurs institutionnels.
Autrement dit, si l’environnement institutionnel d’un pays possède des influences sur l’entrée d’IDE, mis à part les facteurs liés à l’accès au marché et aux ressources spécifiques du pays. Le concept théorique développé jusqu’à présent montre cette influence et les différentes études réalisées dans le monde la confirment aussi. Reste donc à savoir si cette relation de causalité entre les facteurs institutionnels et l’entrée d’IDE soit confirmée dans le contexte des pays les moins avancés.
________________________
1 Hali Edison, Qualité des institutions et résultats économiques, un lien vraiment étroit ; conférence finance et développement 2003 ; P5. ↑
2 Claude Ménard ; l’approche néo-institutionnelle : des concepts, une méthode, des résultats) ; cahier d’économie politique ; 2003/1N°44 ; p103-118. ↑
3 CNUCED,Rapport sur le développement dans le monde 2005, p2. ↑
4 Banque Mondiale « Algérie investiment climate assesment » ; 29 juin 2003 ; p3. ↑
5 Banque Mondiale « Algérie investiment climate assesment » ; 29 juin 2003 ; p5. ↑
6 Banque Mondiale « Algérie investiment climate assesment » ; 29 juin 2003 ; p5-9. ↑