Cette étude révèle comment l’évaluation de la compétence orale FLE en 3ème année primaire peut transformer l’apprentissage des élèves. Découvrez les outils pratiques pour identifier et corriger les erreurs, et améliorez ainsi l’efficacité de votre enseignement.
Chapitre 1 l’apprentissage de l’oral en 3AP
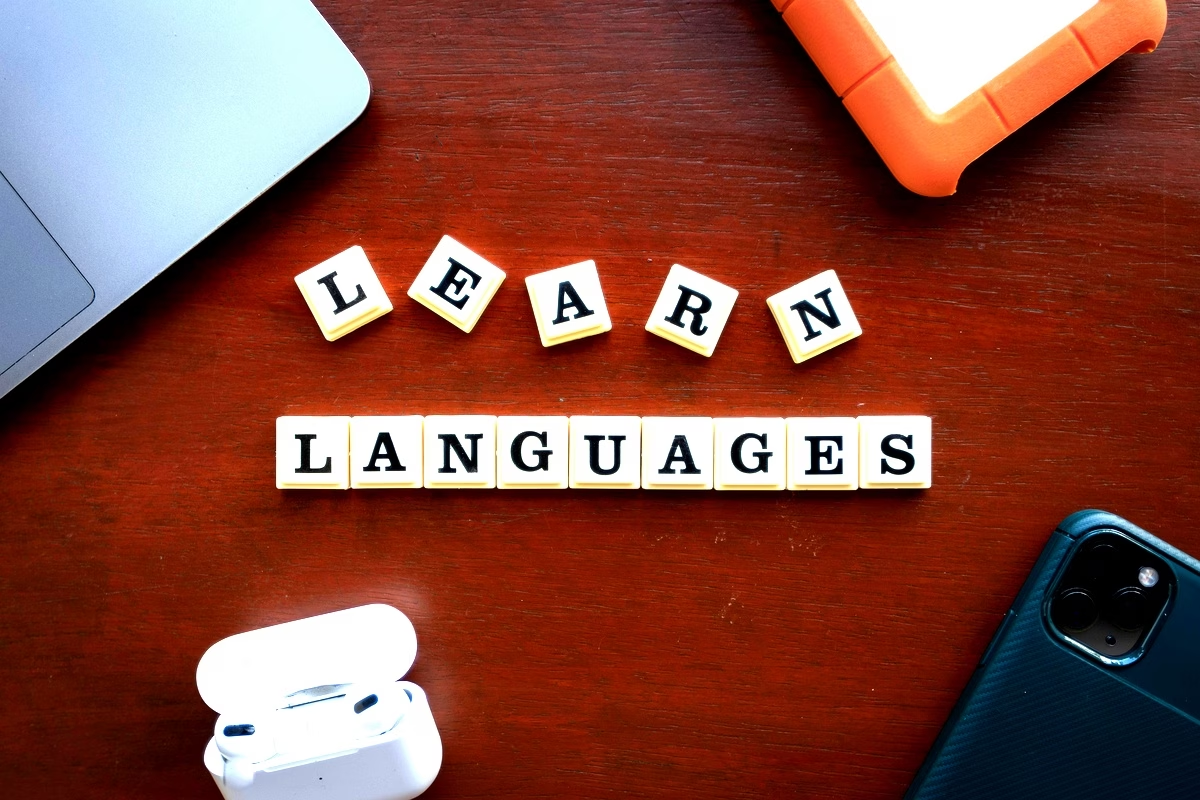
La notion de l’oral
- Qu’est ce que l’oral?
Dans les méthodologies modernes, l’oral occupe une place importante et constitue le point de départ de l’apprentissage. Si nous avons bien compris la définition de l’oral selon le pédagogue Gérard Vigner, nous pouvons dire que l’oral désigne une situation d’échange d’un discours d’une manière constante.
Pour lui, l’oral est l’autre forme de la langue, dans sa forme sonore, doté de priorités acoustiques particulières. Il met en jeu la perception auditive et les capacités articulatoires du sujet. L’oral peut être donc conçu comme un échange de propos entre deux interlocuteurs d’une façon directe, ce qui permet l’intercompréhension en levant les ambigüités lors de l’échange, et cela met en jeu la capacité d’écoute et de production de parole des sujets parlant1.
Les spécificités de l’oral
Le code oral est un moyen de communication. D’ailleurs, c’est le code le plus souvent utilisé. L’oral diffère de l’écrit par son ordre de réalisation et ses conditions de production. Il implique des relations, des interactions entre l’émetteur et le récepteur. L’oral s’acquiert d’une manière individuelle, ou l’apprenant s’entraine à maitriser des situations de communication orale en imitant les paroles de l’enseignant.
L’enseignant place alors les élèves dans des situations de communication orales réelles qui provoquent des phénomènes de divers ordres: langagier, para-langagier, psychologique, sociologique. Pour cela, les perspectives de l’oral dépassent la prise de parole pour englober le contexte de cette dernière. L’oral, contrairement à l’écrit se caractérise par la spontanéité et l’invention.
Ce qui pose problème au niveau de l’oral, c’est l’insuffisance du temps pour chercher des mots appropriés aux différentes présence des participants (locuteurs, interlocuteurs). Le locuteur est en contact (auditif ou visuel) avec son interlocuteur, ce qui simplifier la compréhension et pousse l’interlocuteur à s’inscrire dans la communication, grâce aux gestes du locuteur, de ses regards et l’orientation de ses yeux vers l’interlocuteur lorsqu’il s’agit de la présence de plusieurs participants.
L’oral donc, se caractérise par les marques énonciatives.
D’autre part, l’oral a pris une place de plus en plus importante dans les programmes. En effet, parler, cela s’apprend en écoutant et en parlant, tout simplement en pratiquant.
l’oral a toute sa place :
- Au cycle 1, le langage est au cœur des apprentissages.
- Au cycle 2, les Programmes insistent sur la maîtrise du langage oral.
- Au cycle 3, à travers le DIRE, il est une compétence transversale à toutes les disciplines mais l’oral doit aussi être travaillée pour lui-même en Littérature (« Dire les textes »).
Le langage oral est important pour la socialisation. C’est le premier outil de communication et d’échanges.
Pour Jérôme Bruner, le langage nous permet de mieux appréhender le monde et de construire des concepts2.
Lev Vygotski nous a montré qu’il n’y a pas de développement de la pensée sans développement du langage oral et inversement3.
Le langage oral est un outil pour penser et explorer la réalité. Il va permettre à l’enseignant d’accompagner et d’aider le langage de l’élève et par là-même sa pensée.
Il est un outil, un moyen d’action sur les choses (pour les décrire), sur autrui (pour demander, convaincre, expliquer, interroger, ordonner) et sur soi (s’exprimer, se défendre, se connaître soi-même). Parler ou dire, c’est oser se confronter aux autres, prendre toute sa place dans la société.
A l’école, le langage est à la fois un objet à construire – savoir utiliser le langage oral – mais c’est aussi un moyen d’acquérir des connaissances
Les compétences de l’oral
Avant de commencer un travail sur l’oral, il est nécessaire d’appréhender toutes les compétences qui entrent en jeux.
Selon C. Mairal et P.Blochet ,il existe quatre compétences à acquérir pour un bon oral 4:
- Compétences communicationnelles.
- Compétences linguistiques.
- Compétences textuelles.
- Compétences discursives.
Compétences communicationnelles
Exprimer son désir de communiquer :
- Prendre la parole.
- Ecouter.
- Tenir compte de l’enjeu de communication.
- Tenir compte du lieu social et du lieu concret de la communication.
- Adapter sa voix (timbre, rythme, puissance, mélodie…) à la situation de communication.
- Etablir un contact charnel socialisé (degré de proximité des locuteurs, jeu des regards…).
- Adopter une attitude en fonction de la situation de communication (gestuelle, mimique, tenue vestimentaire, posture…).
- Savoir utiliser un matériel qui favorise la communication.
- Savoir faire évoluer l’échange langagier en fonction de la situation de communication.
- Savoir faire fonctionner l’échange langagier en adaptant ses stratégies discursives à la situation.
- Savoir tenir des rôles différents.
Compétences linguistiques
- Savoir respecter un axe de cohérence (poursuivre la même information, adapter le même point de vue).
- Savoir de quoi il est question.
- Savoir trouver les mots pour le dire.
- Savoir traduire ce dont il est question dans un registre de langue et dans un niveau de langage adapté.
- Savoir traiter l’information :
- la hiérarchiser
- la sélectionner.
- l’ordonner.
- l’organiser.
- adapter son niveau de complexité.
- Garder la même énonciation.
- Employer les outils linguistiques appropriés :
- les types de phrases.
- la complexité de la structure langagière.
- la complexité de la structure phrastique.
- les organisateurs et connecteurs traduisant les neuf notions fondamentales : comparaison, lieu, temps, cause, opposition, conséquence, condition, but, moyen.
- l’expression verbale du temps.
- le jeu des pronoms et des anaphores.
- la variété des interjections.
- Savoir reformuler ou diversifier des outils linguistiques.
Compétences textuelles
- Connaître le type d’oral :
- son enjeu.
- sa structure.
- son principe de fonctionnement.
- Savoir insérer des séquences textuelles différentes en fonction de l’enjeu d’oral choisi.
- Connaître le type d’oral :
Compétences discursives
- La conduite narrative : être capable d’organiser des éléments dans le temps.
- La conduite descriptive : être capable de parler d’éléments organisés dans l’espace.
- La conduite explicative : être capable de donner des informations à quelqu’un qui n’est pas censé les connaître.
- La conduite argumentative: être capable de donner son point de vue, argumenter, convaincre.
- La conduite prescriptive (ou injonctive): être capable de faire faire quelque chose à quelqu’un (consigne orale).
- Interroger et demander : être capable de demander à quelqu’un une information.
Qu’est ce qu’une situation d’écoute?
Dans l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère, la compétence de la compréhension orale est motivée par une technique d’écoute.il s’agit d’écouter pour comprendre une information. Comme le confirme Jean-Francois MICHEL :
« la compréhension s’effectue principalement par l’écoute »5.
L’enseignement du FLE doit adapter la compétence de la compréhension orale à des différentes situation d’écoute.il doit donc, faire apprendre à ses apprenants de varier la façon d’écouter en fonction d’un objectif de compréhension.
La compréhension orale définition et concepts Selon le dictionnaire de Jean Pièrre ROBERT, il existe cinq types d’écoute qui sont mis en œuvre, en fonction de l’objectif de compréhension:
écoute sélective
Apprendre à n’écouter que le(s) passage(s) qui est (sont) nécessaire(s) à la réalisation d’une tâche, apprendre à ’’ ne pas entendre’’ le reste.
écoute détaillée
Apprendre à prendre connaissance de tout ce qu’on veut écouter (dans un passage particulier, dans une catégorie d’informations, dans un discours oral). C’est une écoute exhaustive, de durée variable.
écoute globale
Apprendre à découvrir suffisamment d’éléments du discours pour en comprendre la signification générale.
écoute réactive
Apprendre à utiliser ce qu’on comprend pour faire quelque chose (prendre des notes, réaliser un gâteau, faire fonctionner un appareil, etc.). Ce type d’écoute nécessite de savoir mener deux opérations en même temps : il faut par exemple décider si les informations sont importantes, décider si l’auditeur doit intervenir sur le discours du locuteur (si l’interaction est possible), etc., tout en continuant à écouter.
écoute de veille
Ecoute automatique, sans réelle compréhension, mais qui fait place à une autre écoute dès qu’un mot ou groupe de mots déclenche un intérêt pour le discours. » »6.
L’acte d’écouter n’est pas évident pour certains apprenants. Tout auditeur confronté à un problème de réception a pour premier réflexe de réécouter s’il le peut. Si cet acte est banal en langue maternelle, ce n’est plus le cas en langue étrangère. Il est important d’expliquer aux apprenants que le document proposé par l’enseignant dans la séance de compréhension orale n’est pas générateur de stress en soi, qu’il est inutile de l’envisager comme un ennemi.
________________________
1 Jean-Francois MICHEL : Les 7 profils d‘apprentissage pour former et enseigner ,Ed. D’Organisation, Paris, 2005, p.48. ↑
2 Jérôme Bruner, Comment les enfants apprennent à parler ? , Edition Retz, 1987. ↑
3 Lev Vygotski, Pensée et langage, Edition La Dispute, 1997. ↑
4 Mairal et P. Blochet , Maîtriser l’oral, Edition Magnard, 1998. ↑
5 Jean-Francois MICHEL : Les 7 profils d‘apprentissage pour former et enseigner ,Ed. D’Organisation,Paris, 2005, p.48. ↑
6 Jean Pièrre ROBERT, Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Ophrys, 2008. ↑
