Le droit de communication en droit fiscal est analysé à travers les distinctions entre communication « active » et « passive » des tiers, soulignant les obligations de preuve imposées à l’administration fiscale. L’article met en lumière les déséquilibres dans la charge de la preuve et les présomptions légales.
B- L’exercice du droit de communication à l’égard des tiers
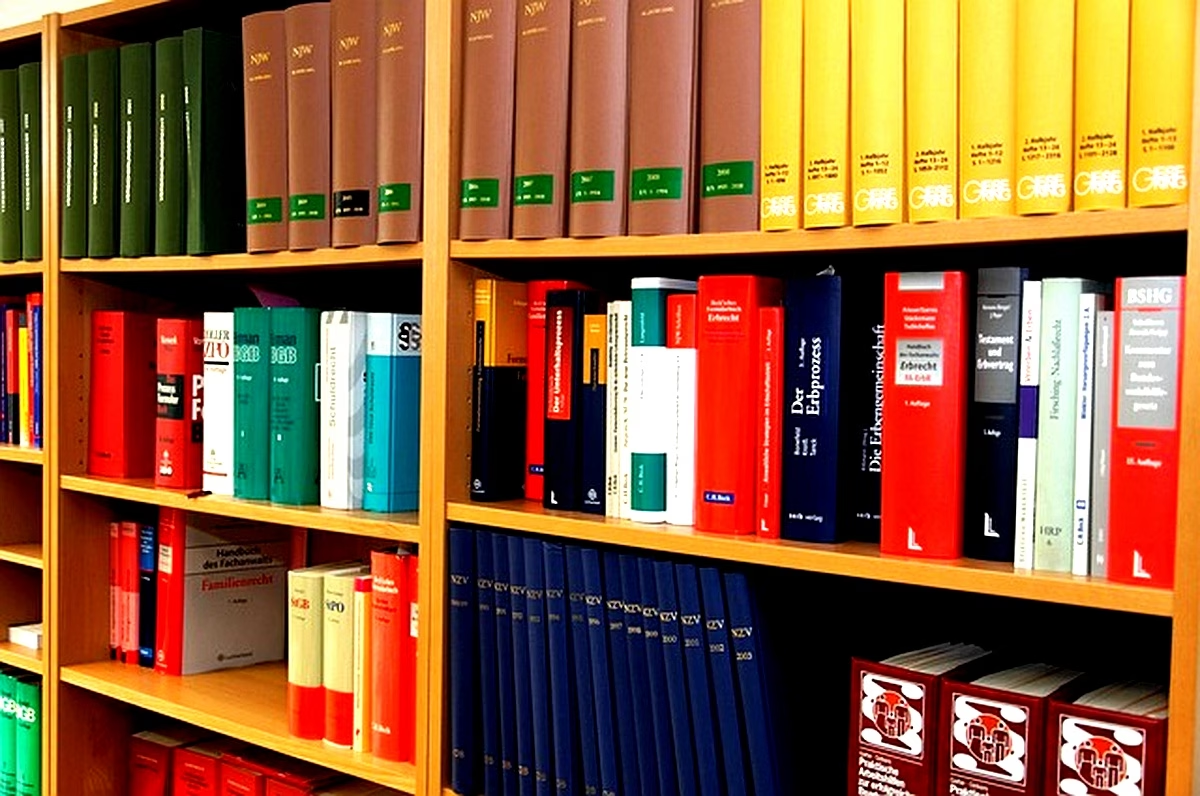
Le C.D.P.F. prévoit, dans ses articles 16 à 18, une liste des tiers soumis au droit de communication6. Non seulement l’administration peut demander aux tiers de lui fournir des éléments de preuve (2), mais bien plus ces éléments lui sont même fournis sans initiative de sa part (1). C’est ainsi que Alain PUPIER distingue respectivement entre le droit de communication « actif » et le droit de communication « passif »7.
1) La communication automatique
Certaines personnes ou services sont tenus de faire connaître d’office à l’administration fiscale, sans demande de celle-ci, des renseignements relatifs aux contribuables. Il s’agit là d’un droit de communication « passif ».
En revanche, le droit de vérification est subordonné au respect des garanties offertes par la loi au contribuable vérifié ; tel que l’information préalable, le débat oral et contradictoire.
Ainsi, l’article 16 alinéa 2 et 3 du C.D.P.F. dispose que : « Les services de l’Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics ainsi que les sociétés dans le capital desquelles l’Etat détient directement ou indirectement une participation, doivent faire parvenir aux services compétents de l’administration fiscale, tous les renseignements relatifs aux marchés pour construction, réparation, entretien, fourniture, services et autres objets mobiliers qu’ils passent avec les tiers selon un modèle établi par l’administration, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de leur passation.
Les officiers publics et les dépositaires d’archives et de titres publics sont tenus de communiquer pour consultation sur place, aux agents de l’administration fiscale à ce habilités, les actes, écrits, registres et pièces des dossiers détenus ou conservés par eux dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont tenus également de permettre à ces agents de prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies nécessaires pour le contrôle des actes et des déclarations ».
De son côté l’article 18 du C.D.P.F. dispose que : « Le ministère public communique aux services de l’administration fiscale, tous les renseignements et documents présumant une fraude fiscale ou tout autre agissement ayant pour but de frauder l’impôt ou de compromettre son paiement qu’il s’agisse d’une instance civile, commerciale ou d’une instruction pénale même terminée par un non-lieu ». Il s’agit là d’un droit de communication de l’administration auprès de l’autorité judiciaire1.
Il apparaît que la loi définit d’une manière large les personnes ou services soumis au droit de communication. La communication est dans ce cas automatique, spontanée. Elle n’est pas subordonnée à une demande écrite de l’administration.
2) La communication sur demande de l’administration
L’article 16 alinéa 1er du C.D.P.F. dispose que : « Les services de l’Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les sociétés et organismes contrôlés par l’Etat ou par les collectivités locales ainsi que les établissements, entreprises et autres personnes morales du secteur privé et les personnes physiques, doivent communiquer aux agents de l’administration fiscale sur demande écrite et pour consultation sur place les registres, la comptabilité, les factures et les documents qu’ils détiennent dans le cadre de leurs attributions ou dont la tenue leur est prescrite par la législation fiscale. Ils doivent, en outre, faire parvenir aux agents de l’administration fiscale, sur demande écrite, des listes nominatives de leurs clients et fournisseurs comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de biens effectués avec chacun d’eux, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la notification de la demande ».
Selon l’article 16 du C.D.P.F., on constate que le droit de communication a connu une extension de son champ d’application, il n’épargne aucune personne qu’elle soit publique ou privée.
L’article 16 alinéa 4 du C.D.P.F. dispose que : « Les services et les personnes physiques ou morales, visés au présent article ne peuvent, en l’absence de dispositions légales contraires, opposer l’obligation du respect du secret professionnel aux agents de l’administration fiscale habilités à exercer le droit de communication ». Cet article consacre l’inopposabilité du secret professionnel au fisc. Il s’agit d’un facteur de la prédominance du fisc dans l’administration de la preuve.
Enfin, l’innovation la plus importante concerne l’article 17 du C.D.P.F. L’article 17 tel que modifié par la loi n°2002-1 du 8 janvier 2002 dispose que : « Le droit de communication prévu par l’article 16 du présent code consiste, en ce qui concerne l’activité financière des établissements bancaires et postaux relative à l’ouverture des comptes, en la communication aux services compétents de l’administration fiscale sur demande écrite, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la notification de la demande, des numéros des comptes qui se trouvent ouverts auprès d’eux durant la période non prescrite2, de l’identité de leurs titulaires ainsi que la date d’ouverture de ces comptes lorsque l’ouverture a eu lieu durant la période susvisée et la date de leur clôture lorsque celle-ci a eu lieu au cours de la même période.
Le droit de communication prévu par le paragraphe premier du présent article ne s’applique qu’aux contribuables se trouvant en vérification approfondie de leur situation fiscale à la date de la présentation de la demande.
Le droit de communication prévu par le présent article s’exerce par les agents de l’administration fiscale habilités à cet effet ».Cet article appelle deux observations :
D’une part, l’article 17 du C.D.P.F. institue un droit de communication au profit du fisc dont l’objet consiste en la communication des numéros de comptes bancaires et postaux ouverts par les établissements financiers ainsi que l’identité de leurs titulaires. Ainsi, le voile du secret bancaire est levé3. Toutefois, il faut souligner qu’en dehors des renseignements susvisés, le secret bancaire n’est pas levé et les établissements en question ne sont pas tenus de répondre à des demandes de communication relatives aux mouvements des comptes ouverts auprès d’eux4. Légalement, ces organismes ne sont tenus de communiquer que les numéros de comptes et l’identité de leurs titulaires. L’administration ne peut en aucune manière exiger des institutions financières la communication des mouvements de comptes.
D’autre part, l’article 17 nouveau du C.D.P.F. remplace l’article 17 ancien5 qui avait déclenché une vive inquiétude en particulier auprès des agents économiques6. Pour calmer le jeu, cet article 17 ancien a été abrogé par l’article premier de la loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002, portant assouplissement des procédures fiscales7, et remplacé par l’article 17 nouveau. La règle de la communication automatique des relevés bancaires a été supprimée. Cette communication est désormais subordonnée à une demande écrite de l’administration fiscale. On passe donc d’une information à l’initiative d’une tierce personne à une information à l’initiative de l’administration8. Par ailleurs, ce droit de communication est désormais conditionné par le fait que contribuable doit être dans une situation de vérification fiscale approfondie. Il en résulte que l’administration doit adresser à la banque une copie de l’avis de vérification reçu par le contribuable concerné.
En dépit des améliorations apportées par la loi portant assouplissement des procédures fiscales, au droit de communication auprès des banques, ce droit de communication demeure critiquable. En effet, il donne un blanc seing à l’administration fiscale pour demander communication des numéros de compte ouverts sans qu’aucune autorité autonome ne puisse vérifier que les contribuables concernés par ce droit de communication sont réellement sous vérification approfondie9.
Au total, il apparaît que la loi définit d’une manière large les personnes ou services soumis au droit de communication. Comparées aux dispositions des textes fiscaux antérieurs, en l’occurrence le C.I.R., les nouvelles dispositions relatives au droit de communication ont un caractère plus large. Le droit de communication a connu une extension de son champ d’application, il n’épargne aucune personne qu’elle soit personne physique ou morale, publique ou privée. Il s’étend même au ministère public. Toutes ces personnes viennent au secours de l’administration fiscale en lui donnant les éléments de la preuve dont elle a la charge.
Par ailleurs, l’administration fiscale peut adresser des demandes de renseignements à des personnes non soumises au droit de communication. D’ailleurs, les services de l’administration fiscale sont habitués à écrire à quiconque pour demander des renseignements et des éclaircissements sur un tiers. On assiste alors à une extension non reconnue et non autorisée par la loi au profit de l’administration fiscale10.
Toutefois, la jurisprudence française considère que l’administration ne peut pas s’appuyer, pour établir un redressement, sur des pièces qu’elle a obtenues ou qu’elle détient de manière manifestement illicite : tel est le cas lorsque le service a utilisé des documents volés par un salarié du contribuable11.
Il importe de souligner que le défaut de communication à l’administration des informations exigées est sanctionné par une amende fiscale12. Toutefois, cette sanction ne s’applique qu’aux personnes qui sont assujettis légalement13 au droit de communication. Les personnes non visées par le C.D.P.F. ne sont pas tenues légalement de répondre et n’encourent aucune sanction14.
Le droit de communication confère à l’administration fiscale des pouvoirs exorbitants qui menacent la sécurité, la tranquillité et la vie privée du contribuable15. A vrai dire, si ce dernier trouve légitime que l’administration contrôle ses déclarations, il n’accepte pas qu’elle procède à une inquisition permanente et générale. « L’inquisition fiscale reste, en dépit de sa nécessité, difficilement supportable. Le contribuable ne peut la tolérer que si elle est compensée par l’octroi de garanties qu ne sont pas, au demeurant, des panacées »16.
________________________
1 Voir M. GOTHIER, « Le droit de communication de l’administration auprès de l’autorité judiciaire », B.F. F. LEFEBVRE, avril 1989, p.222. ↑
2 C’est-à-dire 5 ans ou 10 ans. ↑
3 Sur le secret bancaire on peut se reporter à :
- A. BEL HADJ HAMMOUDA, « Le secret professionnel du banquier en droit tunisien ou pour un secret bancaire plus renforcé », R.T.D. 1979, p.11.
- Thierry AFSCHRIFT, « Le secret bancaire en droit fiscal », disponible sur le site Internet www.waw.be/idefisc/themes/secret-bank.htm
- Naïm MOGHABGHAB, « Le secret bancaire : Etude de droit comparé (Belgique, France, Suisse, Luxembourg et Liban) », 1996.
- Raymond FARHAT, « Le secret bancaire : Etude de droit comparé ( France, Suisse, Liban) », thèse pour le doctorat, paris, L.G.D.J. 1967.
- Claude MORAIS, « Etude comparée sur le secret bancaire ( Etats-Unis, Canada) », revue générale de droit mars 1997, p. 71-87. ↑
4 Abdelhamid BEN JABALLAH, « Le contribuable face au fisc: droits, obligations et procédures fiscales », Tunis 2002, p.63. ↑
5 L’article 17 avant sa modification par la loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002, portant assouplissement des procédures fiscales, disposait que : « Le droit de communication prévu par l’article 16 du présent code consiste, pour l’activité financière des établissements bancaires et postaux relative à l’ouverture des comptes, en la communication aux services compétents de l’administration fiscale d’une liste comportant les numéros des comptes qu’ils ont ouverts durant le mois ainsi que l’identité de leurs titulaires, et ce, durant les vingt huit premiers jours du mois qui suit ».
Par ailleurs, l’art.15 de la loi de promulgation du C.D.P.F, qui comportait un droit de communication provisoire auprès des banques concernant l’année 2001, a été abrogé par l’article 2 de la loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002, portant assouplissement des procédures fiscales. ↑
6 Les critiques adressées à cet article sont essentiellement : affaiblissement du secret bancaire et l’inquisition fiscale insupportable.
D’ailleurs le ministre des finances a du intervenir par un communiqué de presse (février 2001) et par un courrier adressé aux banques. ↑
7 L’intitulé malheureux de cette loi constitue à lui seul un aveu implicite du caractère rigoureux des procédures fiscales en vigueur. ↑
8 Abdelhamid BEN JABALLAH, « Le contribuable face au fisc: droits, obligations et procédures fiscales », Tunis 2002, p.62. ↑
9 Abdelhamid BEN JABALLAH, ibid., p.62. ↑
10 Walid GADHOUM, mémoire précité, p. 54. ↑
11 CAA Lyon, 5 juillet 1994, R.J.F. 10/94, n°1022, in H. AYADI, « Droit fiscal, Taxe sur la Valeur Ajoutée, Droits de consommation et contentieux fiscal », C.E.R.P., Tunis, 1996, p.180. ↑
12 L’article 100 du C.D.P.F. dispose que : « Quiconque manque aux dispositions des articles 16 et 17 du présent code, est puni d’une amende de 100 dinars à 1.000 dinars majorée d’une amende de 10 dinars par renseignement non communiqué ou communiqué d’une manière inexacte ou incomplète.
L’infraction peut être constatée par intervalle de quatre vingt dix jours à compter de la précédente constatation et donne lieu à l’application de la même amende ». ↑
13 Articles 16 et 17 du C.D.P.F. ↑
14 Dans cet esprit, la jurisprudence française a jugé irréguliers les renseignements acquis par l’administration fiscale car celle-ci avait pu induire en erreur ceux des clients du contribuable qui n’étaient pas soumis au droit de communication, en leur faisant croire qu’ils étaient obligés de fournir les renseignements demandés, sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi : C.E., 1 avril 1987, R.J.F. 5/1987, p. 305 ; C.E. 1 juillet 1987, R.J.F. 1987, p. .542 et 505, concl. Fouquet ; in H. AYADI, « Droit fiscal, Taxe sur la Valeur Ajoutée, Droits de consommation et contentieux fiscal », op. Cit., p.180. ↑
15 Sur la question du respect de la vie privée en droit fiscal, on se reportera à l’ouvrage de Marie-Christine VALSCHAERTS, « Les pouvoirs d’investigation des administrations fiscales, spécialement dans leur rapport avec le respect de la vie privée de l’individu », Bruxelles, Bruylant 1989. ↑
16 Jean WILMART : « Réflexions sur la décomposition et le déplacement de la preuve en droit fiscal », mélanges en hommage à Léon Graulich, Liège 1957, p.173. ↑