La dissolution du ZnO par acides organiques a été étudiée pour récupérer le ZnO à partir du catalyseur ZnO/Al2O3, en utilisant des lixiviants naturels comme l’acide citrique. Cette approche hydrométallurgique vise à minimiser l’impact écologique tout en optimisant l’efficacité de la récupération.
Etude de la dissolution du ZnO par les acides organiques
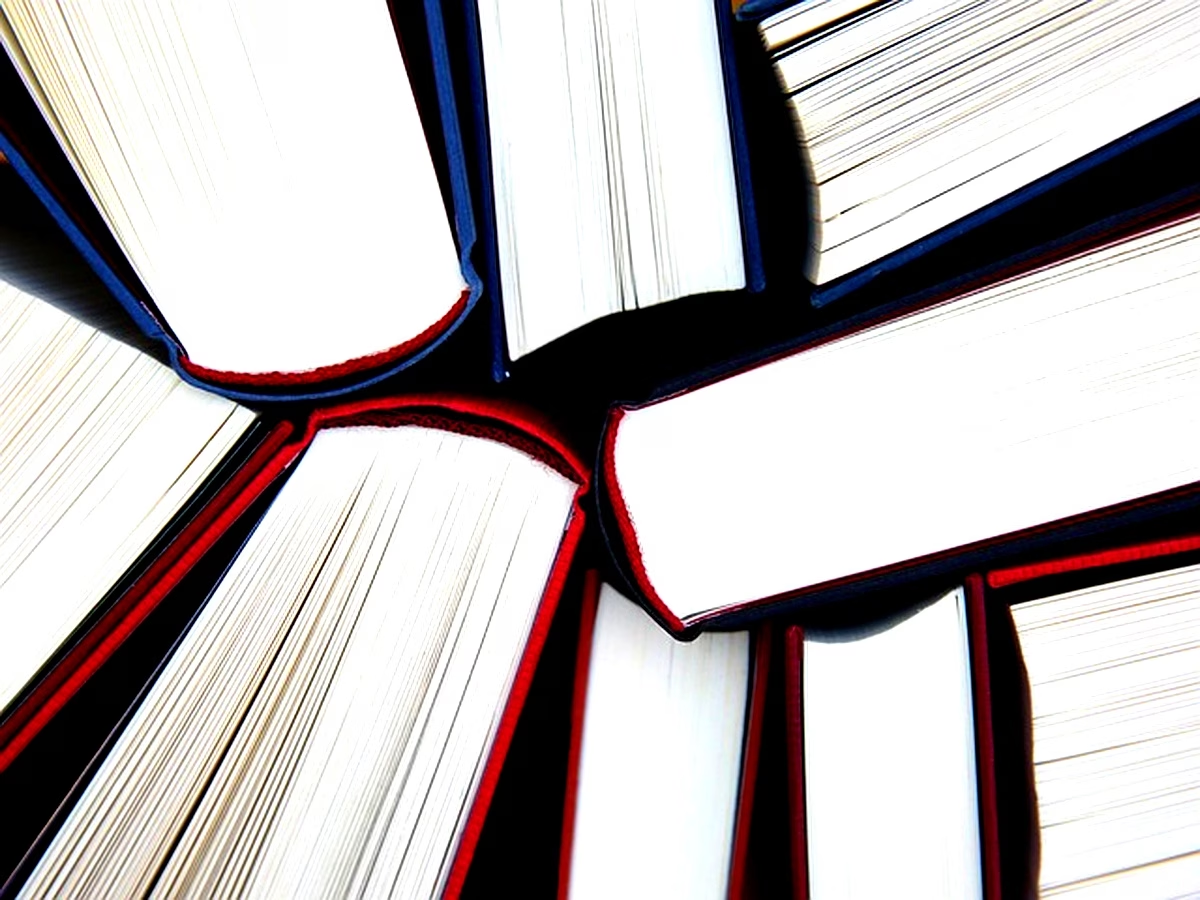
Les réactions de dissolution du ZnO par les quatre acides peuvent s’écrire comme suit 1:
3ZnO(s) + 2C6H8O7(aq) → 3Zn2+ + 2C6H5O 3- + 3H2O (l) (V.1)
ZnO(s) + C6H8O6(aq) → Zn2+ + C6H6O62- + H2O(l) (V.2)
ZnO(s) + 2C3H6O3(aq) → Zn2+ + 2C3H5O3– + H2O(l) (V.3)
ZnO(s) + 2C2H4O2(aq) → Zn2+ + 2C2H3O2– + H2O(l) (V.4)
Une masse de 0,153g du ZnO a été mise en contact avec 200mL de la solution d’acide, le mélange est agité magnétiquement à une température constante. Après chaque temps t un prélèvement de 1mL est réalisé afin de doser les ions Zn2+ dissous. Le suivi de l’avancement de la dissolution se poursuit jusqu’à 2heures de réaction.
Les conditions opératoires susceptibles d’influencer les rendements de dissolutions telles que la concentration des acides, la température, et la vitesse d’agitation ont été étudiées. Les résultats obtenus sont présentés ci-après.
Effet de la concentration des acides organiques
L’effet de la concentration initiale des quatre acides a été étudié en testant plusieurs valeurs : 0,005-0,01-0,05 et 0,1M à 25°C et 350tr/min (rpm). Les résultats sont représentés sur les figures V.5 a-d.
[img_1]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
acide citrique
0,005M
0,01M
0,05M
0,1M
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
[img_2]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
acide ascorbique
0,005M
0,01M
0,05M
0,1M
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
[img_3]
100
90
acide lactique
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,005M
0,01M
0,05M
0,1M
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
[img_4]
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
acide acétique
0,005M
0,01M
0,05M
0,1M
0 20 40 60 t(min) 80 100 120
ZnO dissout (%)
ZnO dissout (%)
ZnO dissout (%)
ZnO dissout(%)
(c) (d)
Fig. V.5. Effet de la concentration des acides sur la dissolution du ZnO.
Les résultats montrent que l’acide citrique donne les meilleurs rendements de dissolution quelque soit la concentration utilisée comparé aux autres acides. En effet, la dissolution totale a été obtenue après 50min de réaction à la concentration de 0,1M.
L’acide lactique a aussi totalement dissout l’oxyde de zinc mais après 120min de réaction suivi par l’acide acétique 71,7% et ascorbique 50,2% après le même temps de réaction. Afin de pouvoir suivre correctement la cinétique de dissolution de l’oxyde de zinc, la concentration de 0,05M a été choisi pour le reste des expériences.
Effet de l’agitation
L’effet de l’agitation a été étudié en testant trois valeurs : 100-350 et 600tr/min en travaillant avec une concentration en acide égale à 0,05M à 25°C. Les résultats sont présentés sur les figures V.6 a-d.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
acide citrique
100tr/min
350tr/min 600tr/min
0 10 20 30 t (min) 40 50 60
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
acide ascorbique
100tr/min
350tr/min 600tr/min
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
ZnO dissou (%)
ZnO dissout (%)
70
60 acide lactique
50
40
30
20
10
100tr/min
350tr/min
600tr/min
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
acide acétique
100tr/min
350tr/min
600tr/min
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
ZnO dissout (%)
ZnO dissout (%)
(c) (d)
Fig. V.6. Effet de la vitesse d’agitation sur la dissolution du ZnO.
Même si une amélioration de la dissolution de l’oxyde de zinc a été observée, elle reste tout de même faible par rapport à l’énergie électrique déployée. En effet, la multiplication par 6 de la vitesse d’agitation (passage de 100tr/min à 600tr/min) a augmenté le rendement de dissolution dans le cas de l’acide citrique par exemple de 10% seulement (85,3% à 94,2% respectivement après 60min de réaction). Le même constat est fait pour les autres acides.
C’est pourquoi une valeur intermédiaire de 350tr/min a été retenue pour le reste des expériences.
Effet de la température
L’effet de la température a été étudié en testant plusieurs valeurs : 25- 40- 50 et 60°C. Les expériences ont été menées avec une concentration en acide égale à 0,05M et une agitation de 350tr/min. Les résultats sont montrés sur les figures V.7 a-d.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
acide citrique
25°C
40°C
50°C
60°C
0 10 20 30 t (min) 40 50 60
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
acide ascorbique
25°C
40°C
50°C
60°C
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
ZnO Dissout (%)
ZnO dissout (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
acide lactique
25°C
40°C
50°C
60°C
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
acide acétique
25°C
40°C
50°C
60°C
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
ZnO dissout (%)
ZnO dissout (%)
(c) (d)
Fig. V.7. Effet de la température sur la dissolution du ZnO par les quatre acides
Les résultats montrent que la température joue un rôle déterminant dans la dissolution de l’oxyde de zinc étant donné qu’une nette amélioration a été observée avec les quatre acides.
En effet, une dissolution totale a été obtenue après 20min, 60min et 120min avec les acides citrique, lactique et acétique respectivement. L’acide ascorbique a enregistré 96,9% après 120min de réaction.
Suivi du pH des solutions au cours des réactions chimiques
Le suivi de l’évolution du pH au cours d’une réaction chimique peut aider à expliquer le degré d’implication des ions H+ dans la dissolution de l’oxyde. Pour cela le suivi du pH avec les quatre acides à différentes concentrations a été réalisé à 25°C et 350tr/min à l’aide d’un pH mètre type Boeco. Les résultats sont montrés sur les figures V.8 a-d.
4,5
acide citrique
4
3,5
0,005M
0,01M
0,05M
0,1M
3
2,5
2
0 20 40 60 t(min) 80 100 120
5
acide ascorbique
4,5
4
3,5
3
2,5
0,005M
0,01M
0,05M
0,1M
2
0 20 40 60 t(min) 80 100 120
pH
pH
5
4,5
acide lactique
4
0,005M
0,01M
0,05M
0,1M
3,5
3
2,5
2
0 20 40 60 t(min) 80 100 120
5
4,5
4
3,5
3
acide acétique
2,5
0,005M
0,01M
0,05M
0,1M
2
0 20 40 60 t(min) 80 100 120
pH
pH
(c) (d)
Fig. V.8. Suivi du pH des solutions au cours de la dissolution du ZnO par les quatre acides.
Il a été observé une augmentation des valeurs du pH indiquant une consommation graduelle des protons. Dans tous les cas, le pH des solutions est resté dans le domaine acide. Avec l’acide citrique le pH n’a plus varié à partir de 90min à la concentration de 0,05M et 50min à 0,1M.
Ces temps correspondent à l’arrêt de la consommation des ions H+ étant donné que la totalité de l’oxyde a été dissoute à partir de ces temps d’après la figure V.5a.
Etude cinétique
Comme il a été décrit dans le chapitre IV, la vitesse d’une réaction entre un solide et un liquide peut être décrite par un modèle hétérogène 2. Ce modèle stipule que la vitesse d’une réaction peut être contrôlée soit par la diffusion à travers le film liquide, soit par la diffusion à travers une couche de produits soit par la réaction chimique. Octave Levenspiel a donné les équations pour chacun des cas. Ainsi, la fraction x du solide dissout en fonction du temps t est donnée comme suit :
k.t = x pour une réaction contrôlée par la diffusion à travers le film liquide (V.5)
k.t = 1- 3(1-x)2/3 + 2(1-x) pour une réaction contrôlée par la diffusion à travers la couche de produits (V.6)
k.t = 1- (1-x)1/3 Contrôlée par la réaction chimique (V.7) La vitesse de la réaction sera contrôlée par le processus le plus lent.
Les trois équations ont été appliquées sur les résultats obtenus en fonction de la température. Les valeurs des constantes de vitesse déterminées à partir du modèle qui correspond le plus (coefficient de régression linéaire le plus proche de 1), ont été utilisées pour calculer l’énergie d’activation des réactions de dissolution de l’oxyde à l’aide de l’équation d’Arrhenius :
K=A.e-Ea/RT. (V.8)
Les réactions contrôlées par la réaction chimique sont plus sensibles aux variations de température et possèdent des énergies d’activation supérieures ou égales à 40kJ/mole contrairement aux processus de diffusion qui eux sont plus sensibles à l’agitation et ont des énergies d’activation entre 10 et 20kJ/mole. Faire varier la température lors des expériences donne ainsi des informations sur la nature du contrôle cinétique.
L’équation V.7 a donné des droites avec des coefficients de régression linéaire proches de l’unité indiquant un processus contrôlé par la réaction chimique comme montré sur les figures V.9 a-d.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
40°C
50°C
60°C
25°C
acide citrique
y = 0,051x – 0,0535
R² = 0,9889
y = 0,0294x – 0,0066
R² = 0,9979
y = 0,0189x – 0,0053 R² = 0,9967
y = 0,0087x + 0,011 R² = 0,9915
0 10 20 30 t (min) 40 50 60
0,8
0,7
0,6
25°C
40°C
50°C
60°C
acide ascorbique
y = 0,0056x + 0,0308
R² = 0,9988
0,5
y = 0,0038x + 0,0263
R² = 0,9992
0,4
y = 0,002x + 0,0221
0,3 R² = 0,9992
0,2
0,1
y = 0,0011x + 0,0125
R² = 0,9881
0
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
1-(1-X)1/3
1-(1-X)1/3
(a) (b)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
25°C
40°C
50°C
60°C
acide lactique
y = 0,0131x + 0,0248
R² = 0,9993
y = 0,0077x + 0,0154
R² = 0,9993
y = 0,0047x + 0,0229 R² = 0,999
y = 0,002x + 0,0175 R² = 0,9968
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
25°C
40°C
50°C
60°C
acide acétique
y = 0,007x + 0,0284
R² = 0,9992
y = 0,0046x + 0,0328
R² = 0,9964
y = 0,0033x + 0,0333
R² = 0,9979
y = 0,0011x + 0,0307 R² = 0,9974
0 20 40 60 t (min) 80 100 120
1-(1-X)1/3
1-(1-X)1/3
(c) (d)
Fig. V.9. Application du modèle de Levenspiel sur les résultats de dissolution du ZnO par les quatre acides organiques
Il faut noter que la constante de vitesse de la réaction de dissolution de l’oxyde de zinc par l’acide citrique à 60°C et 10 fois plus élevée que celle calculée pour l’acide ascorbique et presque 4 fois plus élevée que celle obtenue pour l’acide lactique.
L’équation d’Arrhenius k = A·e-Ea/RT a été utilisée pour déterminer la valeur des énergies d’activation pour chaque réaction de dissolution. Lnk en fonction de (1/T) a été tracé pour chaque température et l’énergie d’activation a été calculée à partir de la pente –Ea/R, comme montré sur les figures V.10 a-d.
1/T (K-1)
0
-0,50,0029
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5
-4
-4,5
-5
0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034
Acide citrique
y = -4952,9x + 11,856 R² = 0,9971
1/T (K-1)
0
0,0029
-1
0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034
-2
-3
Acide ascorbique
-4
-5
y = -4729,8x + 9,0082
R² = 0,9876
-6
-7
-8
(a) (b)
1/T (K-1)
0
0,0029
-1
0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034
-2
Acide acétique
-3
-4
-5
-6
-7
y = -5516,3x + 11,676
R² = 0,9861
-8
1/T (K-1)
0
0,0029
-1
0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034
-2
Acide lactique
-3
-4
-5
y = -5302,5x + 11,571
R² = 0,9995
-6
-7
LnK
LnK
LnK
LnK
(c) (d)
Fig. V.10. Calcul des énergies d’activation pour les quatre réactions de dissolution
Les valeurs des énergies d’activation calculées à partir des pentes sont comme suit : Ea (citrique)=41,2kJ/mole,
Ea (lactique)=44,1kJ/mole,
Ea (ascorbique)=39,33kJ/mole, Ea (acétique)=45,9kJ/mole
Les valeurs des énergies d’activation calculées sont supérieures ou égales à 40kJ/mole ce qui corroborent le contrôle de la dissolution par la réaction chimique.
Conclusion
Il ressort des résultats obtenus que quelque soit les conditions opératoires utilisées l’efficacité de dissolution de l’oxyde de zinc par les acides testés va dans l’ordre suivant :
acide citrique >>acide lactique > acide acétique > acide ascorbique.
L’acide citrique a totalement dissout l’oxyde de zinc à 25°C après 90min à la concentration de 0,05M et après 50min à la concentration de 0,1M. Ces conditions sont considérées comme très modérées et le rendement de dissolution est maximal ce qui répond à l’objectif tracé au départ de cette étude.
A la fin de chaque opération de dissolution, les solutions restantes contenant les ions Zn2+ ont été récupérées dans de grands récipients en plastique, séché à l’air libre et en étuve à 105°C et ensuite calcinées dans un four à moufle. Au cours de la calcination, la solution organique se transforme en CO2 et les ions Zn2+ en ZnO pur. La poudre obtenue a été stockée pour être réutilisée ultérieurement directement sans post-traitements.
L’acide citrique a été retenu parmi les quatre acides testés. Il sera donc utilisé pour étudier la lixiviation de l’oxyde à partir d’un composé binaire (ZnO/Al2O3).
________________________
1 [22] Référence bibliographique non fournie. ↑
2 [23] Référence bibliographique non fournie. ↑