Cette étude révèle les défis et solutions des contrats électroniques au Bénin, en mettant en lumière les protections juridiques essentielles pour le consommateur. Découvrez comment ces mécanismes garantissent une exécution contractuelle équilibrée et renforcent la confiance dans les transactions numériques.
DEUXIЀME PARTIE : UNE PROTECTION VISANT LA BONNE EXECUTION DU CONTRAT
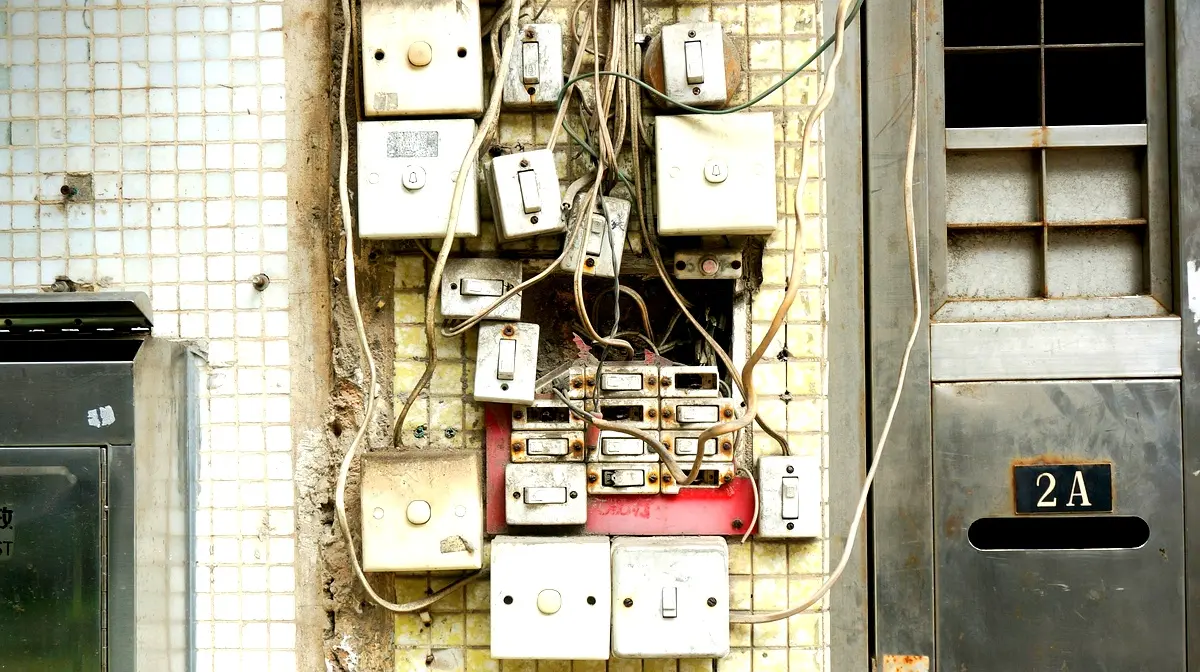
La bonne exécution du contrat électronique est conditionnée par un certain nombre de garantie que la loi offre au consommateur en raison de sa position de partie faible au contrat. Cette protection octroyée au consommateur donne à ce dernier le bénéfice d’exiger du professionnel des garanties pouvant lui permettre de s’assurer de la crédibilité de l’engagement contractuel, encore que ces garanties s’imposent de manière automatique à tout professionnel qui noue une relation virtuelle avec un consommateur sur la base d’un contrat électronique. La protection du consommateur lors de la parfaite exécution du contrat, touche non seulement la prestation que le professionnel offre au consommateur (Chapitre I), mais aussi la sécurité du consommateur lui-même (Chapitre II).
CHAPITRE I : Une protection relative à la prestation fournie
Plaçant l’intérêt fondamental du consommateur au cœur du processus contractuel numérique, le législateur offre à ce dernier une certaine garantie qui sont à la charge du professionnel que ce dernier doit en raison de ses obligations contractuelles, fournir au consommateur une assurance pouvant lui permettre de ne douter de la légalité de l’opération contractuelle dans laquelle il s’engage. Cette assurance concerne l’étape de livraison qui est l’une des étapes primordiales dans l’exécution du contrat électronique (Section I). En plus de la protection exclusive dont bénéficie le consommateur lors de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services, ce dernier se voit octroyer des garanties dites légales (Section II).
Section I :
Les garanties liées à la livraison
Étant au cœur du processus contractuel, l’étape de la livraison occupe une place importante dans la relation des parties en matière de transaction. Que cette transaction soit une transaction ordinaire ou numérique, la livraison constitue pour le professionnel, une obligation contractuelle que ce dernier est tenu d’honorer avec loyauté et sincérité. Ainsi, la livraison en raison de son importance dans la relation contractuelle des parties, bénéficie d’un régime particulier (Paragraphe I). Si ledit régime parait à priori protecteur, il n’accorde pas une protection absolue au consommateur, d’où la nécessité de son renforcement (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le régime de la livraison
Le professionnel a la responsabilité de remplir convenablement ses obligations contractuelles. La livraison du bien ou la fourniture de la prestation de services étant une charge qui pèse sur lui et impliquant son entière responsabilité, il est contraint de déployer les efforts nécessaires pour en répondre (A). Mais, il peut dans certains cas être exonéré de cette responsabilité (B).
A- Un régime de pleine responsabilité
« Le cybermarchand est tenu d’exécuter la commande dans un temps limité par la loi »1. En droit positif béninois, ce délai est de trente (30) jours sauf en cas d’accord express des parties2. Cette exécution n’est rien d’autre que la livraison3. La livraison de la chose vendue peut être exécutée de deux manières : Si le bien ou le service est immatériel, une livraison par l’intermédiaire du réseau devient possible.
Ce mode d’exécution présente le principal avantage de la rapidité, ce qui plaît généralement à l’acheteur. Cet avantage masque néanmoins une concession de taille. La livraison en ligne entraîne en effet une exception au droit de rétractation du consommateur. Si le bien ne le permet pas ou les parties ne le désirent pas, la livraison peut avoir lieu en dehors du réseau.
Il s’agit alors d’une vente à distance traditionnelle, à la différence près que l’internationalisation sera fréquemment beaucoup plus poussée. Dans les contrats à distance, le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services.
À défaut, il doit livrer ou exécuter dès la conclusion du contrat. Si la date limite est dépassée, le consommateur peut dénoncer le contrat par lettre recommandée avec avis de réception4. La particularité de la responsabilité qui pèse sur le professionnel est liée à l’élargissement de cette responsabilité aux tiers qui ont exécutés les obligations contractuelles pour son compte.
Cette responsabilité contractuelle se justifie par le fait que dès la conclusion du contrat, le professionnel est tenu de donner au consommateur des informations sur le processus de livraison sans quoi le contrat peut être frappé de nullité5.
En droit français, l’obligation d’information préalable sur les conditions de livraison est aussi mise à la charge du professionnel. Il en de même de la pleine responsabilité6. Ces dispositions ont été adoptées afin de donner confiance au consommateur qui doit entièrement se fier au professionnel bien qu’il n’y ait pas de contact physique7. La responsabilité de plein droit instaurée par le législateur à la charge du professionnel exerçant son activité par voie électronique revient donc à faire peser sur ce dernier une obligation de résultat. Le débiteur d’une obligation de résultat est placé dans la même situation que le gardien d’une chose, dès lors que le résultat prévu au contrat n’est pas atteint, il est responsable directement. L’instauration de cette obligation ne devrait pas étonner s’agissant de prestations simples et ne présentant pas d’aléas (livraison de marchandises ou fourniture de services qui ne consistent pas en des prestations intellectuelles) ; la jurisprudence avait déjà imposé des obligations de résultat. En effet, il appartient au vendeur de faire délivrer la chose convenue dans la quantité et qualité prévue et à la date précisée, sans qu’il puisse être soutenu que ce sont des obligations de moyens8. Même si la responsabilité du professionnel en matière de livraison est une responsabilité de plein droit, il peut dans certaines circonstances évoquer la limitation de responsabilité.
B- Les cas d’exonération
« L’opérateur exerçant une activité de commerce électronique est tenu à une obligation de résultat. Sa responsabilité de plein droit ne saurait s’écarter en démontrant l’absence de sa faute, ou celle du prestataire de services »9. Plusieurs cas peuvent être à la base de l’inexécution par le professionnel de son obligation de livraison.
Il s’agit généralement des situations qui sont indépendantes de sa volonté. Ainsi, le professionnel peut évoquer le régime de limitation de responsabilité dans trois (03) cas. D’abord, lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au consommateur. Ensuite, lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à un tiers. Enfin, lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est liée à un cas de force majeure10. Le professionnel peut donc se voir dédouaner de son obligation liée à la bonne exécution du contrat dans l’un des cas ci-dessus évoqués. La limitation de responsabilité dont bénéficie le professionnel permet à ce dernier d’être à l’abri d’éventuelles poursuites que le consommateur pourrait tenter contre lui.
De même, le professionnel ne peut se voir condamner à aucun paiement de dommages-intérêts lié à l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. Cependant, le bénéfice d’une telle limitation de responsabilité ne s’aurait être revendiqué par le professionnel sans que ce dernier ne rapporte les éléments de preuves attestant que l’inexécution ou la mauvaise exécution de la livraison n’est pas de sa faute.
En droit français, le régime de la limitation de responsabilité est consacré par les dispositions de l’article 15 alinéa 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il ressort desdites dispositions que seule la preuve d’une faute de la victime, du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, ou d’un cas de force majeure permet une exonération de responsabilité.
Du moment que la qualité du tiers ne pourra pas être reconnue aux prestataires de services, les hypothèses d’une telle exonération demeurent toutefois marginales en l’absence de la faute de la victime. Il en résulte donc qu’aucune limitation de responsabilité ne peut être tolérée11. Cependant, il paraît bien confortable de considérer cette responsabilité de plein droit comme une source de protection pour un cyberconsommateur vis-à-vis du professionnel opérant sur internet, mais il serait plus compliqué de la concevoir pour les non-professionnels12.
Il convient de souligner que la Cour de cassation, a rendu un arrêt le 29 juin 201013 rétablissant la validité des clauses limitatives de responsabilité tout en encadrant leur régime. La cour a affirmé que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».
Le régime de la livraison tel que consacré ne protège pas assez le consommateur. Pour permettre donc au consommateur d’avoir une confiance certaine à la transaction électronique dans laquelle il s’engage, un tel régime mérite d’être renforcé.
________________________
1 GESLAK (V.), op. cit., p. 94. ↑
2 V. l’al 1er de l’art 356 du C. num. ↑
3 Il est important de ne pas confondre la délivrance et la livraison. Selon L’art 1604 du Code Civil « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Ce texte donne une définition générale de la délivrance. La délivrance est un acte matériel : le vendeur va se dessaisir de la chose. La délivrance ne signifie pas que la chose doive être acheminée jusque chez l’acheteur. Il convient seulement de la mettre à disposition. C’est à l’acheteur de retirer la chose, et donc de prendre le soin de la faire enlever ou transporter si nécessaire. ↑
4 Ibid. pp. 95 et 96. ↑
5 L’art 338 du même code précise que « Sous peine de nullité, tout fournisseur de biens ou services en ligne doit, avant la conclusion de tout contrat en ligne, assurer et maintenir un accès facile, direct et permanent sur support durable, aux conditions contractuelles ainsi qu’à toutes informations relatives à la conclusion du contrat. La mise à disposition des conditions contractuelles doit permettre leur reproduction et leur conservation par les parties. Ces informations doivent être présentées de façon claire, lisible et non-équivoque et comprennent notamment : …les conditions de livraison et frais de livraison ; 12- la date à laquelle le fournisseur s’engage à livrer les biens ou à fournir les services ; 13- les conséquences d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution des obligations du fournisseur ; 14- les modalités prévues par le fournisseur pour le traitement des réclamations ; 15- le numéro de téléphone, ainsi que l’adresse électronique et postale du fournisseur en vue d’éventuelles réclamations ; 16- le cas échéant, les informations relatives aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours auxquelles le fournisseur est soumis, et les conditions d’accès à celles-ci… ». ↑
6 V. l’article L121-20-3 alinéas 1er et 4 du code de la consommation français. Allant dans le même sens que le législateur, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2003, à propos de certains contrats proposés par la société « Père Noël.fr » a été amené à se prononcer sur la clause suivante : « Un délai de livraison est indiqué pour chaque produit dans le catalogue électronique. Pour les produits peu encombrants, la livraison intervient en principe dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de l’acceptation de l’offre par l’acheteur et au plus tard dans les 30 jours … Ce délai précisé pour chaque produit n’est qu’indicatif, et le vendeur ne peut être tenu pour responsable en cas de dépassement de ce délai. En Particulier, le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune annulation de la commande, à aucune réduction de prix payé par l’acheteur et à aucun versement au titre de dommages intérêts dès lors que le client est livré dans les 30 jours suivants la confirmation de sa commande » (TGI Paris 4 février 2003, D 2003 p.762 Obs. MANARA (C.). La réponse du Tribunal est dénuée de toute ambiguïté. Ainsi le jugement énonce que « l’association demanderesse fait valoir à juste titre que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle supprime le droit à réparation du consommateur et permet à cette société de déterminer unilatéralement, après la conclusion du contrat, la date de livraison. A la demande de l’association UFC-Que choisir, le Tribunal de Grande instance de Bordeaux rend une décision favorable aux consommateurs à l’encontre du e-commerçant « CDISCOUNT ». En effet plus d’une dizaine de clauses proposées par la société CDISCOUNT ont été reconnues comme abusives et illicites par le juge. Certaines d’entre elles concernent les modalités de livraison, on retrouvait dans les conditions générales de vente ces clauses : « mentionne que les délais de livraison sont des délais moyens », « limite le droit d’annulation de la commande à un défaut de livraison », « prévoit que le droit de retour est conditionné par une autorisation du service client », « restreint le droit de rétractation et de retour si l’emballage d’origine est endommagé », « exclut du droit de rétractation et de retour les produits déstockés », « impose au consommateur des diligences précises à l’égard du transporteur en cas de livraison défectueuse », « exonère le professionnel de ses obligations en cas de grève des services postaux, de transporteurs et de catastrophes causées par inondations ou incendies ». L’ensemble de ces clauses doivent être supprimées des conditions générales de vente. In GESLAK (V.), op. cit., pp.97 et 98. ↑
7 GRYNBAUM (L.), LE GOFFIC (C.), MORLET-HAIDARA (L.), op.cit., p. 196. ↑
8 Ibid. p. 197. ↑
9 EDDEROUASSI (M.), op. cit., p. 392. ↑
10 Il faut entendre ici par force majeure « tout événement imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d’exécuter son obligation » Cf. Lexique des termes juridiques 24ème éd 2016-2017, D., p. 514. V. l’art 329 al 2 du C. num. ↑
11 Ibid. pp. 95 et 96. ↑
12 GRYNBAUM (L.), LE GOFFIC (C.), MORLET-HAIDARA (L.), op.cit., p. 196. ↑
13 Cour de cassation, arrêt du 29 juin 2010. ↑