Les applications pratiques en géographie révèlent comment les enseignants ivoiriens construisent le concept d’espace urbain face aux tensions entre directives officielles et pratiques pédagogiques. Découvrez comment cette analyse peut transformer votre approche de l’enseignement de la géographie et enrichir la compréhension des élèves.
CHAPITRE 2 : LE CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE
Cette recherche s’intéresse aux pratiques enseignantes en classe de géographie. Pour analyser les pratiques enseignantes, Robert et Rogalski cité par Choquet(2021, p. 2) proposent la prise en compte de cinq composantes importantes :
- « les composantes sociale et institutionnelle permettent de définir les contraintes liées à la profession ;
- la composante personnelle renseigne sur les propres représentations de l’enseignant sur la tâche qu’il a à accomplir, sur, par exemple, l’enseignement des mathématiques ou les mathématiques en général ;
- la composante médiative concerne l’ensemble des choix de l’enseignant faits avant la séance concernant les contenus, les progressions à adopter, le déroulement à prévoir ;
- la composante cognitive s’intéresse aux choix faits pendant la séance pour orienter le travail des élèves et faire avancer cette séance vers un objectif d’apprentissage. »
Leurs propositions, explicites, rejoint celle de Paun. Il résume ces propositions en deux aspects. En effet, l’étude des pratiques enseignantes requiert la prise en compte de deux aspects importants auxquels sont confrontés les enseignants au quotidien dans leur classe. Il s’agit de la gestion de la classe et la gestion du curriculum (Paun, 2006).
Pour Paun, la gestion de la classe s’entend par la discipline des élèves. Et quant à la gestion du curriculum, elle part de la construction du savoir scientifique aux connaissances acquises par l’élève. Cette dernière s’inscrit dans le cadre théorique de la transposition didactique. Mais l’enseignant doit se référer à une approche pédagogique pour conduire les élèves à l’apprentissage.
Ce chapitre vise à présenter d’une part les cadres théoriques de cette recherche et d’autre part la méthodologie.
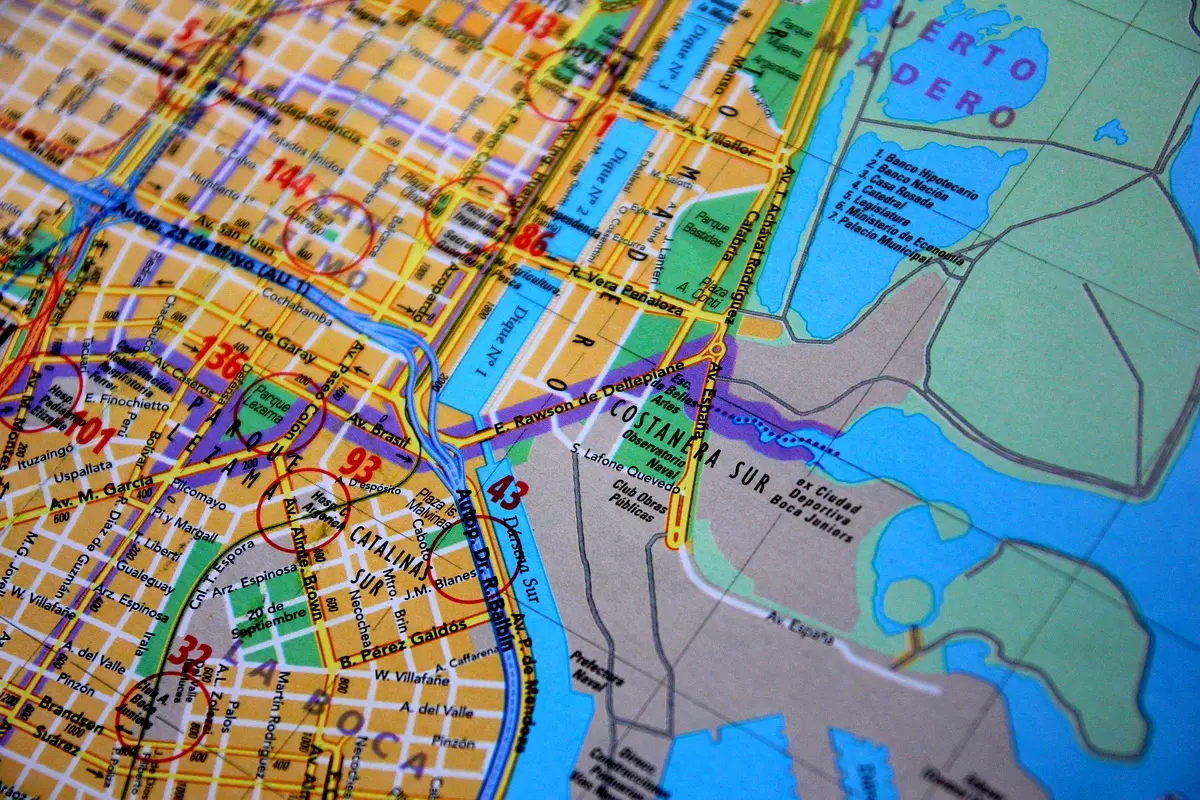
Le cadre théorique
1.1- La transposition didactique
Le concept de transposition didactique, utilisée dans de nombreux travaux de recherche en didactique, est évoqué pour la première fois par le sociologue Michel Verret en 1975 dans son ouvrage intitulé le temps des études. Pour Verret, toute action humaine, au-delà de l’école, qui vise la transmission d’un savoir, doit d’abord les transformer en vue de les rendre enseignables et faciliter leur apprentissage (Perrenoud, 2007). Ce concept est repris dans les travaux en didactique des mathématiques par Yves Chevallard en 1985. Ce concept a émergé après les interrogations suscitées par l’apparition régulière des nouveaux savoirs dans l’enseignement des mathématiques.
Chevallard s’interroge sur l’origine et le processus d’intégration de ces savoirs. Le titre de son ouvrage répond succinctement à cette interrogation à travers son intitulé « du savoir savant au savoir enseigné »(Chevallard, 1991, p. 1). Pour Chevallard (1991, p. 39), la transposition didactique désigne « le travail qui d’un objet de savoir à enseigner, fait un objet d’enseignement ». En effet, pour ce dernier, « un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner subit…un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à prendre place parmi les objets d’enseignements » (Chevallard, 1991, p. 39).
Les savoirs scientifiques issus des recherches ne peuvent être enseignés directement dans un cadre scolaire. Ils doivent subir des transformations avant de devenir des savoirs enseignables et d’être intégré dans un cadre scolaire. Il existe deux niveaux de transposition didactique : un premier qui part des savoirs savants aux savoirs à enseigner dénommé la transposition didactique externe et un second, la transposition didactique interne qui part des savoirs à enseigner aux savoirs enseignés (Develay, 1992).
La transposition didactique externe « représente le processus de transformation, d’interprétation et de ré-élaboration didactique du savoir scientifique constitué dans de différents domaines de connaissance » (Paun, 2006, p. 4). La transposition didactique externe est la première transformation que subissent les savoirs savants pour devenir des savoirs à enseigner. Ces savoirs à enseigner présentent les caractéristiques distinctes des savoirs savants dont ils sont issus. Pour Verret, cité par Bronckart et Plazaola Giger (1998, p. 36), ce savoir didactisé se caractérise par :
« – la désyncrétisation, c’est-à-dire le découpage des savoirs émanant de la « pratique théorique » en « champs de savoirs délimités, donnant lieu à des pratiques d’apprentissages spécialisées » ;
- la dépersonnalisation, c’est-à-dire « la séparation du savoir et de la personne »;
- la programmabilité, ou organisation des savoirs en « séquences raisonnées permettant une acquisition progressive ».
-la publicité du savoir à transmettre, c’est-à-dire par sa « définition explicite, en compréhension et en extension », et elle requiert d’autre part un processus de contrôle social des apprentissages. »
Le résultat de ces transformations est contenu dans les programmes, les manuels, les textes officiels et les guides d’exécution des programmes. Cette première réélaboration est le fait de la « noosphère » constituée par les universitaires, les acteurs divers intervenants dans la construction des programmes scolaires. Ces savoirs constituent le curriculum formel ou prescrit. Cette sélection des contenus à enseigner est appelée la transposition curriculaire externe. C’est une sélection rigoureuse qui tient compte des finalités assignées au domaine concerné et au niveau cognitif des élèves.
Astolfi citant les travaux de Yves Chevallard et Marie-Alberte Johsua, des didacticiens de mathématiques, définit cinq (5) règles de la transposition didactique dans l’enseignement des mathématiques, dont deux essentielles dans le cadre de notre recherche.
La première est relative à la modernisation nécessaire du savoir scolaire. En effet, « dans différentes disciplines, il apparait, périodiquement nécessaire, aux spécialistes de mettre à jour les contenus d’enseignement pour les rapprocher de l’état des connaissances universitaires. Il se crée, fréquemment dans ces cas, des commissions qui prennent pour base de travail divers travaux et propositions antérieures diffusées dans la noosphère » (Astolfi et al., 2008, p. 182). Il affirme qu’il faut un regard constant et une collaboration entre la science de référence et la discipline scolaire en vue de tenir compte des évolutions des savoirs savants dans la construction des savoirs à enseigner.
En plus de la modernisation des savoirs, la seconde règle est relative à la nécessité d’un renouvellement curriculaire de la discipline scolaire. Cette règle permet d’éviter d’éloigner le savoir scolaire du savoir savant posant un problème de légitimité de ce savoir scolaire. Elle permet également de garder une distance entre le savoir scolaire et les savoirs du sens communs (Astolfi et al., 2008).
Doba souscrit à la proposition de Astolfi, et constate que la construction du curriculum de géographie en Côte d’Ivoire est influencée par de nombreux partenaires nationaux et des institutions internationales.
Son travail a porté sur la diffusion des savoirs de la géographie des risques dans l’enseignement secondaire ivoirien. Il soutient que les choix des savoirs à enseigner contenus dans les documents officiels, les programmes scolaires et les guides d’exécution des programmes éducatifs sont faits par une commission constituée d’enseignants chercheurs de l’ENS et d’inspecteurs généraux de l’éducation nationale.
De ces entretiens avec les différents acteurs intervenant dans la chaine curriculaire ivoirienne, il révèle une faible collaboration entre l’enseignement supérieur et l’enseignement scolaire. Il a démontré que la présence d’un concept dans les curricula, notamment le concept des risques, était marginal, surtout à cause du paradigme disciplinaire dominant de la géographie ivoirienne, mais aussi du fonctionnement en vase clos de ces deux institutions.
Ce qui a une incidence sur les savoirs scolaires à enseigner en géographie qui sont obsolètes (Doba, 2021). Par ailleurs, le curriculum prescrit ou formel est présenté comme une norme et influence fortement les savoirs enseignés (Paun, 2006).
Dans l’enseignement du français, par exemple Dolz et al. (2006, p. 144) ont remarqué que « le curriculum recommandé est organisé sous forme de prescriptions qui sont souvent dans un rapport complexe avec le curriculum enseigné. Les travaux sur ce dernier ont généralement une vision descendante qui va du curriculum officiel (plans d’études) au curriculum acquis (évaluations des apprenants) ». Dans sa thèse sur l’enseignement des EDD en classe de géographie, Oussou n’hésite pas à pointer ce premier niveau institutionnel de construction des programmes qui peinent à prendre en compte des problématiques actuelles et importantes de la géographie.
Cette posture beaucoup plus dirigiste des programmes entraine une rupture entre les textes officiels et les pratiques enseignantes (Oussou, 2022). La transposition didactique externe est un concept important dans le cadre de notre recherche, car il permet de questionner la nature et le sens des concepts géographiques présents dans le curriculum prescrit, mais également les modalités d’intégrations des concepts géographiques.
En outre, ce concept permettra de comprendre les fonctions assignées à la géographie scolaire à travers les concepts géographiques présents dans les programmes.
La transposition didactique interne est le second niveau de la transposition didactique. Selon Paun (2006, p. 7) « elle représente l’ensemble des transformations successives et négociées subies par le curriculum formel dans le cadre du processus d’enseignement et d’apprentissage, tout au long du parcours professeur-élève ». La transposition didactique interne se déroule dans la classe.
C’est le passage du savoir à enseigner au savoir enseigné. C’est une réappropriation du curriculum formel par l’enseignant. La transposition didactique interne selon Hertig (2012, p. 25) est un « processus …pour l’essentiel sous le contrôle de l’enseignant ». Antibi André et Guy Brousseau donnent plus de précision sur la place de l’enseignant dans ce processus.
À cet effet, ils soulignent qu’« une institution, dite “enseignante”, se voit confier le projet de modifier l’univers culturel d’une autre institution, dite “élève”, jugée hors d’état d’effectuer cette modification motu proprio, et qui, le plus souvent, ne ressent a priori aucun besoin ni aucune raison spécifique de cette modification » (Antibi & Brousseau, 2002, p. 48).
Le résultat de cette réappropriation du curriculum prescrit par l’enseignant se décline en deux curricula : le curriculum enseigné ou réel et le curriculum réalisé ou appris (Chevallard, 1991). Philippe Perrenoud dans un article dévoile la part de subjectivité du professeur dans l’interprétation du curriculum prescrit. Il décrit de nombreux facteurs susceptibles d’influencer les contenus d’enseignements (Perrenoud, 1993).
Paun abonde dans le même sens. Pour ce dernier, cette interprétation du curriculum par le professeur se réalise sous de nombreuses contraintes :
« telles que sa formation initiale, son habitus professionnel, son rapport personnel et spécifique avec la science et la culture scolaire, les sens et les significations qu’il confère aux finalités de l’éducation (la définition qu’il donne de celles-ci), ses représentations à l’égard des élèves, en général, et à l’égard de ceux avec lesquels il travaille, en particulier, les opinions de ses collègues de la salle des professeurs et non seulement, sa propre vision concernant le parcours scolaire des élèves, leurs préférences et leurs résistances » (Paun, 2006, p. 8)
Le curriculum enseigné devient ainsi un outil de différenciation des pratiques enseignantes puisque c’est une réélaboration personnelle du curriculum prescrit. Ce concept est important pour notre recherche, car il permettra de distinguer les pratiques enseignantes qui sont à même de donner du sens aux savoirs et de susciter une appropriation des concepts géographiques par les élèves.
Le curriculum réalisé désigne les connaissances acquises par l’élève dans un processus d’enseignement apprentissage. C’est « le résultat des réinterprétations et des négociations que celui-ci développe au cours de son interaction avec le professeur »(Paun, 2006, p. 9). Il révèle le niveau d’appropriation d’un objet d’enseignement réélaboré en connaissances par un élève.
Il permet au professeur de réinterroger ces pratiques. Guy Brousseau cité par Astolfi et al. (2008) ne nie pas les avantages de la transposition didactique, mais insiste également pour une mise sous surveillance de la transposition didactique. En effet, il importe de faire attention aux transformations épistémologiques que peuvent subir le savoir au cours du processus de transposition didactique.
Gibert Arsac cité par Astolfi et al. (2008) avance même l’idée d’une rupture épistémologique entre le savoir savant et le savoir scolaire. Ainsi, il précise que « l’étude de la transposition amène à exercer une vigilance épistémologique, c’est-à-dire à examiner si la distance, la déformation, entre l’objet de savoir et l’objet d’enseignement n’est pas telle qu’il ne reste en commun qu’une nomenclature et, dans le pire des cas, un langage pseudo-savant. On pourra parler dans les cas extrêmes de rupture épistémologique ; il conviendra de s’interroger sur les motifs de ces ruptures » Gilbert Arsac cité par Astolfi et al.(2008, p. 181). Cette citation permet de questionner, dans le cadre de cette recherche, le sens que les enseignants et les élèves donnent aux concepts dans la géographie scolaire ivoirienne.
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les composantes importantes à prendre en compte dans l’analyse des pratiques enseignantes en géographie?
Les composantes importantes à prendre en compte sont la composante sociale et institutionnelle, la composante personnelle, la composante médiative, et la composante cognitive.
Qu’est-ce que la transposition didactique en géographie?
La transposition didactique désigne le travail qui d’un objet de savoir à enseigner, fait un objet d’enseignement, impliquant des transformations adaptatives pour rendre le savoir apte à être enseigné.
Comment les enseignants gèrent-ils le curriculum en classe de géographie?
La gestion du curriculum part de la construction du savoir scientifique aux connaissances acquises par l’élève, et nécessite une approche pédagogique pour conduire les élèves à l’apprentissage.