Les applications pratiques de l’analyse du discours révèlent comment les stratégies discursives du ministre algérien des affaires étrangères influencent l’auditoire. Découvrez les implicites et les enjeux politiques cachés derrière ses déclarations lors d’un entretien sur France 24 et RFI.
2.4.2. Les actes de langage indirects :
Les actes de langage indirects sont liés à un implicite sémantique ou pragmatique du discours et on distingue deux types : les présupposés et les sous-entendus. Notre corpus est composé de plusieurs actes de langage indirects, pour cette raison, on donne une définition exhaustive de cette notion pour pouvoir l’utiliser dans la partie pratique.
Contenu
Explicite
(Ce qui est dit)
Implicite
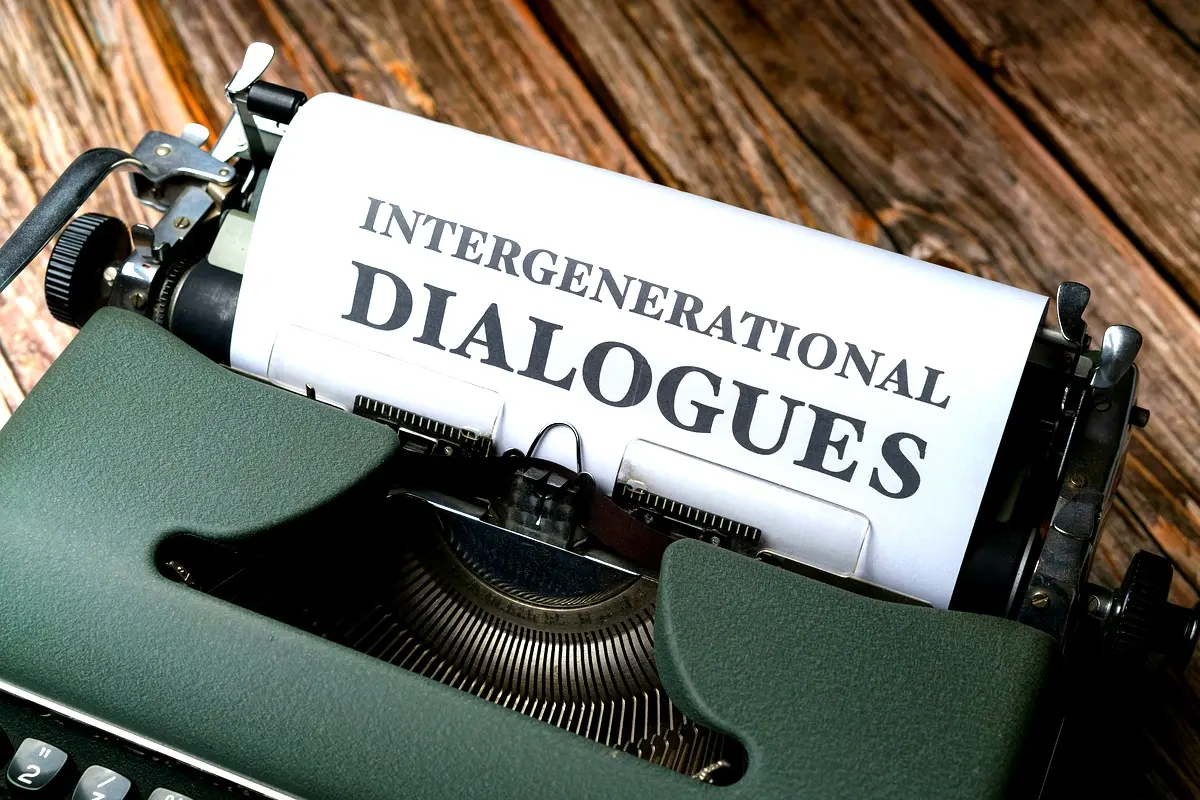
(Ce qui est inféré/impliqué)
Présupposé
Sous-entendu
Allusion
Insinuation
Le contenu d’un énoncé peut être explicite ; le sens est exprimé directement par ce qui est dit, comme il peut être implicite ; l’énoncé contient un message indirect ce qui nécessite une analyse sémantique des éléments linguistiques pour trouver le présupposé inféré dans l’énoncé ou alors se servir des compétences encyclopédiques afin de tirer le sous-entendu impliqué par l’énoncé.
A / Le présupposé :
Le présupposé est, en fait, un implicite sémantique qui existe dans l’énoncé même et dépend de la construction de la phrase et l’ordre d’emplacement des signes linguistiques, selon Catherine Kerbrat-Orecchioni, un présupposé se définit comme « une information qui, sans constituer l’objet du message à transmettre, est toutefois automatiquement entraînée par sa formulation ».
(C. Kerbrat-Orecchioni, 1998 : 25)
En linguistique, la présupposition est une information implicite dans un énoncé qui renvoie directement à un sens qu’on peut soustraire d’une compréhension de cet énoncé lorsqu’on tient cette information pour acquise.
Le linguiste Oswald Ducrot définit l’information première qu’on trouve dans l’énoncé comme le « posé » c’est sur laquelle on peut tirer une autre information qui ne figure pas dans l’énoncé mais on peut l’imaginer d’après notre propre réflexion qui est appelée le « présupposé » c’est une inférence logique qu’on peut extraire de notre compréhension du sens lié au « posé ».
Francis Corblin a défini la présupposition comme suit :
« Une présupposition est un jugement qui est véhiculé par l’énonciation d’une phrase. Cependant, on peut, à bon droit, dire que ce jugement n’appartient pas à ce que le locuteur a dit(ou a dit explicitement) en prononçant la phrase ». (F. Corblin, 2013 : 35)
C’est-à-dire ; Présupposer une information B après avoir reçu autant que allocutaire d’un discours une information A est considéré comme un acte de jugement qu’on compose personnellement à notre niveau et qui résulte de notre propre analyse logique de cet énoncé qu’on fait tout le temps sans prendre conscience dans chacune de nos interactions.
Toutefois, quelques techniques de langue comme l’emploi des temps des verbes modifient le jugement, par exemple : si on remplace le subjonctif par l’indicatif ou on modifie la forme des phrases comme si on remplace la forme affirmative par la forme interrogative. La valeur de l’information dans un énoncé change avec le moindre détail.
B/ Le sous-entendu :
Le sous-entendu est un implicite véhiculé non pas par le sens d’un énoncé mais plutôt par le contexte de l’émission de celui-ci, pour dégager une information B d’une autre information A tirée d’un énoncé donné, il est indispensable de se référer aux éléments contextuels et extralinguistiques et des compétences culturelles et encyclopédiques.
Pour assimiler un sous-entendu, l’allocutaire doit lier l’énoncé reçu au contexte dans lequel il a été émis pour saisir les insinuations et les allusions possibles.
Il y a deux types de sous-entendu : l’insinuation et l’allusion.
B.1. l’insinuation :
C’est une idée, un sens véhiculé dans un énoncé sans être dit clairement et explicitement, le locuteur laisse et pousse l’interlocuteur ou son auditoire à l’entendre sans le dire surtout lorsqu’il s’agit d’un sous-entendu à caractère hostile.
Pour être expliquée, l’insinuation a besoin, également au sous-entendu, de compétences culturelles et encyclopédiques,
B.2. L’allusion :
C’est le fait d’évoquer des individus, des événements, des concepts ou autres, qui sont supposés connus, mais sans les nommer directement et explicitement.
2.5. L’évolution de la théorie des actes de langage
Approfondie par Jean Roger Searle, un philosophe américain spécialiste de la philosophie du langage ainsi que la philosophie de l’esprit, qui s’est intéressé uniquement à l’acte illocutoire, la théorie de la force illocutoire met de l’ordre dans le domaine d’analyses des actes de langage, aborde l’énoncé par principe d’exprimabilité, un contenu propositionnel peut avoir plusieurs sens et différents buts illocutoires, le locuteur produit un énoncé porteur de deux notions : l’intention et la convention.
Un énoncé porte l’un des buts illocutoire. On peut distinguer entre eux par au moins trois indices : le but de l’acte, la direction d’ajustement et l’état psychologique ou condition de la sincérité.
Le but illocutoire porte la capacité d’agir (la force illocutoire) du contenu propositionnel, l’intention du locuteur qu’elle soit explicite ou implicite est dévoilée à travers cet outil analytique qui précise le sens de l’énoncé, il fait recours aux éléments linguistiques employés pour dégager la signification, l’interprétation du discours et la visée énonciative pour expliciter l’énoncé sémantiquement en ayant des compétences linguistiques ou parfois encyclopédiques afin de décoder son but : déclarer, informer, exprimer, conseiller, ordonner, comparer, menacer, …
Jean Roger Searle avait une autre vision pour analyser les énoncés, il a revu et développé la théorie d’Austin et s’est intéressé seulement aux actes illocutionnaires dont il relève le marqueur de force illocutoire et le marqueur de contenu propositionnel et les classer selon la fonction de l’acte illocutoire en cinq catégories proposées dans son œuvre « sens et expression » : les assertifs, les directifs, les déclaratifs, les promissifs et les expressifs. Cette classification est nommée la taxinomie des actes de langage qui sera défini pour être utilisée dans l’analyse de quelques énoncés sélectionnés du corpus.
- La taxinomie des actes de langage
- les assertifs qui ont la fonction d’affirmer, de constater ou de décrire quelque chose de l’environnement.
Le but illocutoire correspond aux confirmations ou aux présentations.
Le locuteur ajuste son énoncé au monde, l’énoncé est soumis à l’impact du contexte sur le langage.
- les directifs qui ont pour fonction d’ordonner, conseiller ou demander à l’interlocuteur d’effectuer une action. Dans ce cas, c’est le monde qui s’ajuste aux mots. Le locuteur exprime un désir ou un souhait.
3. Les déclaratifs afin de décréter ou ouvrir une séance, déclarer un événement,… qui ont la fonction d’apporter un changement sur l’état d’une personne ou du monde.
Le but illocutoire est de réaliser quelque chose par le biais de l’énonciation.
Dans ce cas, la direction d’ajustement est doublée : les mots s’ajustent au monde et le monde se conforme aux mots.
Les conditions de sincérité reposent sur les conditions de félicité.
4. les promissifs qui servent à promettre, inviter, offrir ou garantir, qui ont pour but de prêter à s’engager dans une action pour satisfaire les attentes de l’interlocuteur.
Les conditions de sincérité s’appuient sur l’intention du locuteur de réaliser ses dires.
5. les expressifs qui ont la fonction de féliciter ou remercier, mais aussi pour indiquer certaine information sur soi-même comme le regret, la plainte,…
La direction d’ajustement est vide et les conditions de sincérité s’appuient sur les sentiments du locuteur.
- Les actes de langage indirects selon Searle
Quand un énoncé accompli un acte qui contient une forme liée à un autre type d’acte différent de celui qu’on peut dégager directement de l’énoncé d’une façon conventionnelle, par exemple :
- Ouvre la porte !
La volonté de l’énonciateur est nettement indiquée à travers cette phrase à l’impératif pour exprimer un ordre.
- Peux-tu ouvrir la porte du garage s’il te plait ? Je compte sortir ma voiture.
Dans ce cas, le locuteur pose une question puis complète par une phrase à la forme déclarative pour produire le même acte de langage.
Searle s’est inspiré des travaux de Grice et il a utilisé les principes explicatifs identiques, de plus il s’est focalisé sur les relations qui existent entre la manière d’accomplir un acte indirect et les conditions de satisfaction. Par exemple : veux-tu bien m’aider ?
L’interlocuteur infère que son locuteur réalise un acte locutoire que le sens relève des unités linguistique utilisées dans l’énoncé. Ensuite, il définit l’acte illocutoire en prenant en considération la situation d’énonciation. Et enfin, si l’acte en question transgresse une règle de conversation, il en déduit un autre acte indirect qui est exprimé implicitement.
Pour déterminer le sens d’un énoncé, l’interlocuteur effectue une interprétation de l’énoncé reçu en essayant d’inférer l’intention du locuteur à travers les indices relationnels et spatio-temporels de l’énonciation. Toute faille dans cette opération de détermination du sens engendre un malentendu, un échec de la communication. L’interprétation de l’énoncé se réalise d’une manière conventionnelle, Searle a distingué entre deux types d’actes de langage :
- Les actes de langage directs ou primitifs : ce qu’on interprète à partir de la signification directe de l’énoncé. Le marqueur de force illocutoire indique le vrai but de l’acte de langage.
- Les actes de langage indirects ou dérivés : celui qui nécessite l’intervention d’un processus de dérivation illocutoire pour être réalisé. le marqueur de force illocutionnaire indique un but donné, mais que le but illocutionnaire réel est autre que celui indiqué.
- L’explicite et l’implicite
Chaque énoncé contient un sens véhiculé par les signes linguistiques qui le compose qu’il soit clairement exprimé dit explicite ou dans le cas contraire, le sens n’est pas exprimé donc implicite.
2.6.1. L’explicite :
C’est tout énoncé qui exprime clairement et complétement l’information qu’il porte, sans avoir à interpréter ou à chercher le sens ou à relever l’ambigüité. Le sens est inclus dans les mots significatifs de l’énoncé. Selon la définition du Larousse français : « qui est énoncé complètement et ne peut prêter à aucune contestation ». On peut juger qu’un énoncé est explicite lorsque l’énonciateur déclare d’une manière nette et précise ce qu’il pense.
2.6.2. L’implicite :
C’est le non-dit dans l’énoncé, que l’on doit comprendre de l’énoncé sans qu’il soit franchement dit. La définition de l’implicite dans le dictionnaire Robert est « ce qui est virtuellement contenu dans une proposition, un fait, sans être formellement exprimé, et peut en être tiré par déduction, induction. Synonyme : Tacite ; antonyme : explicite, exprès, formel ».
La linguiste Catherine Kerbrat-Orrecchioni a consacré toute une œuvre pour traiter cette notion en détail, intitulée : l’implicite, « les contenus implicites ont […] la propriété de ne pas constituer en principe le véritable objet du dire ».
Il y a deux types d’implicite ; l’implicite sémantique et l’implicite pragmatique :
A/ l’implicite sémantique est une information cachée, inexprimée qui possède des éléments linguistiques présents dans l’énoncé pour pouvoir le décoder. Ce type d’implicite est attaché au matériel linguistique.
B/ L’implicite pragmatique est par contre une information dont on a aucun élément linguistique qui peut l’indiquer à partir de l’énoncé mais en faisant usage à des éléments extralinguistiques afin de dégager le sens et comprendre l’implicite qui est adhéré au contexte et à la situation d’énonciation.
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce qu’un acte de langage indirect dans le discours politique ?
Les actes de langage indirects sont liés à un implicite sémantique ou pragmatique du discours et se distinguent en présupposés et sous-entendus.
Comment définir un présupposé dans l’analyse du discours ?
Le présupposé est une information implicite dans un énoncé qui renvoie à un sens qu’on peut soustraire d’une compréhension de cet énoncé lorsqu’on tient cette information pour acquise.
Quelle est la différence entre un sous-entendu et un présupposé ?
Le sous-entendu est un implicite véhiculé par le contexte de l’émission de l’énoncé, tandis que le présupposé est une information implicite qui existe dans l’énoncé même.