L’administration de la preuve fiscale révèle des déséquilibres significatifs dans la répartition de la charge de la preuve entre l’administration fiscale et les contribuables. Cet article analyse les présomptions légales et les moyens dont dispose l’administration pour prouver, malgré l’absence de responsabilités légales claires.
DEUXIEME PARTIE : LE DESEQUILIBRE AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
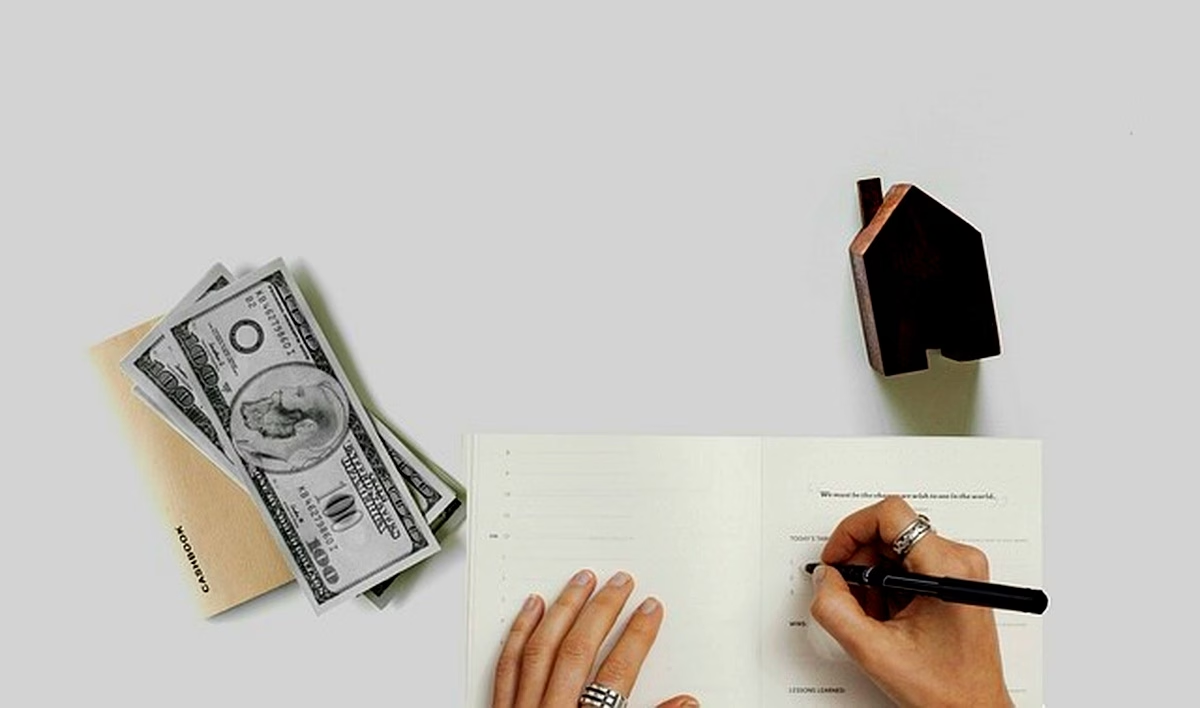
Le législateur tunisien, malgré son silence sur la charge de la preuve incombant à l’administration fiscale1, a pris soin de doter cette dernière de moyens énergiques qui lui facilitent l’administration de la preuve.
Il y a là un véritable paradoxe : l’administration fiscale qui, de par la loi, n’est pas tenue de prouver ; peut prouver. En revanche, le contribuable qui, de par la loi, doit prouver ; n’est pas toujours en mesure de le faire, dès lors que celui-ci ne dispose pas de moyens efficaces, comparables à ceux que possède l’administration, pour prouver que cette dernière a fait une évaluation exagérée de ses bases d’impositions. Ainsi, le contribuable « se sent en nette infériorité, face aux rouages d’une administration bien rodée à la bataille qu’elle est entrain de lui livrer »2.
En matière d’administration de la preuve, le déséquilibre entre les deux parties est criant. A une prépondérance de l’administration fiscale (CHAPITRE I) correspond une précarité de la situation du contribuable (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LA PREPONDERANCE DU FISC DANS L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Le droit fiscal, plus que tout autre droit, illustre dans certains de ses aspects la permanence et la rigueur des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas en matière de preuve. Ce droit a pu apparaître comme le serviteur quasi-exclusif des intérêts du fisc3.
Dans le dialogue avec le contribuable, les agents du fisc apparaissent comme trop fortement armés4. Grâce au soutien législatif, l’administration fiscale jouit de pouvoirs exorbitants pour rechercher les éléments de preuve (SECTION I). Bien plus, les présomptions constituent un moyen de preuve privilégié de l’administration fiscale (SECTION II). Ces deux armes favorisent la prépondérance du fisc dans l’administration de la preuve5.
Section I : Les pouvoirs exorbitants de l’administration fiscale dans la recherche des preuves
On doit admettre qu’il est naturel d’attribuer au fisc des pouvoirs importants et c’est une erreur de vouloir dissimuler la véritable essence derrière une collaboration des contribuables qui sera toujours imparfaite et toujours irritante6. Ces pouvoirs exorbitants sont justifiés par la nécessité de lutter contre la fraude fiscale et de saisir une matière imposable qui risque d’être dissimulée.
Mais, en contrepartie, il faut que de réelles garanties soient octroyées aux contribuables, surtout que les pouvoirs d’investigation du fisc sont souvent ressentis comme des atteintes à la liberté individuelle, voire comme des intrusions dans la vie privée.
En droit fiscal, l’administration peut à la fois diligenter elle-même des procédures tendant à rechercher les preuves, exiger du contribuable les preuves qu’elle n’a pu réunir contre lui7. Plusieurs procédures de contrôle exigent du contribuable qu’il fournisse la preuve de la sincérité de ses déclarations alors même que celles-ci ont été régulièrement déposées8.
Les techniques de contrôle9 mises à la disposition de l’administration lui permettent de rechercher les preuves de l’inexactitude de la déclaration du contribuable. Il s’agit de prérogatives exorbitantes10: un droit de communication particulièrement étendu (paragraphe I), un droit de vérification interminable (paragraphe II), une demande de renseignements, d’éclaircissements ou de justifications générale (paragraphe III) et un droit de visite redoutable (paragraphe IV).
Paragraphe I : Un droit de communication particulièrement étendu
Le droit de communication est régi par les articles 7, 8, 9, 16, 17 et 18 du code des droits et des procédures fiscaux11. C’est le droit qui permet à l’administration fiscale d’obtenir, à la fois du contribuable lui-même et des tiers, de façon unilatérale des renseignements utiles en vue de l’établissement de l’impôt12. Il permet à l’administration fiscale d’obtenir des renseignements sur le patrimoine, la situation financière ainsi que l’activité du contribuable auprès d’organismes ou personnes publiques ou privées, sans que ces derniers puissent opposer à l’administration fiscale le secret professionnel13.
Il s’agit d’une prérogative exceptionnelle techniquement nécessaire, permettant à l’administration de réunir les éléments de la preuve qui lui incombe.
Le C.D.P.F., entré en vigueur le 1er janvier 2002, a élargi davantage le droit de communication14. Celui-ci apparaît comme un droit particulièrement étendu quant aux personnes qui y sont soumises. Le droit de communication s’étend aussi bien au contribuable (A) qu’aux tiers (B). Deux principes fondamentaux risquent d’être mis en cause, l’obligation de respecter la vie privée des citoyens et la règle du secret professionnel15.
A- L’exercice du droit de communication à l’égard du contribuable
Le droit de communication à l’égard du contribuable est prévu par les articles 7, 8 et 9 du C.D.P.F.16 : L’article 7 dispose que : « L’administration fiscale peut demander aux personnes physiques, dans le cadre de la vérification de leur situation fiscale, des états détaillés de leur patrimoine et des éléments de leur train de vie visés aux articles 42 et 43 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ».
L’article 8 ajoute que : « Le contribuable doit communiquer, à toute réquisition des agents de l’administration fiscale à ce habilités, ses quittances, documents et factures relatifs au paiement des impôts dont il est redevable ou justifiant l’accomplissement de ses obligations fiscales ».
L’article 9 précise que : « Les personnes soumises à l’obligation de tenir une comptabilité conformément aux dispositions de l’Article 62 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, doivent communiquer aux agents de l’administration fiscale, tous registres, titres et documents, ainsi que les programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l’arrêté de leurs comptes ou pour l’établissement de leurs déclarations fiscales. Les personnes qui tiennent leur comptabilité ou établissent leurs déclarations fiscales par les moyens informatiques, doivent communiquer, aux agents de l’administration fiscale, les informations et éclaircissements nécessaires que ces agents leur requièrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ».
Il y a lieu de préciser que le droit de communication s’exerce sans que l’administration soit obligée de prévenir le contribuable. En effet, la loi n’exige aucune formalité d’information préalable. Ce droit est « unilatéral » et il est limité à un relevé passif des écritures comptables ou la copie des documents sans examen critique de la comptabilité17.
Cette prérogative altère le régime de la preuve en obligeant le contribuable à fournir lui-même les éléments de la démonstration, alors que c’est l’administration, qui supporte la charge de la preuve18.
Le droit de communication à l’égard du contribuable ne peut s’exercer sans risquer de pratiquer, dans certains cas, « une indiscrétion inquisitoriale insupportable »19. Ainsi en est-il de l’obligation mise à la charge des contribuables de communiquer, sur demande de l’administration, « des états détaillés de leur patrimoine et des éléments de leur train de vie »20. N’a-t-on pas affirmé que « vivre, c’est dépenser ; et à son terme, le contrôle des revenus par le train de vie se transforme en une intrusion fiscale de tous les instants de la vie privée des citoyens »21.
________________________
1 Ceci bien entendu mis à part l’article 108 du C.D.P.F. qui concerne le contentieux fiscal pénal. ↑
2 Neila CHAABANE, « Les garanties du contribuable devant le juge fiscal », in actes de colloque sur le contentieux fiscal, faculté des sciences juridiques de Tunis, le 21 et 22 avril 1995, p.3. ↑
3 M.-C. BERGERES, « Le principe des droits de la défense en droit fiscal », thèse précitée, p. I. ↑
4 Marc BALTUS, « Morale fiscale et renversement du fardeau de la preuve », article précité, p. 135. ↑
5 La prépondérance du fisc dans l’administration de la preuve apparaît aussi dans le contentieux fiscal pénal, à travers l’attribution d’une force probante particulière aux procès-verbaux des agents de l’administration fiscale. L’article 71 du C.D.P.F. dispose que : « Les procès-verbaux relatifs aux infractions fiscales pénales sont établis par deux agents assermentés ayant constaté personnellement et directement les faits qui constituent l’infraction, ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire ». Il faut noter que l’attribution d’une force probante particulière aux procès-verbaux de l’administration fiscale, constitue une dérogation au principe général qui interdit de se créer un titre à soi-même. ↑
6 Jean BOULOUIS, « Procès du juge fiscal », R.S.F. 1957, n°4, p.656 et s. ↑
7 Didier DE MONTBRIAL, «La fiscalité, les libertés et l’Etat de droit»,Gaz. Pal. 1985, 2ème sem. p. 655. ↑
8 DE LA MARDIERE Christophe, « La déclaration fiscale », R.F.F.P., 2000, n°71, p.140. ↑
9 Le C.I.R a réglementé le contrôle fiscal dans les articles 63, 64, 65. Mais, les dispositions législatives du C.I.R étaient lacunaires. Le législateur ne s’est tellement pas soucié de prévoir avec précision les règles devant régir le contrôle fiscal. Le C.D.P.F., tout en légalisant les règles régissant le contrôle fiscal qui étaient prévues par la charte et le C.I.R., a apporté certaines modifications par rapport à l’ancienne législation régissant le contrôle fiscal. Il n’a fait que consolider les pouvoirs de l’administration fiscale. ↑
10 Voir sur la question :
ﺔﻴѧﻥﻮﻥﺎﻘﻟا تﺎѧﺱارﺪﻟا ﺰѧآﺮﻣ ﻪѧﻤﻈﻥ « ﺔﻴѧﺋﺎﺒﺠﻟا تاءاﺮѧﺟﻹاو قﻮѧﻘﺤﻟا ﺔѧﻠﺠﻣ » لﻮѧﺣ ﻰﻘﺘѧﻠﻤﺏ ﺖѧﻴﻘﻟأ ةﺮѧﺽﺎﺤﻣ ، »ﺔﻴѧﺋﺎﺒﺠﻟا ةدﺎﻤﻟا ﻲﻓ عﻼѧﻃﻻا ﻖѧﺣ » ،ﺪﻟﺎѧﺥ ﻢѧﺱﺎﻘﻠﺏ
،ﺪﻟﺎѧﺥ ﻢѧﺱﺎﻘﻠ
ﺔﻴѧﺋﺎﺒﺠﻟا ةدﺎﻤﻟا ﻲﻓ عﻼѧﻃﻻا ﻖѧﺣ
لﻮﺣ ﻰﻘﺘﻠﻤﺏ ﺖﻴﻘﻟأ ةﺮﺽﺎﺤﻣ
ﺔﻴﺋﺎﺒﺠﻟا تاءاﺮﺟﻹاو قﻮﻘﺤﻟا ﺔﻠﺠﻣ
«
ﺔﻴﻥﻮﻥﺎﻘﻟا تﺎﺱارﺪﻟا ﺰآﺮﻣ ﻪﻤﻈﻥ
.2000 ﺮﺒﻤﻓﻮﻥ 25و 24 ﺔﺱﻮﺴﺏ ﺎﺒﺣﺮﻣ جﺎﺗ لﺰﻨﺏ ،ﺔﺱﻮﺴﺏ ﺔﻴﺱﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا مﻮﻠﻌﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ﺔﻴﻠآو ﺔﻴﺋﺎﻀﻘﻟاو
ﺔﺱﻮﺴﺏ ﺎﺒﺣﺮﻣ جﺎﺗ لﺰﻨﺏ ،ﺔﺱﻮﺴﺏ ﺔﻴﺱﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻠﻌﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ﺔﻴﻠآو ﺔﻴﺋﺎﻀﻘﻟاو
24
و
25
ﺮﺒﻤﻓﻮﻥ
2000
.94-41 .ص ،2002 سرﺎﻣ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﻀﻘﻟا ﺔﻠﺠﻣ ، »ﺔﻴﺋﺎﺒﺠﻟا ةرادﻹا تﺎﻴﺣﻼﺹ ،ﻲﻠﻓرﻮﻟا ﺪﻤﺣأ-
ةرادﻹا تﺎﻴﺣﻼﺹ ،ﻲﻠﻓرﻮﻟا ﺪﻤﺣأ
ﺔﻴﺋﺎﺒﺠﻟ
سرﺎﻣ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاو ءﺎﻀﻘﻟا ﺔﻠﺠﻣ
2002
ص
.
41
94
11 Avant l’entrée en vigueur du C.D.P.F., le droit de communication était régi par les articles 63 al.1er, 64 al.2 et 65 du C.I.R. ↑
12 C.E. 13 mars 1967, D.F. 1967, n°43, conclusions LAVONDES. ↑
13 Walid GADHOUM, mémoire précité, p. 49. ↑
14 Sofiène GUERMAZI, « Le droit de communication dans le cadre du code des droits et procédures fiscaux », R.C.F. 2001, N° 54. ↑
15 On consultera avec profit :
– Badreddine CHIHI, « Le secret professionnel et le droit de communication du fisc au sens du code des droits et procédures fiscaux », mémoire pour l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit public, faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2000-2001.
– Philippe LUPPI, « Contrôle fiscal et secret professionnel chez les professionnels de santé libéraux : L’exemple des chirurgiens dentistes, R.F.F.P. 1992, n°37, p.47-74.
– Corinne Lepage JESSUA, « L’opposabilité du secret professionnel au fisc : A propos de l’arrêt d’assemblée du 12 mars 1982 », Gaz.Pal. 1983, 1er sem, p.80-85.
– Jean-Pierre BOURS, « La notion de secret dans ses rapports avec le droit fiscal »,in Etudes de fiscalité, réflexions offertes à Paul SIBILLE, Bruxelles, Bruylant 1981, p. 233-252.
– Yves PIMONT, « Le fisc, le contribuable et les tiers », in Mélanges P.-M. GAUDEMET, Economica 1984, p. 637-656.
-Jacques MALHERBE, rapport général sur le Thème « La protection de la confidentialité en matière fiscale », Cahiers de droit fiscal international, volume LXXVIb, p. 21-44. ↑
16 Avant l’entrée en vigueur du C.D.P.F., le droit de communication à l’égard du contribuable était régi par les articles 63 al.1er, 64 al.2 du C.I.R. ↑
17 ﺔﻴﻥﻮﻥﺎﻘﻟا تﺎﺱارﺪﻟا ﺰآﺮﻣ ﻪﻤﻈﻥ « ﺔﻴﺋﺎﺒﺠﻟا تاءاﺮﺟﻹاو قﻮﻘﺤﻟا ﺔﻠﺠﻣ » لﻮﺣ ﻰﻘﺘﻠﻤﺏ ﺖﻴﻘﻟأ ةﺮﺽﺎﺤﻣ ، »ﺔﻴﺋﺎﺒﺠﻟا ةدﺎﻤﻟا ﻲﻓ عﻼѧﻃﻻا ﻖѧﺣ » ،ﺪﻟﺎѧﺥ ﻢѧﺱﺎﻘﻠﺏ
،ﺪﻟﺎѧﺥ ﻢѧﺱﺎﻘﻠ
ﺔﻴѧﺋﺎﺒﺠﻟا ةدﺎﻤﻟا ﻲﻓ عﻼѧﻃﻻا ﻖѧﺣ
لﻮﺣ ﻰﻘﺘﻠﻤﺏ ﺖﻴﻘﻟأ ةﺮﺽﺎﺤﻣ
ﺔﻴﺋﺎﺒﺠﻟا تاءاﺮﺟﻹاو قﻮﻘﺤﻟا ﺔﻠﺠﻣ
«
ﺔﻴﻥﻮﻥﺎﻘﻟا تﺎﺱارﺪﻟا ﺰآﺮﻣ ﻪﻤﻈﻥ
.2 000 ﺮﺒﻤﻓﻮﻥ 25و 24 ﺔﺱﻮﺴﺏ ﺎﺒﺣﺮﻣ جﺎﺗ لﺰﻨﺏ ،ﺔﺱﻮﺴﺏ ﺔﻴﺱﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا مﻮﻠﻌﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ﺔﻴﻠآو ﺔﻴﺋﺎﻀﻘﻟاو
ﺔﺱﻮﺴﺏ ﺎﺒﺣﺮﻣ جﺎﺗ لﺰﻨﺏ ،ﺔﺱﻮﺴﺏ ﺔﻴﺱﺎﻴﺴﻟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻠﻌﻟاو قﻮﻘﺤﻟا ﺔﻴﻠآو ﺔﻴﺋﺎﻀﻘﻟاو
24
و
25
ﺮﺒﻤﻓﻮﻥ
2
000
18 Cette prérogative altère le régime de la preuve en obligeant le contribuable à fournir lui-même les éléments de la démonstration, alors que c’est l’administration, qui supporte la charge de la preuve. ↑
19 Une indiscrétion inquisitoriale insupportable. ↑
20 Des états détaillés de leur patrimoine et des éléments de leur train de vie. ↑
21 Vivre, c’est dépenser ; et à son terme, le contrôle des revenus par le train de vie se transforme en une intrusion fiscale de tous les instants de la vie privée des citoyens. ↑