Les variations de la langue française sont au cœur de l’analyse du Dictionnaire des francophones, un outil politique visant à promouvoir une approche polycentrique. Cet article explore les enjeux de gouvernance linguistique et la lutte contre la glottophobie dans le contexte du plurilinguisme.
Dépasser le français prescriptif : une résolution à l’ordre du jour
Bien que la prescription reste majoritairement de rigueur au sein des systèmes éducatifs, nous relevons une véritable volonté de se départir d’une vision trop normée de la langue française. Laélia Véron et Maria Candea, dans Le français est à nous !, posent la question suivante : « Existe-t-il une seule langue française ? » (2019, p. 42). Alain Rey y répond partiellement en qualifiant le français de « singulier trompeur » (2007, p. 42). La formule « Le français n’existe pas », usitée par Jean-Marie Klinkenberg lors de ses cours de sociolinguistique et reprise par Arnaud Hoedt et Jérôme Piron dans leur ouvrage éponyme (2020) en atteste. L’existence d’une norme commune à la francophonie est confirmée en sociolinguistique :
[…] si le français du balayeur sénégalais, de la ménagère du Lot-et-Garonne et celui de la Secrétaire perpétuelle de l’Académie Française ne sont pas exactement les mêmes, toujours est-il qu’il se réfère implicitement à une même norme plus ou moins consciente. (Klinkenberg, 2022, p. 38)
Le linguiste Médéric Gasquet-Cyrus – spécialiste du parler marseillais – en est d’avis. C’est le propre d’une communauté linguistique que de produire des normes « dont l’une finit par être érigée (par adhésion plus ou moins forcée) en référence. » (dans Hoedt et Piron, 2020, p. 66) Il détermine que les variations de la langue sont appréciées selon ladite norme, qualifiée par le sociologue Pierre Bourdieu dans Ce que parler veut dire de « norme légitime » (Idem). Tout en reconnaissant la norme de référence, Gasquet-Cyrus donne à entendre un autre discours en revendiquant l’existence d’autres variétés de langue (Idem).
Néanmoins, à cette norme commune se greffent des variations géographiques, sociales et chronologiques, qui se doivent également d’être prises en compte. Les sphères politiques et médiatiques ne portent pourtant pas systématiquement cette réalité, ce qui engendre une méconnaissance de la langue par les citoyens. Par conséquent, nous avons relevé des incohérences au sein des services de l’État français.
En 2017, alors que la Délégation générale à la langue française et aux langues de France portait une politique en faveur de la diversité linguistique – reconnaissant de facto la pluralité inhérente à la langue française –, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a affiché sur Twitter l’assertion suivante : « Il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule République.
» (Véron et Candea, 2019, p. 43). Véron et Candea s’en sont fait les commentatrices en mettant en exergue le contresens linguistique et historique de l’allégation. La cohérence politique est cependant relevée, « l’unité de la langue française » étant le motif d’affirmation d’« unité de la nation. » (Idem). Dans leur livre Le français n’existe pas, Hoedt et Piron consacrent un chapitre à disséquer la contrevérité énoncée par Jean-Michel Blanquer (2020, p.
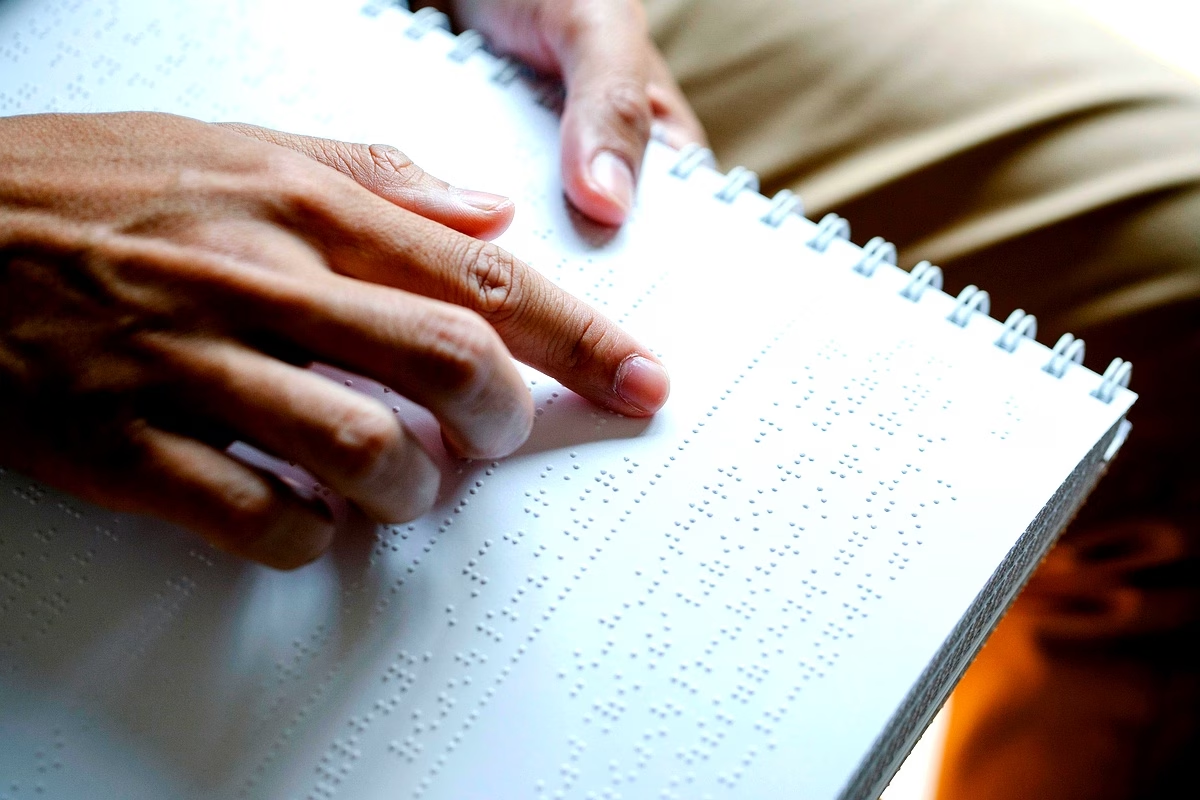
60). Les deux linguistes réaffirment « qu’il n’y a pas non plus “qu’une langue” », puisque le français varie historiquement, géographiquement et sociologiquement (Idem). Ils mettent en exergue ma période charnière de la Terreur, où la relation cause-conséquence entre la langue et la Nation est mise sur pied. Le basculement opéré a plus exactement lieu en 1794.
L’année voit poindre « l’idéologie de l’unilinguisme national radical », en opposition au multilinguisme, « considéré comme contre-révolutionnaire. » (Idem) Un dogmatisme qui connaît un second souffle « à la fin du XIXe siècle avec la montée des nationalismes » et qui se voit définitivement scellé avec l’inscription dans l’article 2 de la Constitution que « Le français est la langue de la République.
» (Idem) Trahissant une logique d’appropriation, la formulation est rectifiée quasi instantanément au profit de « La langue de la République est le français. » En 2015, le refus par le Sénat de ratifier la Charte européenne des langues régionales et minoritaires parachève d’instaurer une conception unitaire de la langue. Afin de la rendre obsolète, les auteurs se saisissent des propos du linguiste Pierre Encrevé, qui affirme que « Pour qu’il n’y ait qu’une langue […] il
faudrait qu’il n’y ait qu’une seule personne, qui dise une chose, à un moment, sinon, aussitôt la langue varie. » (Ibid., p. 63) À la lumière des éléments fournis, Hoedt et Piron proposent une inversion du concept d’« unité » en faisant ressortir les ponts créés entre les locuteurs par la reconnaissance des variations du français (Idem).
Nous avons découvert – lors de notre étude empirique – que le Québec était pionnier dans le questionnement de la norme du français : « Le Conseil de la langue français au Québec s’est régulièrement, de manière presque constante – sauf maintenant –, depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, posé la question de savoir quelle norme il fallait adopter au Québec. » (Francard, 2022, p. 123)
La remise en cause d’une norme indubitable s’est faite au travers de travaux lexicographiques – TLF et projet Francus de l’université de Sherbrooke compris –. Dans cet esprit, l’Association québécoise des professeurs de français a fondé le concept de « français d’ici », en référence à la norme dominante sur leur territoire (Idem).
Les positions adoptées par la France sont différentes de celles du Québec. Pour la République française, l’avancée tient davantage à la reconnaissance de normes extrinsèques au territoire hexagonal. Dans son Éloge de la profusion, Cerquiglini reconnaît que le courant de pensée plaidant pour « la richesse lexicale, la bienveillance envers la néologie, la tolérance envers la variation et la diversité des normes » est encore minoritaire (2020).
Pourtant, le DDF contribue à faire bouger les lignes en s’inscrivant dans cette démarche. En effet, nous relevons que la volonté de combattre le purisme est inscrite dans la stratégie présidentielle (Cerquiglini, 2022, p. 16). Ainsi, le DDF a été conçu pour mettre en rapport la norme commune à la francophonie – dont l’utilité est reconnue – et les variations du français : « Il y a une variété commune, que l’on apprend à l’école, qui est utile, mais sans aucun mépris pour sa langue.
Il est évident que le DDF est un outil qui va servir à ça, et il sert. Et l’équipe lyonnaise y pensait, c’est évident. » (Idem)
La volonté qu’a le DDF de défaire l’offre dictionnairique d’un français trop prescriptif nous amène à questionner sa portée normative. Dans le cadre de notre enquête de terrain, nous avons demandé aux acteurs du DDF si l’on pouvait le suivre comme un guide, comme c’est le cas pour d’autres dictionnaires. Si aucune réponse ferme ne peut pour l’instant être apportée – au vu de la parution très récente du DDF –, nous pouvons établir un parallèle avec le Dictionnaire des belgicismes, lui aussi représentatif de l’hétérogénéité du français. Alors que le
projet de recherche a été lancé dans le but de légitimer les belgicismes – largement ségrégués –, il a acquis une portée normative au fil des ans. En faire un ouvrage de référence n’était pourtant pas souhaité par ses auteurs. C’est librement que les usagers s’en sont saisi et ont commencé à s’y référer. Une observation corroborée par un terrain effectué par Michel Francard en Wallonie :
J’ai élaboré un dictionnaire d’une région précise de Wallonie. Là aussi, la visée était de faire exister la langue avant qu’elle ne disparaisse. Et bien, un an environ plus tard, les gens avaient commencé à le consulter pour savoir ce qui se disait et ce qui ne se disait pas. Donc c’est vraiment la relation au dictionnaire qui, à un moment donné, le fait passer de l’inventaire à la norme. (2022, p. 129)
La propension du dictionnaire à devenir un ouvrage normatif est nuancée par Jean Tabi-Manga. Selon le linguiste, « Le DDF n’imposera pas dans l’immédiat une norme endogène. C’est une question lointaine. » (2022, p. 55)
En définitive, la reconnaissance des variations de français est à l’ordre du jour. L’intérêt qu’y porte la francophonie est visible dans l’édition 2022 de La langue française dans le monde. L’importance accordée aux variations sociolinguistiques du français est signifiée par la parution au sein du Rapport d’un entretien de Bernard Cerquiglini, consacré à la question des variétés de français (Ibid., p.
12). Nous pouvons également y retrouver l’étude « Preslaf », coordonnée par Comlan Fantognon sous l’égide de L’OLF (Idem). Elle traite des variétés de français à travers le monde au prisme de onze pays francophones. Lors de notre entretien, Francine Quéméner nous a fait part du caractère novateur de la démarche : « Au sein de l’Observatoire, oui, c’est la première fois qu’un travail de cette forme-là a été coordonné et restitué.
» (2022, p. 97) La reconnaissance des variétés de français est un objectif à l’importance croissante, ce qui explique les moyens octroyés pour mettre sur pied un dictionnaire valorisant la langue française dans son hétéroclicité.
