L’usage des locutions latines en presse révèle des différences significatives entre la presse numérique francophone algérienne, française et québécoise. Cette étude comparative met en lumière comment ces expressions enrichissent le discours journalistique et reflètent des identités culturelles distinctes.
Conclusion générale
Notre recherche, qui s’inscrit dans le champ d’investigation de la phraséologie, avait comme objectifs d’étudier l’usage des locutions latines dans la presse francophone algérienne en ligne, et puis de situer cet usage dans le paysage médiatique francophone mondial à travers une comparaison avec les usages pratiqués dans les presses numériques, française et québécoise.
En nous référant à nos lectures antérieures de journaux francophones et d’ouvrages sur la langue latine, nous avions émis au préalable des hypothèses supposant que l’emploi le plus fréquent et le plus varié des locutions latines s’opère au niveau de la presse électronique française, qui compte potentiellement le plus de lecteurs francophones, ainsi qu’au sein des diverses rubriques réservées dans chacun des journaux du corpus aux contributeurs, ces derniers, étant globalement des spécialistes et des intellectuels, jouissent d’un certain degré de maîtrise de la langue française et d’une culture leur permettant d’utiliser de la phraséologie latine.
Nous avions en outre présumé que ce sont les locutions latines appartenant aux domaines politique, juridique, économique, scientifique qui comptabilisent le plus d’éléments et le plus d’emplois puisque les journaux d’information générale traitent souvent de ces domaines. Enfin, nous avions présupposé le manque d’homogénéité orthographique dans l’usage du trait d’union (-), l’emploi de la forme italique pour toutes les locutions latines et l’absence des formes francisées en nous basant sur ce qu’affichent les dictionnaires français consultés et sur ce que préconisent l’Académie française et les codes typographiques en vigueur à l’Imprimerie nationale française.
Dans l’intention de vérifier nos hypothèses, nous avons divisé notre mémoire en trois chapitres. Le premier chapitre consacré aux éléments théoriques nous a permis de constater au début, la relation étroite unissant les langues latine et française. Nous avons également révélé l’existence de plusieurs latins dans la langue française et mis en avant le statut prestigieux de la langue de Cicéron dans la société hexagonale.
Nous avons exposé aussi au sein de ce chapitre, certaines théories d’identification et de classification des unités phraséologiques. Ce qui nous a permis d’établir une classification étymologique des locutions latines sur la base de leur domaine d’origine. Nous avons par ailleurs présenté les caractéristiques de ces locutions et évoqué le flou qui règne autour de l’orthographe et de la typographie à adopter.
Nous avons conclu ce chapitre par un aperçu sur les presses électroniques francophones sujettes à l’étude ainsi que par une mise en exergue de l’importance de la qualité linguistique dans la fidélisation des lecteurs sur Internet.
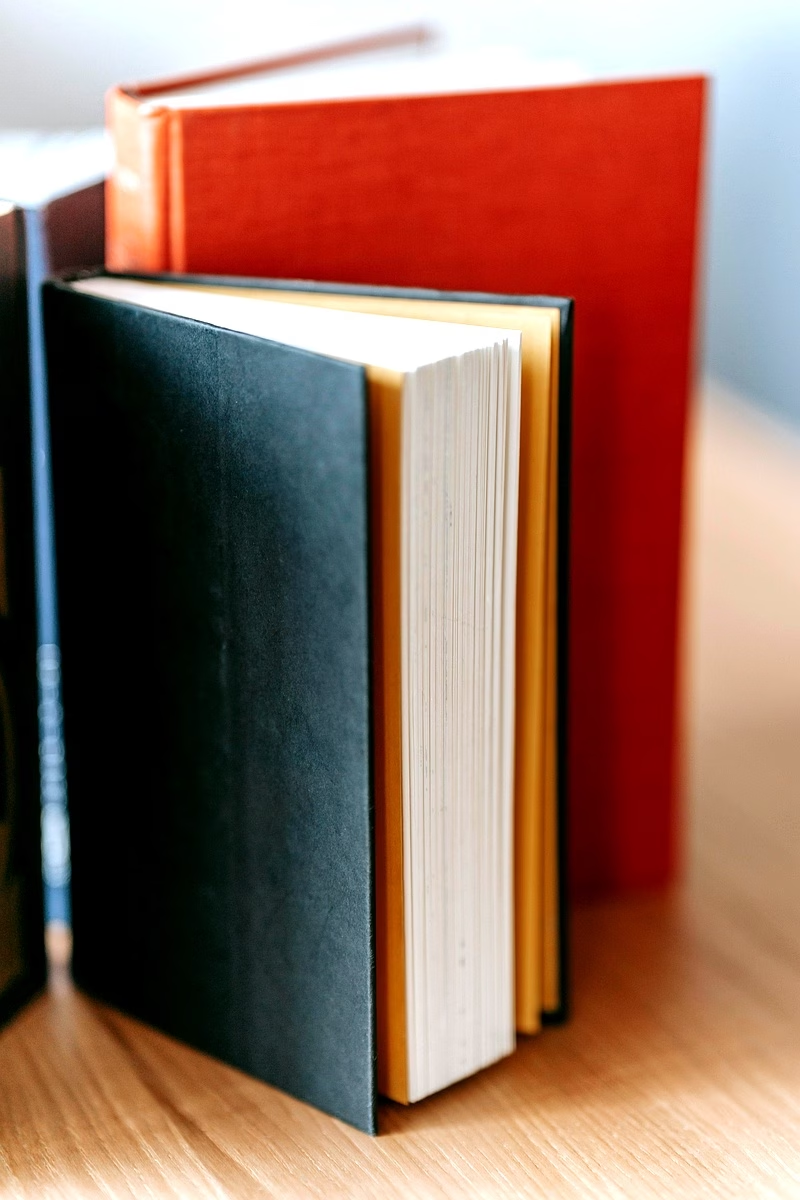
Dans le deuxième chapitre consacré à la démarche méthodologique adoptée, nous avons, après avoir révélé nos objectifs et nos motivations, présenté notre corpus et le processus permettant sa collecte ainsi que les outils informatiques employés. Nous avons également dans ce chapitre expliqué comment nous allons organiser et traiter les données recueillies.
Nous avons procédé enfin dans le troisième chapitre à l’analyse des données recueillies et à l’interprétation des résultats. Nous avons au début de ce chapitre dressé, à travers des tableaux, les listes détaillées des occurrences et des locutions latines recensées.
Nous avons soumis les occurrences à une analyse quantitative nous permettant d’établir, entre les trois presses choisies pour l’étude, des comparaisons sur les proportions d’articles comportant de la phraséologie latine, les fréquences d’emplois et les différentes répartitions par rubriques, par classes étymologiques et par auteurs. Nous avons également rassemblé toutes les particularités orthographiques et typographiques.
À la lumière des résultats obtenus au terme de l’analyse, nous pouvons confirmer que l’emploi le plus fréquent et le plus varié des locutions latines s’opère au niveau de la presse électronique française (Le Figaro) ainsi qu’au sein des diverses rubriques réservées, dans chacun des journaux du corpus, aux contributeurs.
À noter que l’analyse révèle que la presse algérienne emploie plus fréquemment les locutions latines que son homologue québécoise. Mais, l’analyse démontre surtout que « Le Quotidien d’Oran » et « Le Figaro » enregistrent des fréquences qui diffèrent de peu.
Les résultats de l’analyse contredisent par contre certaines de nos suppositions. En effet, ce n’est pas la classe I, mais en revanche la classe II, qui rassemble les locutions appartenant aux domaines philosophiques, littéraires, religieux, mythologiques et historiques, qui comptabilise le plus d’éléments et le plus d’emplois dans le corpus.
Toutefois, il est à noter que nous pouvons confirmer partiellement notre troisième hypothèse au niveau des presses algériennes et québécoises dans lesquelles les locutions de la classe I comptent le plus d’occurrences recensées.
À travers les résultats, nous sommes aussi en mesure de confirmer le manque d’homogénéité orthographique dans l’usage du trait d’union (-), mais pas l’emploi permanent de la forme italique pour toutes les locutions latines ainsi que l’absence des formes francisées.
En effet, nous avons d’abord constaté l’usage inconstant de la forme italique, même si globalement, il ressort de nos observations que les auteurs des articles réserveraient l’écriture italique aux locutions latines rarement employées et à celles absentes des dictionnaires français. Nous avons ensuite recensé plusieurs emplois de la forme francisée, en opposition avec les recommandations de l’Académie française.
L’analyse des particularités orthographiques et typographiques nous a permis en outre de remarquer que les usages les plus élevés du trait d’union et des formes francisées s’opèrent dans la presse algérienne. En contrepartie, ce sont les presses française et québécoise qui transcrivent le plus les locutions latines en italique, l’usage de cette forme étant pratiquement absent dans les journaux algériens.
À travers cette recherche, nous avons donc tenté de relever ce qui caractérise l’usage des locutions latines dans la presse algérienne francophone en ligne et de comparer cet usage avec d’autres presses francophones.
Cette recherche nous a permis de repérer des similitudes sur la rubrique dans laquelle l’usage est le plus fréquent (contributions), le type d’auteurs le plus représenté (journalistes) et sur la locution la plus employée a priori. À l’inverse, nous avons décelé des différences sur les autres points (les fréquences d’emploi, les proportions d’articles, les classes dominantes…).
À souligner que nous avons rencontré certains problèmes dans la réalisation de ce travail. En premier lieu, nous n’avons trouvé aucune étude sur ce phénomène pour nous orienter. Nous avons aussi pâti de notre faible connaissance de la langue latine, qui se résumait avant ce mémoire, à quelques locutions et expressions des « Pages Roses » du Larousse.
Nous estimons en outre que la période étudiée est trop courte et qu’il n’y a pas assez de journaux français et québécois pour tirer des conclusions générales. À ce titre, nous proposons de réaliser une suite à cette recherche sur une durée plus grande et avec plus de journaux français et québécois.
Inventaire des locutions latines recensées
| ~ A ~ | |
|---|---|
A contrario (à contrario) [akO˜tʀaʀjo] : locution adverbiale et adjectivale.
« Comme d’habitude les agents de la police et leurs engins n’étaient pas visibles. A contrario, ceux en tenue civile étaient présents en nombre » (El Watan, avril 2021). | |
A fortiori (à fortiori) [afOʀsjOʀi] : locution adverbiale et adjectivale.
« A fortiori lorsque cette inquiétude porte sur le gouvernement (et/ou l’un de ses membres) du pays d’accueil de l’ambassadeur » (Le Soir d’Algérie, avril 2021). | |
A minima (à minima) [aminima] : locution adverbiale.
« Un service qui, à minima, serait dédié à la gestion des logiciels et autres applications » (Le Quotidien d’Oran, avril 2021). | |
A posteriori (à postériori, a postériori) [apOsteʀjOʀi] : locution adverbiale et adjectivale.
« … son installation peut se décliner, a posteriori, comme un renvoi d’ascenseur » (Liberté, avril 2021). | |
A priori (à priori) [apʀiOʀi] : locution adverbiale, adjectivale et nominale masculine.
« Beaucoup de fans de sport auto ont un a priori sur le sport mécanique électrique » (Le Figaro, 2021). |
Ad hoc [adOk] : locution adjectivale.
« … de témoignages de petits commerçants sur un site ad-hoc » (La Presse, 2021). |
Ad hominem [adOminɛm] : locution adjectivale.
« … leur reprochant des procès ad hominem aux allusions inélégantes » (Le Soir d’Algérie, 2021). |
Ad nauseam [adnozeam] : locution adverbiale.
« … l’écran de fumée que l’on a créé par les informations journalières ad nauseam du nombre de cas de COVID-19 » (La Presse, 2021). |
Ad vitam aeternam [advitametɛʀnam] : locution adverbiale.
« Quels sont, d’après vous, les motifs qui ont poussé les pouvoirs publics à maintenir une telle option ad vitam aeternam ? » (Liberté, 2021). |
Alea jacta est [aleɑjaktɑɛst] : locution phrase.
« Alea jacta est ! À présent, le personnel gouvernant doit admettre que les anciennes pratiques ne s’accordent point » (Le Quotidien d’Oran, 2021). |
Alma mater [almɑmɑtɛʀ] : locution nominale féminine.
« Aujourd’hui, l’alma mater n’est plus un sanctuaire de la liberté intellectuelle » (Le Figaro, 2021). |
Alter ego [altɛʀego] : locution nominale masculine.
« Une attitude partagée par ce berger, parfait alter ego de l’acariâtre vieux chef de famille, qui se prend au jeu du charlatan par défaut » (Le Soir d’Algérie, 2021). |
~ B ~ |
Bis repetita [bisʁepetita] : locution phrase.
« … prévision de leur périlleux déplacement à Sétif. Et “bis repetita” cette semaine encore » (Liberté, 2021). |
| ~ C ~ |
Casus belli [kɑzusbɛli] : locution nominale masculine.
« Le gouvernement ukrainien craint que Moscou ne cherche à provoquer un casus belli pour tenter de justifier une opération armée » (La Presse, 2021). |
| ~ D ~ |
De facto [defakto] : locution adverbiale.
« Il avait annoncé que le volume des exportations et de facto, les recettes seront réduites à partir de 2025 » (El Watan, 2021). |
De visu [devizy] : locution adverbiale
« Après avoir constaté de visu que nous manquions terriblement de presque tout, il nous a offert des tenues et des ballons » (Liberté, 2021). |
Deus ex machina [deysɛksmakina] [deusɛksmakina] : locution nominale masculine.
« … mais inocule à la classe politique dans son ensemble le poison de la docilité injecté par le “deus ex machina” » (Le Soir d’Algérie, 2021). |
| ~ E ~ |
| Ex aequo (ex-aequo) [ɛkseko] : locution adverbiale, adjectivale et nominale masculine. Sur le même rang, à égalité dans un concours, une compétition (Académie française). « … avance sur les petites Alice et Emma (ex æquo à 491) » (La Presse, 2021). |
Ex cathedra [ɛkskatedʀa] : locution adverbiale.
« La haute administration ne peut être enseignée ex cathedra » (Le Figaro, 2021). |
Ex nihilo (ex-nihilo) [ɛksniilo] : locution adjectivale adverbiale.
« Les effets induits par les différents programmes de l’État ont fait qu’un village, en l’occurrence Biyara, a été créé, presque ex-nihilo » (El Watan, 2021). |
Ex post (ex-post) [ɛkspOst] : locution adjectivale.
« Le titulaire du compte reçoit un rendement déterminé ex-post » (El Watan, 2021). |
Extra muros (extra-muros) [ɛkstʀɑmyʀos] : locution adverbiale, adjectivale et nominale. Hors des murs de la ville. « Loïc sort très rarement de l’hôpital, doit toujours être accompagné, et chaque excursion extra-muros le fatigue » (La Presse, 2021). |
| ~ F ~ |
Fac-similé [faksimile] : locution nominale masculine.
« Si le Musée de l’armée n’enlève pas ce fac-similé de squelette, nous retirons le logo de la Fondation Napoléon » (Le Figaro, 2021). |
| ~ G ~ |
Grosso modo (grosso-modo) [gʀOsomOdo] : locution adverbiale.
« … des orchestres féminins spécialement en direction d’un public féminin. Grosso modo, c’est cela l’architecture générale » (El Watan, 2021). |
| ~ H ~ |
Homo doctus : locution nominale.
« … il y a l’espèce Homo doctus (le spécialiste) : ce type de personne entre dans une librairie sans autre motif que de faire au libraire une conférence » (Le Figaro, 2021). |
Homo faber [omofabɛʁ] : locution nominale masculine.
« Se priver du progrès technologique serait une folie, en plus d’être en rupture avec ce qui fait la condition humaine depuis Homo faber » (Le Figaro, 2021). |
| Homo occidentalis : locution nominale masculine. Homme (homo) occidental (occidentalis) (Biblissima). « L’homo occidentalis aimerait sortir de son absence » (Le Figaro, 2021). |
Homo oeconomicus (economicus) [omoekOnOmikys] : locution nominale masculine.
« L’homo religiosus céderait la place à homo oeconomicus » (Le Figaro, 2021). |
| Homo pertitus : locution nominale masculine. Domaine. Latin de Cuisine : « L’expert ». « Dans celle de l’Homo peritus (l’expert) il y a… » (Le Figaro, 2021). |
Homo religiosus : locution nominale masculine.
« L’homo religiosus céderait la place à homo oeconomicus » (Le Figaro, 2021). |
| Homo reprobans : locution nominale masculine. Domaine. Latin de Cuisine : « Un râleur ». « Et puis, des gens presque ordinaires, oui ça existe : un Parentes lassi (un parent exténué), un Homo reprobans (un râleur) » (Le Figaro, 2021). |
| Homo sternuens : locution nominale masculine. Domaine. Latin de Cuisine : « Un renifleur ». « Et puis, des gens presque ordinaires, oui ça existe […] un Homo sternuens (un renifleur) » (Le Figaro, 2021). |
| Homo vestimentis strictis amictus : locution nominale masculine. Domaine. Latin de Cuisine : « Un porteur de Lycra ». « Et puis, des gens presque ordinaires, oui ça existe […] un Homo vestimentis strictis amictus (un porteur de Lycra) » (Le Figaro, 2021). |
| ~ I ~ |
In absentia : locution adverbiale.
« Il a aussi attaqué un policier aux Jeux panaméricains, ce qui lui a valu six mois de prison in absentia » (La Presse, 2021). |
In extremis : [inɛkstʀemis] locution adverbiale et adjectivale.
« Des automobilistes ayant bravé l’obscurité prévalant sur cet axe routier ont échappé in extremis à des guets-apens » (Le Quotidien d’Oran, 2021). |
| In fine [infine] : locution adverbiale. À la fin, finalement (Académie française). « Cette radicalisation […] révèlent, in fine, une véritable crise » (Liberté, 2021). |
In situ (in-situ) [insitu] : locution adverbiale, adjectivale.
|
