L’usage du trait d’union dans les locutions est analysé dans le contexte de la presse numérique francophone, mettant en lumière les variations orthographiques entre les presses algérienne, française et québécoise. L’étude révèle des proportions d’utilisation significatives et souligne l’impact culturel de ces locutions.
Particularités orthographiques et typographiques
L’usage du trait d’union
Les dictionnaires français, comme révélé dans la partie théorique, mentionnent pour certaines locutions des orthographes avec et sans trait d’union (-)
Le tableau 09 rassemble tous les emplois relevés du trait d’union avec les proportions (nombre d’utilisation comportant le trait d’union/nombre total des usages de la locution).
| Locution | Total | Watan | Soir | Liberté | Quotidien | Figaro | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad-hoc* | 1/25 | 0/5 | 0/1 | 0/9 | 0/1 | 0/7 | 1/2 |
| Ex-aequo | 2/11 | – | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 0/6 | 0/4 |
| Ex-nihilo* | 1/3 | 1/1 | – | – | 0/2 | – | – |
| Ex-post* | 1/1 | 1/1 | – | – | – | – | – |
| Extra-muros | 8/9 | 4/5 | 2/2 | – | 1/1 | – | 1/1 |
| Fac-similé | 1/1 | – | – | – | – | 1/1 | – |
| In-extrémis* | 1/37 | 0/5 | 1/4 | 0/4 | 0/1 | 0/15 | 0/8 |
| In-situ* | 2/10 | 1/1 | – | – | 1/3 | 0/4 | 0/2 |
| Intra-muros | 11/12 | 2/2 | 5/5 | – | 3/4 | 1/1 | – |
| In-vivo* | 1/1 | – | 1/1 | – | – | – | – |
| Mea-culpa | 8/23 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | – | 4/11 | 1/7 |
| Post-mortem | 2/3 | – | – | – | – | 1/2 | 1/1 |
| Post-scriptum | 2/2 | – | – | – | – | 1/1 | 1/1 |
| Statu-quo* | 1/76 | 0/9 | 0/10 | 0/9 | 0/4 | 1/21 | 0/23 |
| Vade-mecum | 2/2 | – | – | – | 1/1 | 1/1 | – |
| Vice-versa | 10/15 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/4 | 4/6 |
| * Écriture non mentionnée dans les dictionnaires français | |||||||
| El Watan | 12/77 | 15,58 % | |||||
| Le Soir | 11/61 | 18,03 % | |||||
| Liberté | 2/69 | 2,89 % | |||||
| Le Quotidien | 8/58 | 14,29 % | |||||
| Journaux algériens | 33/265 | 12,45 % | |||||
| Le Figaro | 12/296 | 4,06 % | |||||
| La Presse | 9/145 | 6,21 % | |||||
| Tous les journaux | 54/706 | 7,56 % | |||||
Tableau 09
Liste et répartition des écritures avec le trait d’union (-)
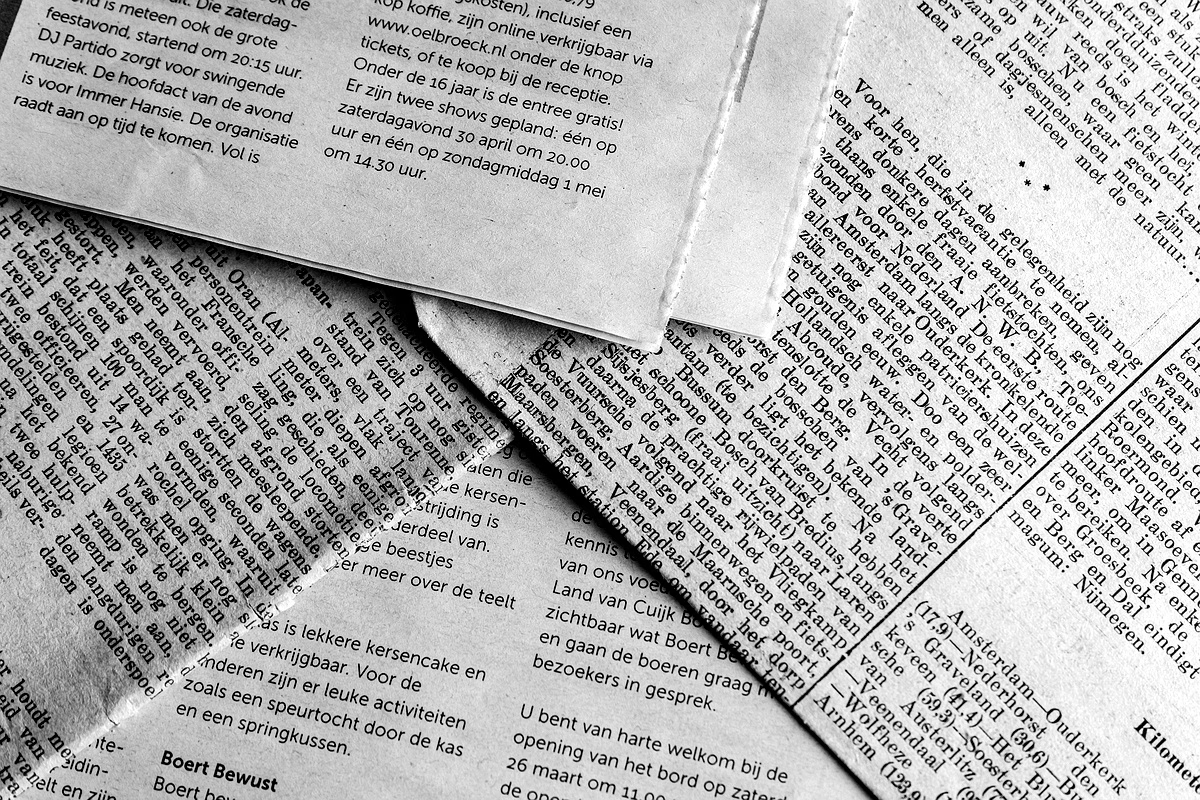
- Analyse du tableau 09
- Journaux algériens
Le tableau 09 répertorie trente-trois (33) emplois du trait d’union (-) dans les journaux algériens. Ce qui représente 12 % des occurrences algériennes recensées.
Au niveau des quotidiens, c’est le « Soir d’Algérie » qui affiche le taux le plus élevé (18 %) juste devant « El Watan » et « Le Quotidien d’Oran ». Alors que « Liberté » se distingue par des usages plus rares, environ (3 %).
L’analyse montre en outre l’usage du trait d’union (-) dans l’écriture de onze (11) locutions, soit le quart (1/4) de celles listées dans les journaux algériens et que celles-ci figurent toutes dans les dictionnaires français consultés.
À souligner que ces dictionnaires ne mentionnent aucune écriture avec un trait d’union pour quatre (4) de ces locutions. Celles-ci possèdent également la particularité de ne comptabiliser chacune qu’un (1) seul usage seulement avec cette écriture dans les journaux algériens.
- Tous les journaux
L’analyse permet de relever au sein du tableau 09, cinquante-quatre (54) écritures utilisant le trait d’union (-), soit dans 7,56 % des occurrences recensées dans le corpus.
Le tableau 09 démontre également le faible usage du trait d’union dans les deux journaux étrangers (4 % et 6 %) en comparaison aux taux enregistrés dans la plupart des journaux algériens. Ces derniers comportent du reste 62 % des usages dénombrés du trait d’union (-).
Il est à noter aussi que l’emploi du trait d’union (-) concerne seize (16) des soixante- douze (72) locutions listées dans le corpus, soit 22 %. Ces locutions figurent toutes dans les dictionnaires français consultés.
Toutefois, pour presque la moitié d’entre elles, soit sept (7), ces dictionnaires n’indiquent aucune écriture avec un trait d’union (-). Et tout comme observé dans les journaux algériens, ces locutions, à part post-scriptum, ne dépassent pas un (1) seul usage avec cette écriture.
- Locutions
À partir du tableau 09, il est relevé :
- La présence du trait d’union (-) dans toutes les écritures de : « post-scriptum », « vade- mecum », « fac-similé », « in-vivo », « ex-post ».
- Le recours au trait d’union (-) dans certaines écritures d’« ex-aequo » (2/11), « ex nihilo » (1/3), « in situ » (1/10) et « in extremis » (1/37) dans les journaux algériens seulement, des écritures cependant non mentionnées dans les dictionnaires français pour les trois dernières locutions
- L’absence à une reprise du trait d’union (-) dans les écritures d’une part d’« extra- muros » (1/9) et d’« intra-muros » (1/12) seulement dans un journal algérien, et de l’autre dans celle de « post-mortem » uniquement dans « Le Figaro »
- L’emploi du trait d’union (-) à une seule reprise dans l’écriture d’« ad hoc » (1/25) et de « statu quo » (1/76) et uniquement dans « La Presse » (1/2) pour la première et au sein du « Figaro » (1/21) pour la seconde.
- L’utilisation du trait d’union (-) dans la majorité des écritures de « vice-versa » dans les journaux algériens (3/4) et au sein des journaux français et québécois.
- Une différence dans l’écriture de « mea-culpa » entre les journaux algériens et étrangers. En effet, dans les premiers, la majorité des écritures (3/5) de la locution se distinguent par un trait d’union (-) (absent seulement dans « Le Soir »), alors qu’au sein du « Figaro » (4/11) et de « La Presse » (1/7) l’usage du trait d’union (-) est minoritaire.
Au regard de ce que l’analyse vient de démontrer, nous sommes aptes à confirmer la première partie de notre quatrième hypothèse : l’homogénéité orthographique sur les traits d’union n’existe pas.
- La forme italique
Comme indiqué dans la partie théorique, les ouvrages typographiques en France préconisent de transcrire en italique les locutions non francisées tout comme les locutions phrases (proverbes, expressions, citations).
Le tableau 10 recense tous les usages en italique des locutions latines, mais hors citations et propos rapportés seulement.
| Locution | Total | El Watan | Le Figaro | La Presse |
|---|---|---|---|---|
| A contrario | 2 | 1 | 1 | |
| A minima | 1 | 1 | ||
| A posteriori | 2 | 2 | ||
| A priori | 2 | 2 | ||
| Ad hoc | 2 | 2 | ||
| Ad hominem | 1 | 1 | ||
| Ad nauseam* | 1 | – | 1 | |
| De facto | 3 | 1 | 2 | |
| Homo faber | 1 | 1 | ||
| In absentia | 1 | 1 | ||
| In extremis | 3 | 1 | 2 | |
| In fine | 7 | 1 | 6 | |
| In situ | 2 | 2 | ||
| Ipso facto | 1 | 1 | ||
| Memento Mori | 1 | 1 | ||
| Modus operandi | 1 | 1 | ||
| Modus vivendi | 1 | 1 | ||
| Nec plus ultra | 1 | 1 | ||
| Numerus clausus | 1 | 1 | ||
| Panem et circences | 2 | 2 | ||
| Persona non grata | 1 | 1 | ||
| Res publica* | 2 | 2 | ||
| Sine die | 1 | 1 | ||
| Sine qua non | 4 | 3 | 1 | |
| Stricto Sensu | 3 | 3 | ||
| Taedium vitae | 1 | 1 | ||
| Tempus fugit* | 1 | 1 | ||
| Vanitas vanitatum et omnia vanitas * | 1 | 1 |
* Non référencée dans les dictionnaires français
Tableau 10
Liste et répartition des usages de la forme italique
- Analyse du tableau 10
- Journaux algériens
L’analyse dénombre une seule occurrence en italique (hors citations et propos rapportés), à savoir in fine, au sein des journaux algériens, au niveau de l’article n ° 09 (El Watan) malgré l’utilisation dans les articles algériens de locutions non francisées et de locutions phrases à l’image d’« alea jacta est » dans l’article n° 200 (Le Quotidien).
Une absence des formes italiques qui pourrait s’expliquer par l’emploi presque exclusivement, comme relevé plus haut, dans les quotidiens algériens, des locutions lexicalisées dans les dictionnaires français.
- Tous les journaux
Le tableau 10 révèle le recours à la forme italique à cinquante (50) reprises dans le corpus. Des usages presque uniquement relevés dans les journaux étrangers, soit quarante- neuf (49) emplois, dont trente-six (36) dans « Le Figaro ».
- Locutions
L’analyse permet de constater que vingt-huit (28) des soixante-douze (72) locutions, listées soit 38.88 %, comptabilisent au moins une écriture en italique dont quatre (4) qui ne figurent pas dans les dictionnaires français consultés.
À souligner que huit (8) locutions : homo faber, memento mori, taedium vitae, tempus fugit, in absentia, vanitas vanitatum et omnia vanitas, panem et circenses, et res publica, présentent des usages exclusivement en italique, mais mise à part pour les deux dernières, les six (6) autres ne comptent qu’un (1) seul emploi recensé dans le corpus.
Parmi ces sept (7) éléments aussi, trois (3) res publica, tempus fugit, vanitas vanitatum et omnia vanitas ne disposent pas d’entrées dans les dictionnaires français consultés.
Le tableau 10 démontre en outre que cinq (5) locutions (ad hoc, a minima, de facto, a contrario, a priori) se distinguent par une écriture en italique dans moins de 10 % de leurs usages. À noter que ces locutions possèdent la particularité de comptabiliser ensemble deux-cent-quarante-trois (243) usages dans le corpus soit plus du tiers (34 %) des occurrences totales recensées.
Il ressort donc de l’analyse que les auteurs des articles réserveraient l’écriture italique
aux locutions latines rarement employées et à celles qui ne figurent pas dans les
dictionnaires français. En contrepartie, ces auteurs écriraient plus en romain les locutions lexicalisées et les plus fréquemment utilisées, comme a priori, statu quo, de facto…
Cependant, certains usages relevés dans le corpus contredisent cette explication. Comme dans l’article n° 287 (Le Figaro), l’auteur écrit ad hoc et stricto sensu en italique, mais « de facto » et « urbi et orbi » en romain. Alors que la dernière locution est beaucoup moins courante qu’ad hoc. En témoignent les usages recensés dans le corpus avec vingt- cinq (25) emplois comptabilisés pour « ad hoc » contre deux (2) seulement pour « urbi et orbi ».
Au terme de l’analyse et compte tenu des observations constatées, nous sommes dans l’incapacité de confirmer la deuxième partie de notre hypothèse : contrairement aux usages typographiques conseillés en France, les auteurs des articles dans la presse francophone n’écrivent pas toujours les locutions latines en italique.
La francisation
Même si l’Académie Française déconseille la francisation des locutions latines, comme souligné dans la partie théorique, une lecture rapide des occurrences permet de relever certains emplois de cette forme. Le tableau 11, au terme d’une analyse plus approfondie, recense les locutions latines écrites sous cette forme avec les proportions (nombre d’utilisation francisée/nombre total des usages de la locution).
| Locution | Total | El Watan | Le Soir | Liberté | Quotidien | Figaro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| À priori | 17/126 | 1/12 | 0/9 | 0/9 | 15/16 | 1/53 |
| À fortiori | 1/16 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/10 |
| À minima | 1/16 | – | 0/1 | – | 1/1 | 0/13 |
| À postériori | 2/18 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | 0/10 |
| Fac-similé | 1/1 | – | – | – | – | 1/1 |
| In extrémis | 1/37 | 0/5 | 1/4 | 0/4 | 0/1 | 0/15 |
| Tous les journaux | 23 | 01 | 01 | 01 | 18 | 02 |
| Total journaux algériens : 21 | ||||||
Tableau 11
Liste et répartition des usages de la forme francisée
- Analyse du tableau 11
Le tableau 11 révèle l’emploi de la forme francisée dans six (6) locutions latines à vingt-trois (23) reprises et dans la plupart des cas dans les journaux algériens (21), mais surtout plus particulièrement dans « Le Quotidien d’Oran ».
En effet, le journal oranais représente à lui seul 78 % des occurrences francisées recensées par l’analyse. Cette dernière montre la francisation au sein du quotidien de tous les usages d’« à minima » et « à postériori » ainsi que 94 % de ceux d’« à priori » et la moitié (1/2) de ceux d’« à fortiori ».
Il résulte de ces constatations que les auteurs des articles de ce journal emploient généralement les formes francisées des locutions latines dès que possible.
Le tableau 11 dénombre en outre dans chacun des trois autres journaux algériens, un seul emploi francisé. À noter que pour la seule occurrence francisée recensée dans
« Liberté » à savoir « a postériori » (l’article n° 131) la francisation par accentuation s’opère au niveau du « e », mais pas du « a ».
Concernant les journaux étrangers, seul « Le Figaro » comporte des locutions francisées, deux (2) exactement dont « fac-similé » la seule locution dénombrée répertoriée dans les dictionnaires consultés (dont celui de l’Académie française) uniquement sous cette forme francisée.
À souligner enfin que quatre des six locutions (4/6), à part « à priori » et « à postériori », comptabilisent un seul emploi francisé seulement.
À partir de ce que vient de révéler l’analyse du tableau 11, nous ne pouvons pas confirmer la dernière partie de notre quatrième hypothèse : les auteurs des articles, contrairement à notre suggestion, emploient les formes francisées des locutions latines en dépit de ce que préconise l’Académie française.
Les autres particularités orthographiques et typographiques
L’analyse des occurrences recensées permet de constater d’autres particularités orthographiques et typographiques :
- L’usage du « æ » dans l’écriture de la locution ex æquo au sein du « Soir d’Algérie » et de « La Presse », alors que dans le reste des journaux la locution s’écrit ex aequo.
- L’emploi du « œ » dans l’écriture d’« homo oeconomicus » contrairement à l’orthographe « homo economicus » que le Larousse utilise dans l’entrée consacrée à la locution (seule présence dans un dictionnaire français).
- Dans l’article n° 40 (El Watan), l’auteur utilise l’écriture « Ad Hoc » avec l’usage au milieu de la phrase de la majuscule pour les lettres « a » et « h ».
- L’article n° 233 (Le Figaro) enregistre l’usage de « statu quo ante » (la locution d
