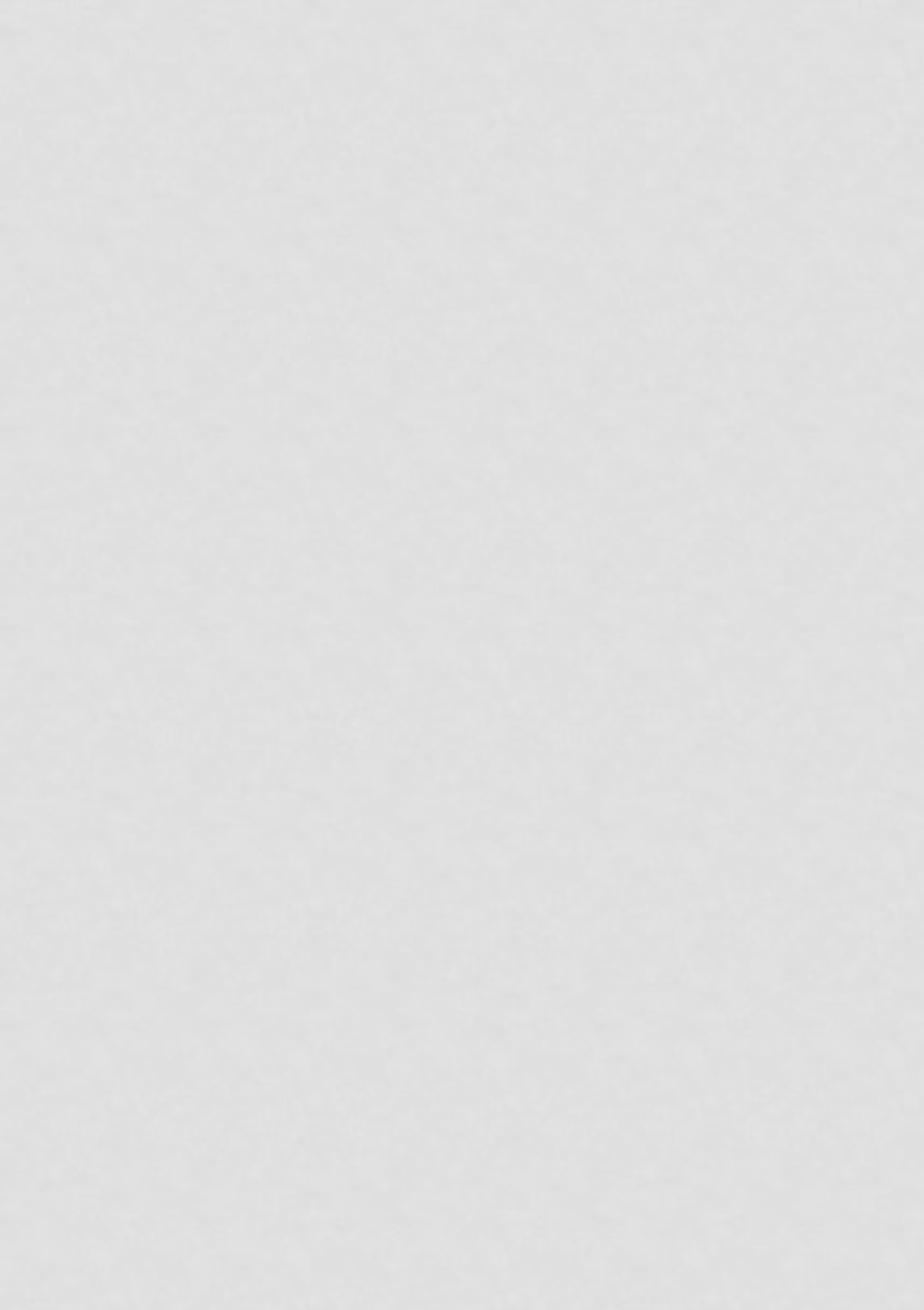Le risque phytosanitaire exportation bois est crucial pour la sécurité des échanges commerciaux, notamment vers le port de Douala. Cette étude identifie les insectes associés au bois et révèle que les bois en grume présentent un risque d’infestation significativement plus élevé que les bois débités.
Chapitre 1 : REVUE DE LITTÉRATURE
Quelques définitions
On trouvera les définitions des termes phytosanitaires utilisés dans la présente norme dans la NIMP n° 5 (Glossaire des termes phytosanitaires) :
Certificat phytosanitaire: document officiel sur support papier ou son équivalent électronique officiel, conforme aux modèles de certificats de la CIPV, attestant qu’un envoi satisfait aux exigences phytosanitaires à l’importation.
Infestation: présence dans une marchandise d’un organisme vivant nuisible au végétal ou au végétal concerné. L’infestation comprend également l’infection
Inspection: Examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d’autres articles réglementés afin de déterminer la présence ou l’absence d’organismes nuisibles et ou des d’assurer du respect de la réglementation phytosanitaire
Quarantaine: Confinement officiel d’articles réglementés, pour observation et recherche ou pour inspection, analyses et/ou traitements ultérieurs
Refoulement: refus d’importer un envoi ou autre article réglementé non conforme à la réglementation phytosanitaire
Risque phytosanitaire (pour les organismes de quarantaine): probabilité d’introduction et de dissémination d’un organisme nuisible et ampleur des conséquences économiques potentielles qui y sont associées
Risque phytosanitaire (pour les organismes réglementés non de quarantaine): probabilité qu’un organisme nuisible présent dans des végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable.
Traitement phytosanitaire : élimination des organismes nuisibles détectés lors des inspections phytosanitaires des articles réglementés ou de prévenir leur dissémination
Dissémination des Organismes Nuisibles
La dissémination des organismes nuisibles résulte de processus aussi bien naturels qu’anthropiques. Ce phénomène s’est considérablement amplifié au cours des dernières décennies avec la mondialisation des marchés des végétaux et produits végétaux, notamment les denrées alimentaires, le matériel végétal et le bois.
Les voyages internationaux et le commerce des produits agricoles ont déplacé les cultures, les adventices, les agents pathogènes et les insectes nuisibles depuis leur environnement d’origine vers de nouvelles zones. Les cultures nouvellement introduites peuvent élargir la répartition des organismes nuisibles, et l’introduction d’organismes nuisibles dans un écosystème où ils étaient complètement absents auparavant peut causer des dommages extrêmement graves, car les organismes nuisibles et leurs hôtes peuvent ne pas avoir évolué ensemble. (Woolhouse et al., 2002)
D’après Anderson et al. (2004), la moitié des nouvelles phytopathologies sont disséminées par les voyages et les échanges internationaux, tandis que la dissémination naturelle, favorisée par les phénomènes météorologiques, constitue le deuxième facteur le plus important. En outre, il est probable que les conditions climatiques ou météorologiques aient une incidence sur l’établissement des organismes nuisibles.
Par exemple, le réchauffement climatique peut faciliter l’établissement de certains organismes nuisibles qui, en temps normal, ne pourraient s’établir dans une zone donnée (pendant un hiver exceptionnellement doux dans des régions tempérées, par exemple). En fait, la mondialisation accrue des marchés ces dernières années, associée à la hausse des températures, a créé une situation particulièrement propice à la circulation et à l’établissement des organismes nuisibles, avec une augmentation concomitante du risque de graves pertes de rendement des cultures (Deutsch et al., 2018 ; Savary et al., 2019).
Par conséquent, lorsqu’on étudie les effets potentiels des changements climatiques sur la santé des végétaux, et donc sur leur répartition, il importe d’identifier non seulement les facteurs qui permettent aux organismes nuisibles de se développer, mais aussi les filières qui leur permettent de se déplacer d’un endroit à l’autre.
Il convient également de cerner les caractéristiques des filières afin de définir les mesures à mettre en œuvre pour atténuer l’évolution du risque phytosanitaire induit par les changements climatiques et s’y adapter. Des efforts considérables ont été déployés aux niveaux national et international en vue de réduire le risque de déplacement des organismes nuisibles à l’échelle internationale (Meurisse et al., 2019), notamment avec la publication et la mise en œuvre des normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP), élaborées sous les auspices de la Commission des mesures phytosanitaires et du Secrétariat de la CIPV.
Ces normes fournissent notamment des directives sur la manière de mener une analyse du risque phytosanitaire (ARP) en vue d’évaluer le risque d’introduction (entrée et établissement) et de dissémination d’organismes nuisibles et de déterminer les mesures à mettre en œuvre pour éviter une telle situation (NIMP n° 2, 2019 ; NIMP n° 11, 2019 ; NIMP n° 21, 2019).
Ces mesures phytosanitaires sont généralement appliquées en fonction des risques propres à la filière. La NIMP n° 11 (2019) précise que les informations à l’appui de l’analyse du risque phytosanitaire doivent être réexaminées périodiquement. Ce réexamen comprend vraisemblablement une réévaluation des risques liés aux filières, ou du moins de ceux fortement liés à l’évolution des conditions climatiques, comme la survenue de phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de déplacer des organismes de quarantaine sur de longes distances.
Bois comme vecteur d’organismes étrangers
Le bois, y compris celui utilisé pour l’emballage, a toujours été un vecteur important de dissémination des organismes nuisibles aux végétaux. Parmi illustrer l’importance de cette filière, on peut citer par exemple le déplacement d’espèces d’insectes envahissants comme le longicorne asiatique Anoplophora glabripennis (Coleoptera : Cerambycidae) via les emballages utilisés dans le commerce international.
Cette espèce est polyphage (c’est-à-dire qu’elle se nourrit d’un large éventail d’aliments) et puise donc sa nourriture dans plusieurs espèces arboricoles comme l’érable (Acer), le peuplier et le tremble (Populus), le saule (Salix) et l’orme (Ulmus), aussi bien en forêt qu’en milieu urbain. Originaire de Chine et de la République de Corée, le longicorne asiatique a été introduit aux États-Unis d’Amérique et au Canada via des emballages en bois infestés, et il a également été détecté dans plusieurs pays européens.
Des programmes d’éradication basés sur la détection, l’enlèvement et la destruction des arbres infestés sont actuellement menés dans ces pays. L’inspection et le traitement minutieux des matériaux d’emballage en bois massif, comme les palettes et le bois de calage, constituent une exigence internationale visant à empêcher de nouvelles introductions. Les modélisations réalisées en vue d’anticiper la répartition géographique du coléoptère montrent que les changements climatiques pourraient modifier sa répartition et son impact.
Les emballages en bois ont également été identifiés comme étant une probable filière pour de nombreuses espèces de scolytes, comme Ips grandicollis (Coleoptera : Curculionidae), et d’autres ravageurs forestiers extrêmement nuisibles, comme l’agrile du frêne, Agrilus planipennis (Coleoptera : Buprestidae) et la guêpe perce-bois, Sirex noctilio (Hymenoptera : Siricidae) (Meurisse et al., 2019). Le déplacement du nématode du pin, B. xylophilus (voir l’étude de cas plus bas), ou de son insecte vecteur, via les matériaux d’emballage en bois non traités a également été observé. (Hu et al., 2009).
Convention internationale de la protection des végétaux
L’introduction et la dissémination des végétaux et des organismes nuisibles aux végétaux d’une zone géographique à l’autre est une question d’intérêt mondial qui fait l’objet de plusieurs accords internationaux. Le principal accord visant à empêcher la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux est la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV).
La CIPV est un traité multilatéral de coopération internationale pour la protection des végétaux. Elle a pour but d’assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l’adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers (CIPV article I, par. 1).
La Convention a également pour but de protéger la santé des végétaux tout en limitant les interférences avec le commerce international. La CIPV s’applique aux végétaux cultivés, à la flore sauvage et aux produits végétaux, et couvre à la fois les dégâts directs et indirects causés par les organismes nuisibles (incluant ainsi les végétaux nuisibles aux végétaux (par exemple, les mauvaises herbes)).
Outre les végétaux et les produits végétaux, la CIPV s’applique également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de véhiculer ou de disséminer des organismes nuisibles (article I, par. 4).
Les pays qui ont ratifié la Convention sont les parties contractantes. Plus de 80 % des pays dans le monde sont parties contractantes de la CIPV. Les parties contractantes acceptent de coopérer entre elles pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles aux végétaux. Cela comprend l’échange d’informations sur les organismes nuisibles aux végétaux, la fourniture d’informations techniques et biologiques nécessaires à l’analyse du risque phytosanitaire, et la participation à des campagnes spéciales de lutte contre les organismes nuisibles. Souvent aussi, les pays qui n’ont pas ratifié la Convention (les parties non-contractantes) respectent la Convention, et sont encouragés à le faire (article XVII).
Du point de vue des exportations, les parties contractantes doivent prendre des mesures pour que leurs exportations ne soient pas sources de nouveaux organismes nuisibles dans les territoires de leurs partenaires commerciaux et qu’elles satisfassent aux exigences à l’importation du pays importateur.
La Commission des Mesures Phytosanitaires (CMP) est l’organe qui régit la CIPV. Elle se réunit sur une base annuelle et a adopté plusieurs Normes Internationales pour les Mesures Phytosanitaires (NIMP) qui donnent des directives aux pays et aident les parties contractantes à réaliser les objectifs de la Convention. Les domaines couverts par les NIMP sont la surveillance.