La représentativité linguistique du Sud est au cœur de l’analyse du Dictionnaire des francophones, qui se positionne comme un outil politique visant à corriger l’asymétrie entre les espaces francophones du Nord et du Sud. Cet article aborde les enjeux de gouvernance linguistique et la lutte contre la glottophobie.
C-Instaurer une représentativité équitable
L’OIF et l’AUF : garantes de l’espace francophone du Sud
L’asymétrie institutionnelle entre l’espace francophone du Nord et du Sud a été identifiée dès les prémices du projet. En témoigne la note d’intention rédigée par la DGLFLF attire l’attention sur « le déséquilibre entre les institutions du Nord, qui font la norme, la recherche, l’édition terminologique d’un côté, et la rareté d’autres lieux de référence, qui sont davantage universitaires et de recherche.
» (2019, p. 2) La DGLFLF se veut force de proposition lorsqu’elle met à l’écrit sa volonté d’instaurer une coopération Nord-Sud par le biais d’« instances d’aménagement et de politique des langues dans les pays africains ». (Idem) Elle suggère de mobiliser l’OIF pour accompagner les « expertises nationales » et l’AUF pour souder les « réseaux de terminologie et de recherche » (Idem).
Dans cette optique, l’inclusion de l’espace francophone du Sud au sein du comité de pilotage se traduit par la présence de l’OIF et de l’AUF. Les deux organismes sont donc un rempart au manque « de structure bien identifiée » (Petit, 2022, p. 91). En officiant comme « porte-parole des autres pays francophones qui n’ont pas de structure spécifique dédiée » (Idem), l’OIF agit pour que le Sud puisse prendre part aux discussions portant sur la langue française.
C’est Claudia Pietri – spécialiste de programme pour la promotion de la diversité linguistique à l’OIF – qui s’est impliquée sur le chantier du DDF : « Elle était en charge de coordonner le travail du DDF avec 2IF. Sa mission était plus précisément d’assurer la structuration du réseau d’expertise dans les pays ayant appuyé ce travail, sous la présidence de Bernard Cerquiglini.
» (Quéméner, 2022, p. 96)
Plus largement, l’OIF a offert une réponse pérenne au besoin de représentativité des Suds en devenant membre observateur du réseau OPALE. Un positionnement confirmé par Francine Quéméner : « En tant que membre observateur d’OPALE, l’OIF vient justement en appui de “l’espace francophone du Sud” et, plus particulièrement, des pays d’Afrique subsaharienne et
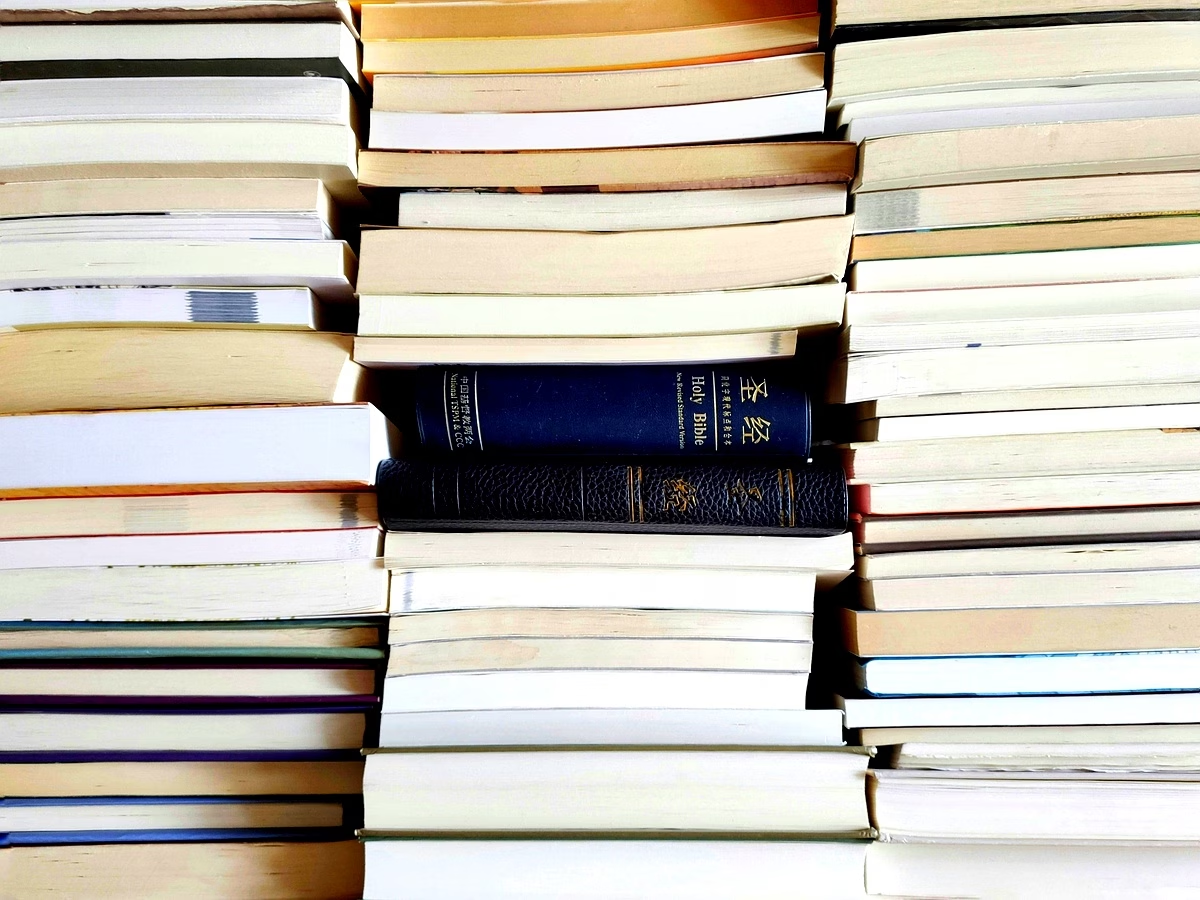
de l’Océan Indien. » (2022, p. 98)
Néanmoins, son statut d’observateur ne confère pas à l’OIF les mêmes droits qu’aux autres membres et révèle l’iniquité persistant entre le Nord et le(s) Sud(s) :
Lors d’une des réunions d’OPALE – qui est donc le réseau dont je viens de parler des quatre pays du Nord –, ma délégation avait posé la question de la représentativité des pays du Sud et s’était adressé au Secrétaire général de l’OIF pour qu’il puisse mettre au point une enceinte où se dialogue pourrait avoir lieu. La seule réaction – qui est évidemment relativement timide dans un premier temps – a été que l’OIF soit présente aux réunions d’OPALE, en tant qu’observateur. En cette qualité, l’OIF est censée relayer les préoccupations qui sont celles du Sud. (Klinkenberg, 2022, p. 32)
Afin de pallier les rapports asymétriques, l’OIF œuvre à la création d’organismes dans les pays du Sud. Klinkenberg nous fait part de sa participation à un projet qui aboutira à l’automne 2022 : « la création d’un programme de sensibilisation et de mobilisation aux enjeux de la politique linguistique, spécialement en lien avec la politique éducationnelle. L’OIF met au point ce programme avec la collaboration de l’Université Senghor à Alexandrie. » (2022, pp. 32-33)
Formaliser le(s) Sud(s) grâce à la constitution du Conseil scientifique
[img_1]
Source : Gasparini, N. (2022c, 13 mai). Les réseaux d’expertise [Diapositive]. Conférence Dictionnaire des francophones, séminaire de l’ATILF, Nancy.
La constitution du Conseil scientifique est la deuxième réponse à la défaillance institutionnelle de l’espace francophone des Suds. Paul Petit est convaincu de sa pertinence :
[…] cet informel […] a été compensé par le fait que le Conseil scientifique a pu identifier, désigner, des personnalités de pays représentatifs, i.e. des grands linguistiques, tous universitaires mais dotés de parcours différents. Ce sont des spécialistes qui sont reconnus dans leur pays, dans les sous-régions, et de façon internationale. Cela a permis de garantir qu’il y ait des gens d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, du Liban, etc. (2022, p. 91)
Le dossier presse conçu par la Délégation à l’information et à la communication du ministère de la Culture nous informe que le Conseil scientifique est « Composé d’une quinzaine de membres et présidé par le Professeur Bernard Cerquiglini ». (2021, p. 18) Il se distingue par sa
« base paritaire de chercheuses et chercheurs issus de la francophonie ayant pour tâche de suivre « l’avancée du projet », d’en « valide[r] les étapes » et de « prend[re] les décisions cruciales ». (Ibid., p. 18). Le Compendium du DDF présente le Conseil scientifique comme une volonté présidentielle (Gasparini et al, 2021, p. 31), manifestant le désir français d’ouvrir la coordination du projet à l’ensemble de l’espace francophone. Malgré les efforts constatés, nous observons que la direction demeure aux mains de la France. En effet, la présidence du Conseil scientifique est assurée par Bernard Cerquiglini, linguiste lyonnais. Le coordinateur général n’est autre que Paul de Sinety, président de la DGLFLF. (Idem)
De nouveau, nos entretiens mettent en lumière l’influence de la DGLFLF, qui a eu pour rôle – aux côtés de Bernard Cerquiglini – d’établir les membres du Conseil (Cerquiglini, 2022, p. 11). La constitution finale n’en demeure pas moins représentative de la diversité francophone.
