Le rendement du charbon de bois des meules d’Acacia mangium et Acacia auriculiformis à Ibi-Village est évalué, révélant une productivité faible et des pertes significatives lors de la carbonisation. Ces résultats soulignent l’urgence d’améliorer les techniques de production pour optimiser l’efficacité énergétique.
CHAPITRE I. REVUE DE LA LITTERATURE
Concepts de base
Bois-énergie
Selon l’ONF (2019), l’appellation « bois énergie » désigne l’utilisation du bois à des fins énergétiques pour la cuisine, pour se chauffer, pour l’artisanat (forgerons, boulangers, fabrication huiles végétales, savons, etc.), pour l’industrie (sidérurgie, verrerie, etc.), pour produire du gaz (gazogène) et/ou de la vapeur (énergie industrielle, électricité, etc.). Il peut être d’origine forestière (sylviculture), bocagère, industrielle, paysagère, etc.
Charbon de bois
Dejonc (1894) définit le charbon de bois comme étant un produit obtenu en carbonisant du bois en atmosphère contrôlée par pyrolyse (en l’absence d’oxygène). Le procédé permet d’extraire du bois, par élévation de la température, les fractions liquéfiables (acide pyroligneux) et gazéifiables, son humidité et toute matière végétale ou organique volatile, afin de ne laisser que le carbone et quelques minéraux.
Masse anhydre du bois
L’humidité du bois est définie par la norme EN 13183-1 comme étant le rapport de la masse d’eau contenue dans le bois sur la masse de bois sec (ILNALS, 2002) :
𝐻% =
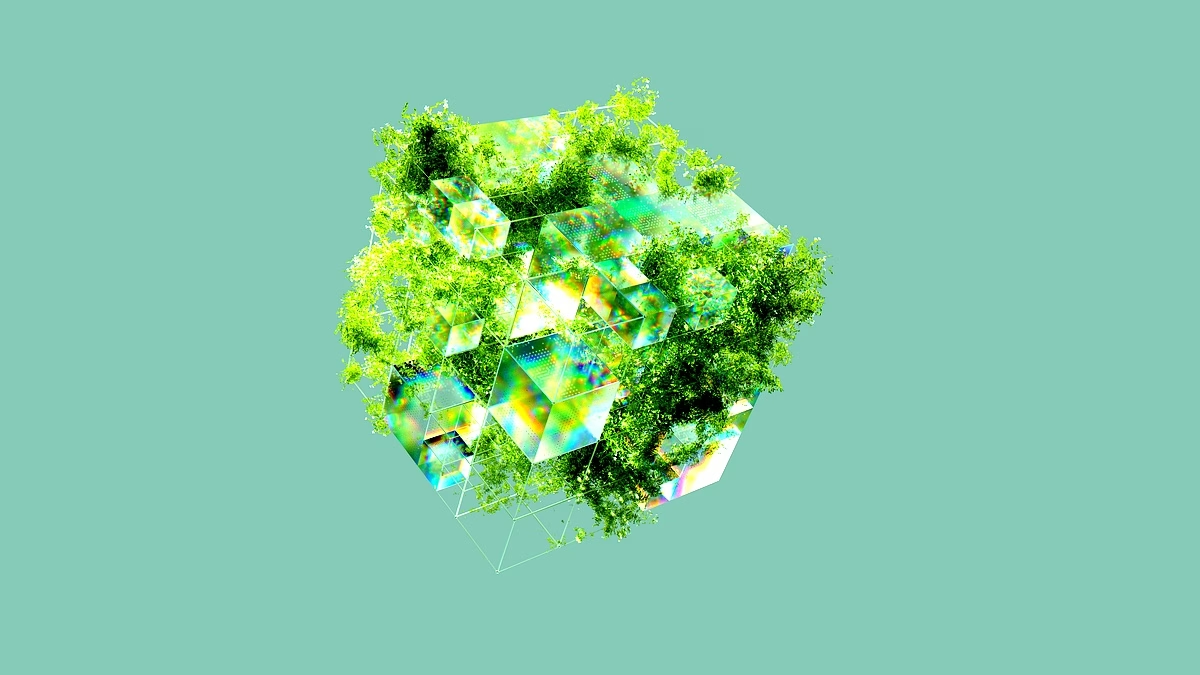
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑏𝑜𝑖𝑠 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑐
La masse anhydre du bois dépend de l’essence de bois considérée, de son taux d’humidité initiale, ainsi que de la méthode de mesure utilisée. En général, la masse volumique anhydre moyenne du bois en Afrique tropicale est d’environ 600 kg/m3 (Chave et al., 2009). Cependant, cette valeur peut varier considérablement selon les essences de bois et les conditions de mesure. Par exemple, la masse volumique anhydre du chêne peut varier de 600 à 700 kg/m3, tandis que celle du sapin peut varier de 400 à 450 kg/m3 (Sell et Kropf, 1990).
Il est important de noter que la masse anhydre du bois peut être utilisée pour calculer la quantité d’énergie contenue dans le bois, car la plupart de l’eau contenue dans le bois est évaporée lors de la combustion. C’est pourquoi la masse anhydre est souvent utilisée pour exprimer le pouvoir calorifique du bois, qui est mesuré en unités de chaleur par unité de masse sèche (par exemple, en BTU/lb ou en kJ/kg) (Auclair et al., 1985). La teneur en humidité du bois ne peut être nulle que s’il est séché jusqu’à 103 °C (± 2 °C pour être au-dessus de la température d’ébullition de l’eau, mais sans pour autant dégrader le bois) (Burgers, 2016).
Production de charbon de bois
Le Robert (2021), dictionnaire français définit la carbonisation comme étant la transformation (d’une substance organique) en charbon, par la chaleur. La carbonisation du bois consiste en la dégradation de trois polymères végétaux, à savoir : la cellulose, l’hémicellulose et la lignine. Elle donne lieu à trois produits : le charbon de bois, une fraction pyroligneuse et la fraction gazeuse (FAO, 1983).
La pyrolyse est la décomposition thermique de la cellulose et de la lignine pour donner du charbon de bois (Louppe, 2014). Elle se produit dans un espace fermé où l’entrée d’air est contrôlée afin que le bois ne soit pas brûlé et réduit en cendres, mais donne du charbon de bois (Louppe, 2012). Le processus de pyrolyse ne démarre que lorsque le bois a été porté à une température d’environ 300 °C. Une fois amorcé, il se poursuit de lui-même en dégageant une quantité de chaleur considérable (FAO, 1983).
Dans le processus traditionnel de carbonisation (meule ou four), une partie du bois est brûlée pour à la fois sécher le reste de la charge et élever la température jusqu’à l’amorçage de la pyrolyse qui, ensuite, se poursuivra d’elle-même (Louppe, 2012). Dans les fours industriels (fours continus), la chaleur dégagée par la pyrolyse permet de produire du charbon de bois de haute qualité avec un rendement élevé. Les gaz combustibles qui se dégagent du bois lors de la pyrolyse sont brûlés pour fournir un apport de chaleur compensant les pertes par les parois et autres parties du four, et pour sécher le bois entrant (Louppe, 2014).
Lorsque la pyrolyse est achevée on laisse le charbon, qui a atteint environ 500 °C, se refroidir à l’abri de l’air. Ensuite on peut décharger le four en toute sécurité. Le charbon est prêt à l’emploi.
Louppe (2012) souligne que le processus de pyrolyse produit du charbon de bois composé principalement de carbone, d’un résidu goudronneux en petite quantité et de cendres. Se dégagent lors du séchage et de la décomposition pyrolytique du bois des gaz combustibles, des goudrons, un certain nombre de composés chimiques (principalement l’acide acétique et le méthanol) et une quantité importante d’eau sous forme de vapeur. Le tableau 1 présente les réactions qui se produisent lors de l’élévation de la température, d’après Louppe (2014).
| Tableau 1. Augmentation de la température et réactions physico-chimiques du bois (Louppe, 2014) | |
|---|---|
| Température | Réactions physico-chimiques du bois |
| < 160 °C | Séchage du bois (perte en vapeur d’eau, d’où les fumées blanches) |
| < 200 °C | Brunissement, entraînement de composés gazeux volatiles par la vapeur d’eau (ex : acide acétique). |
| < 270-280 °C | Torréfaction (bois torréfié). Dégagement de CO, CO2, vapeur, acide acétique, méthanol (gaz oxygénés) et goudrons légers. Combustion partielle (cendres). |
| < 350-380 °C | Pyrolyse (charbon de bois). Dégagement de gaz oxygénés en quantité moindre et hydrocarbures légers (méthane, éthane, éthylène) et goudrons légers. Combustion partielle (cendres). Fumées jaunâtres, denses et à l’odeur de vinaigre. On obtient du charbon à 65-70% de carbone pur, 3-5% de cendres et le reste en résidus goudronneux. |
| < 400 °C Chauffage artificiel | Pyrolyse (charbon de bois) et décomposition des goudrons qui augmente la teneur en carbone pur. |
| < 500 °C Chauffage artificiel | Pyrolyse (charbon de bois) et décomposition des goudrons. Le pourcentage de carbone pur atteint 85%, la teneur en éléments volatils 10%. Rendement sur masse anhydre de 33% hors bois utilisé pour lancer la carbonisation. |
| < 700-900 °C Chauffage artificiel | Pyrolyse (charbon de bois). Départ d’hydrogène (enrichissement des gaz). Jusqu’à 90-95% de carbone pur. |
Facteurs influant le rendement de la carbonisation
De nombreux paramètres influent sur le résultat d’une carbonisation. Ces informations sont confirmées par nombreux chercheurs notamment Girard (1992), Schenkel et al, (1997) et Wanjira et al., (2021). Les plus importants sont les suivants : la température, la rapidité du processus, le taux d’humidité, l’essence utilisée, la technique suivie, le savoir-faire de l’opérateur, les conditions météorologiques.
Techniques de carbonisation en meules
Depuis l’Antiquité, le charbonnier savait qu’il fallait chauffer le bois à une certaine température, pas trop élevée, et en évitant de l’enflammer, car sinon il en résulte des cendres ou un charbon de bois de mauvaise qualité (Dejonc, 1894). Lepoivre (1940) souligne que si l’on tente de carboniser du bois à l’air libre, donc en présence d’oxygène en excès, le carbone qu’il contient sera entièrement oxydé, et il ne restera que des cendres (résidu blanc) au pouvoir calorifique nul.
C’est pourquoi, la carbonisation doit avoir lieu dans une enceinte fermée à l’abri de l’air. Néanmoins, pour fournir l’énergie nécessaire à la phase endothermique de la pyrolyse, on laisse pénétrer une petite quantité d’air afin d’oxyder (brûler) une fraction du bois. Raison pour laquelle les évents (ouvertures d’admission d’air et de sortie des fumées) sont creusés dans les meules pour faciliter la pénétration de l’air (Louppe, 2012).
Cette opération se fait à l’emplacement même où le bois est coupé, c’est-à-dire dans la forêt (Dejonc, 1894)
Types de meules
De manière classique, les meules sont classées en trois types : la meule verticale traditionnelle, la meule horizontale et la meule améliorée, représentée dans la majorité des cas par la meule casamançaise (FAO, 1983 ; Briane et Doat, 1985)
- Meule verticale traditionnelle est celle constituée de bois disposés verticalement autour d’un pieu central et des petits bois (brindilles) soigneusement rangés dans les interstices. Une fois que la meule est réalisée, le pieu central se voit être retiré afin de manager une cheminée. Le recouvrement est composé de matière végétale (herbe, paille et branchage) surmontée d’une couche de terre sableuse ou limoneuse.
L’allumage de la charge s’effectue au centre de la charge en laissant tomber des braises dans la cheminée. Après que le feu soit monté dans cette cheminée, la carbonisation peut durer 50 heures pour les petites meules (<10 stères). Quant au refroidissement, il peut durer quelques jours (Schenkel, 1997).
- Meule horizontale : elle est très proche du précédent en ce qui concerne la couverture et la conduite. Elle se diffère néanmoins par sa forme semblable à un demi- cylindre aplati et du fait que le bois est rangé à l’horizontale et le front de carbonisation se déplace d’une extrémité à l’autre de la meule.
Cette meule a comme avantage qu’elle est mobile (tout terrain), elle exige moins d’investissement initial et qu’elle peut carboniser même les gros bois sans refente. L’exigence de la qualification de l’opérateur, la nécessité de beaucoup de main d’œuvre, la production de charbon de bois de qualité variable, la sensibilité aux aléas climatiques, le rendement énergétique faible et la pollution importante (en fumée) sont parmi les désavantages de ce type de meule (Schenkel, 1997).
- Meules améliorées : La meule améliorée la plus largement diffusée est la meule casamançaise. Elle présente plusieurs évolutions destinées à améliorer, à accélérer et à faciliter la carbonisation et sa conduite (FAO, 1983). Sa construction exige une bonne circulation de l’air (plancher de petits bois et aménagement d’évents à l’aide de tuyaux situés à la base de la meule) ainsi qu’un rangement préférentiel des rondins (petits bois à la périphérie et gros bois au centre de la meule). La couverture quant à elle ne subit pas de modifications par rapport aux meules traditionnelles (Mundhenk et al., 2010).
Cependant, la principale amélioration consiste en l’utilisation d’une cheminée fabriquée à partir de matériaux peu onéreux (vieux fûts de 200 litres ou tuyaux métalliques). Elle permet une carbonisation plus rapide et une conduite plus aisée en forçant la circulation des gaz. De plus, les rendements seraient améliorés grâce au tirage inversé. Une meule de 100 stères nécessite 3 jours de carbonisation et 4 jours de refroidissement
Carbonisation à Ibi-Village
A Ibi-Village, comme dans la majorité des zones des pays en développement, les méthodes de carbonisation traditionnelles demeurent les principales utilisées pour la fabrication de charbon de bois (Schenkel, 1997 ; PNUD-RDC, 2022).
Les charbonniers y construisent les meules horizontales qui ne nécessitent que très peu d’investissements mais exigent par contre un savoir-faire et une main d’œuvre importants pour ranger les bois pendant le montage. Les bois de ces meules sont, soit empilés directement sur le sol, soit enterrés dans une fosse creusée préalablement. Cette dernière technique (enterrement du bois) n’est pas souvent utilisée. Les charbonniers y recourent si le besoin en charbon de bois est urgent car elle réduit considérablement la durée de la carbonisation.
Il est à noter que le rendement de cette technique est faible (Schenkel et al., 1997 ; Wanjira et al., 2021 ; Schure et al., 2021) car une partie du bois est brûlée pour fournir l’énergie nécessaire à la carbonisation dans sa phase endothermique, et les fumées contenant la moitié du pouvoir calorifique initial du bois de la meule sont libérées dans l’atmosphère (Louppe, 2012). En plus de représenter une grosse perte d’énergie, cette libération de fumées toxiques est très polluante pour l’environnement et pour l’homme (CERIC, 2017). De plus, une partie importante du charbon est perdue sous forme de particules trop fines (fines et braisettes) pour être exploitée directement, car mélangée à la terre (FAO, 1983).
Quelques jours après la phase d’allumage, le changement de couleur de la fumée virant au jaune foncé puis au bleu-gris montre que la carbonisation est complète (Guégan, 2013). Il faut alors attendre le refroidissement de la meule pour extraire le makala. Cela doit se faire aussi rapidement que possible pour éviter l’auto-combustion communément appelé « feu retour » par les charbonniers.
Pendant le défournement, les incuits (bois non brûlés) sont souvent constitués des rondins qui constituaient le lit de la meule de carbonisation. La présence de beaucoup d’incuits démontre que les étapes de la conduite de la carbonisation n’ont pas été scrupuleusement respectées.
La durée de carbonisation varie en fonction du taux d’humidité du bois, de la dimension des rondins, de la taille de la meule, de l’essence et des conditions climatiques. La durée de carbonisation augmente avec la grosseur de la meule. Assez souvent, elle s’étend entre 1 et 4 semaines (Temmerman et al., 2019).
Les étapes de la conduite de la carbonisation employées à Ibi-Village (disposition des rondins, la durée du séchage des bois, etc.) avoisinent celles de la meule casamançaise qui est une technique de carbonisation améliorée mais diffèrent par l’absence de cheminée et d’évents métalliques pour les meules d’Ibi.
État de connaissances
La consommation du bois énergie, en particulier de charbon de bois, est prédominante dans les villes de la RDC (Schure et al., 2011 ; Dubiez et al., 2022) en raison de la croissance rapide de la population, de l’exode rural et bien d’autres facteurs, entraînant un déséquilibre croissant entre l’offre et la demande et mettant en péril la pérennité des écosystèmes forestiers (Marien et al., 2013).
Une étude menée par Dubiez et al. (2022) révèle que près de 98% des ménages de la ville province de Kinshasa utilisent régulièrement le charbon de bois comme source d’énergie, en raison notamment du faible revenu des ménages et des limitations de production d’électricité. La distribution électrique en RDC ne couvre que 1% des zones rurales et 30% des zones urbaines, avec une moyenne nationale de 9%, bien inférieure à la moyenne africaine de 24,6% (ARE-RDC, 2022 ; Banque Mondiale, 2023).
La desserte électrique dans la ville province de Kinshasa atteint à peine 60%, ce qui pousse une grande majorité de la population à se tourner vers le bois de chauffe et le charbon de bois pour répondre à leurs besoins énergétiques (Olenga, 2011 ; PNUD-RDC, 2022).
Environ 600 000 et 90 000 personnes seraient employées respectivement dans les filières charbon de bois et bois de chauffe pour leur approvisionnement (Dubiez et al., 2022). La ville province de Kinshasa s’approvisionne principalement dans les provinces du Kongo central, Kwilu, Kwango, Maï Ndombe et Équateur (Dubiez et al., 2022). Seulement 8,7% du charbon de bois vendu par les commerçants provient des plantations forestières (Dubiez et al., 2022).
Pour ce qui est de l’évaluation de la carbonisation, il est à noter que les rendements en carbonisation traditionnelle en RDC et particulièrement sur le plateau des Batékés sont très variables, suite aux nombreux facteurs qui influent sur eux, mais une majorité de la communauté scientifique s’accorde à dire que l’ensemble de ces techniques présente des rendements faibles (Schenkel, 1996; Ndiaye et al., 2004 ; Schure et al., 2021) et ce, sans des chiffres clairs et nets ; puisque les charbonniers ne s’attardent pas à peser la masse de bois entrant et celle du charbon de bois obtenu car ce ne sont pas des paramètres nécessaires pour eux (Maurice et Le Crom, 2011). Cela pose donc des sérieuses difficultés pour évaluer les rendements de la carbonisation. Les études menées par le Projet Makala (2012) sur le plateau des Batékés ont démontré par exemple que le rendement brut de la carbonisation varie entre 15 et 26%.
Ce qui justifie l’intérêt de la présente étude.