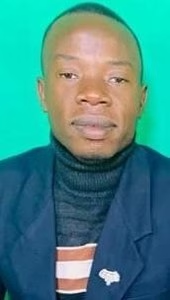Le principe de légalité en droit public impose à l’administration de respecter l’ensemble des règles juridiques dans son fonctionnement. Cet article explore les implications de ce principe à travers divers domaines du droit, soulignant son importance pour la légitimité des actions administratives.
Principe de légalité
La légalité s’entend comme l’ensemble des règles que l’administration doit respecter dans son propre fonctionnement. Non seulement les règles du Droit administratif et du Droit constitutionnel, mais aussi celles du Droit fiscal, du Droit pénal, du Droit social, du Droit commercial et pour ne citer que ceux-là1. Ceci dit, selon Jean-Claude RICCI, le principe de légalité veut que l’Administration, c’est-à-dire ceux qui agissent en son nom, doit respecter les règles de droit.
Ainsi, dans un État où la loi est la règle suprême, tout doit lui être subordonné, l’Administration y comprise2. C’est l’avènement du concept « État de droit », devenu de nos jours très célèbre et populaire dans le langage des hommes et femmes politiques pour acquérir aveuglément la confiance du peuple.
Il signifie que les gouvernants et gouvernés sont tous soumis à la loi. C’est-à-dire, un système institutionnel au sein duquel la puissance publique est aussi soumise au droit. En effet, selon Hans KELSEN, l’État de droit c’est un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée.
C’est- à-dire, l’État crée son propre droit, son propre ordre juridique objectif, pour ensuite s’y soumettre lui-même3. Cependant, dans le souci de garantir la continuité des services publics ou de l’État, le principe de légalité peut connaître un assouplissement et parfois violer pour ce motif susvisé. Ce qui est résulté, en effet, dans l’élaboration de l’acte administratif unilatéral, celui-ci s’effectue suivant les exigences de la légalité externe et celles de la légalité interne.
Tout d’abord, pour les exigences de légalité externe, elles sont relatives à la compétence de l’auteur de l’acte et aux formes et formalités. Mais ce qui nous intéresse plus, c’est la compétence de l’auteur de l’acte administratif. En effet, la compétence de l’auteur de l’acte s’apprécie en rapport avec les attributions qui lui sont conférées, on parle de la compétence ratione materiae; de l’espace géographique sur lequel s’étend son pouvoir, on parle de la compétence ratione loci et avec la période de temps sur laquelle s’exerce ce pouvoir, on parle enfin de la compétence ratione temporis. Dans tous les cas, l’auteur de l’acte doit être régulièrement investi du pouvoir de décision. Ainsi, le principe est : « Pas de compétence en dehors d’une investiture régulière »4. Cependant, l’exception à ce principe s’exprime dans la théorie du fonctionnaire de fait.
Cette théorie trouve son application en cas de carence absolue de l’autorité régulière alors que doit être assurée la continuité des services publics ; en cas de nécessité, en période de circonstances exceptionnelles, mais aussi en raison de l’apparence d’investiture plausible aux yeux des tiers de bonne foi. Dans ce dernier cas, il s’agit de protéger les droits des tiers de bonne foi qui ont cru avoir eu affaire à une autorité régulièrement investie pour des raisons de sécurité juridique5.
Citons également la suppléance et l’intérim dans les exceptions du principe de légalité (externe). En effet, la suppléance et l’intérim sont des institutions qui permettent de répondre à la nécessité de surmonter les conséquences de l’absence ou de l’empêchement de l’autorité compétente6. Cela afin de garantir la continuité des services publics. Ainsi, pendant que la suppléance est prévue et organisée par un texte législatif ou réglementaire qui désigne l’autorité qui l’assurera, quand il y aura lieu. L’intérim, quand lui n’est pas prévu par un texte en principe. Il est institué de façon improvisée par décision de l’autorité supérieure à celle qu’il s’agit de remplacer temporairement, et cela par le simple fait de la désignation de l’intérimaire. L’autorité supérieure procède à cette désignation sans être tenue de respecter les conditions de forme et de fond prévues pour l’accès normal à la fonction dont il s’agit d’assurer la continuité. En plus de la désignation de l’intérimaire, elle détermine la durée et l’étendue de ses pouvoirs. Elle peut se charger elle-même de l’intérim.
Enfin, pour les exigences de la légalité interne; c’est le fond même de l’acte que le juge aura à examiner, s’il y a violation de la règle de droit et détournement de pouvoir7. Ainsi, certaines exceptions à ce principe de légalité interne peuvent se justifier pour garantir la continuité de l’État ou des services publics. Il peut s’agir de la théorie des circonstances exceptionnelles (a) et de la théorie de l’urgence(b).
Théorie des circonstances exceptionnelles
Il existe un principe en droit administratif, selon lequel : « Dans les circonstances exceptionnelles, des solutions exceptionnelles ». Il découle de ce principe que lorsque l’administration fait face à une situation anormale et exceptionnelle dans sa gestion, il lui est permis de faire recours à une solution exceptionnelle également pour résoudre le problème que causerait cette situation.
En effet, la théorie des circonstances exceptionnelles a été créée par la jurisprudence du Conseil d’État, dans l’Affaire HEYRIES, en soulignant qu’il s’agit des circonstances dans lesquelles la légalité normale devient tellement une légalité inadaptée, par conséquent, il faut lui substituer provisoirement une légalité d’exception8. Ainsi, certains actes administratifs qui seraient en temps normal illégaux peuvent devenir légaux en certaines circonstances puisqu’ils apparaissent alors nécessaires pour assurer la continuité de l’État et l’ordre public9. Cette théorie se justifie par le fait que l’administration est parfois obligée d’agir pour faire face à certaines situations graves ou imprévisibles qui menaceraient son fonctionnement régulier. Cela sans pouvoir respecter les règles classiques de la légalité puis qu’il y a nécessité et urgence10. À cet effet, le juge administratif tolèrera, en effet, des manquements à des règles des formes ou de procédure voire certaines règles de compétences. Ainsi, l’administration pourra se voir dispensée de respecter les formes normales. De même les autorités administratives pourront prendre légalement des décisions en dehors de leur domaine de compétence11.
Théorie de l’urgence
Au-delà de la théorie des circonstances exceptionnelles vue précédemment, l’urgence joue également un rôle autonome, pouvant à elle seule justifier d’irrégularités des certains actes administratifs. À ce sujet, affirme René CHAPUS: « lorsque dans les circonstances de temps et de lieu normaux, il y a urgence à agir, l’acte accompli pourra être régulier dans le cas où, la faute pour l’administration de pouvoir exciper de l’urgence, il aurait été irrégulier »12.
Ainsi, la violation de règles de formes, empiètement de compétences et autres violations, sera justifiée du fait de l’existence d’urgence. Tel serait le cas d’une autorité de police ou de l’autorité de l’armée qui pourra intervenir par tout moyen approprié quand il est urgent, soit de faire cesser les violations ou des troubles graves à l’ordre public, soit pour défendre l’intégralité du territoire national et pour ne citer que ceux-là.
Par ailleurs, cette urgence peut être officiellement déclarée par une autorité administrative habillée. On parle dans ce cas de l’état d’urgence. En effet, l’état d’urgence est une situation de fait décidée par l’exécutif et proclamée par le Président de la République en cas de péril imminent dans un État, empêchant le fonctionnement régulier des institutions de la République. À cet effet, il justifie un régime juridique exceptionnel, mais temporaire, au cours duquel certaines mesures qui ne s’expliqueraient pas en temps normal sont adoptées par l’autorité administrative13.
En RDC, l’état d’urgence est mentionné à l’article 85 de la Constitution du 18 février 2006. Selon cette disposition, le Président de la République proclame l’état d’urgence lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions14. Ceci mérite d’être souligné sans doute, car le constituant congolais affirme que l’état d’urgence ou la théorie d’urgence se conçoit aussi pour éviter qu’il y ait l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, d’où, cette théorie permet d’assurer la continuité des institutions de l’État ou des services administratifs qui y sont attachés. Tel était le cas l’ordonnance n° 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19 et confirmer ainsi sa légalité exceptionnelle.
Enfin, dans la pratique, l’urgence est devenue une notion clé, puisqu’elle s’est substituée dans le référé suspension. C’est pourquoi, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif par le juge lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette urgence peut constamment faire l’objet d’une nouvelle appréciation si un fait nouveau se produit15. À tout état de cause, il appartient au juge administratif saisi, de terminer s’il y a réellement urgence.
Le régime des contrats
Le principe de la continuité des services publics peut être observé dans la conclusion du contrat administratif. En effet, dans le domaine des contrats administratifs, la continuité est garantie par trois éléments : la mutabilité des contrats, qui permet à la personne publique de modifier unilatéralement les clauses du contrat pour les besoins du service. Enfin, le principe de continuité du service public est le fondement principal de la théorie de l’imprévision qui prévoit que, si des événements imprévus bouleversent l’équilibre du contrat au point que le cocontractant ne puisse continuer à assurer le service sans ruine, la personne publique est tenue de lui allouer des fonds compensatoires16.
Nous savons déjà que le pouvoir d’agir d’une autorité s’exerce avec l’entrée en fonction et cesse avec la désinvestiture sauf la nécessité d’expédier les affaires courantes, nous analyserons dans les lignes qui suivent la notion d’affaires courantes.
________________________
1 J. BOUVIER, Eléments fondamentaux de droit administratif, Paris, Lextenso, Avril 2011, p.11. ↑
2 J. RICCI, Op.cit., p.16. ↑
3 HANS KELSEN, Théorie pure du droit, Traduction française, 2è Ed., Paris, Dalloz, 1962, pp.404-410. ↑
4 F. VU NDUAWE te PEMAKO, Op.cit., pp.683-689. ↑
5 BOTAKILE BATANGA, Précis du contentieux administratif congolais, tome 2, Bruxelles, Academia, 2014, p.75. ↑
6 J. MORAND-DEVILLER, Op.cit., p.399. ↑
7 J. RICCI, Op.cit., p.287. ↑
8 CE, arrêt de Heyriès du 28 juin 1918, cité par M., ROUSSET et O., ROUSSET, Droit administratif I, l’action administrative, 2e éd., Presses Universitaires de Grenoble, 2004, p. 70. ↑
9 J. MASSOT, « Le Conseil d’État face aux circonstances exceptionnelles », in Cahiers de la justice, N°2, février 2013, p. 6. ↑
10 M. ROUSSET et O. ROUSSET, Droit administratif I, l’action administrative, 2e éd., Presses Universitaires de Grenoble, 2004, p.71. ↑
11 CE. France, Affaire Baudet, 31 mars 1954, cité par J., MARCHAL « Circonstances exceptionnelles en droit administratif » in Réseau Francophone de Diffusion du Droit, N°17, Juin 2014, p.2. ↑
12 RENE CHAPUS, Droit administratif, Paris, Montchrestien, 2000, p.139. ↑
13 GRACE MUWAWA LUWUNGI, « L’état d’urgence et la théorie des circonstances exceptionnelles en droit congolais. Analyse critique de l’arrêt R.const. 1200 de la Cour constitutionnelle. Analyse comparée droit congolais-droit français », in légalRDC, p.3. ↑
14 Art. 85, Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, in J.O. RDC, 52e année, n° spécial, Kinshasa, février 2011, p.31. ↑
15 J-M PONTIER, « L’urgence », in HAL, disponible sur : https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02119717, consulté le 3 janvier 2023, pp.1-7. ↑
16 CE., 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec.125, RDP 1916, p.206. ↑