La politique linguistique française est réévaluée à travers l’analyse du Dictionnaire des francophones, un outil novateur issu de la Stratégie internationale pour la langue française. Cet article aborde les enjeux de gouvernance linguistique et la lutte contre la glottophobie dans le contexte politique français.
[img_1]
Partie Ⅰ
Un renouvellement fondamental des politiques linguistiques du français
Chapitre 1
Le DDF : acteurs et processus d’une commande d’État
Un dictionnaire se distingue selon qu’il soit élaboré par une entreprise privée telle que Richelet, Furetière, les Maisons Larousse ou Robert ou par une institution gouvernementale. L’État français a passé, au cours de l’histoire, trois commandes officielles : le Dictionnaire de l’Académie française en 1694, le Trésor de la langue française en 1962 et le Dictionnaire des francophones en 2018. Ainsi, le Dictionnaire des francophones relève de la lexicographie institutionnelle, qui caractérise les « travaux subventionnés par l’État » (Pruvost, 2021, p. 84).
Section 1 :
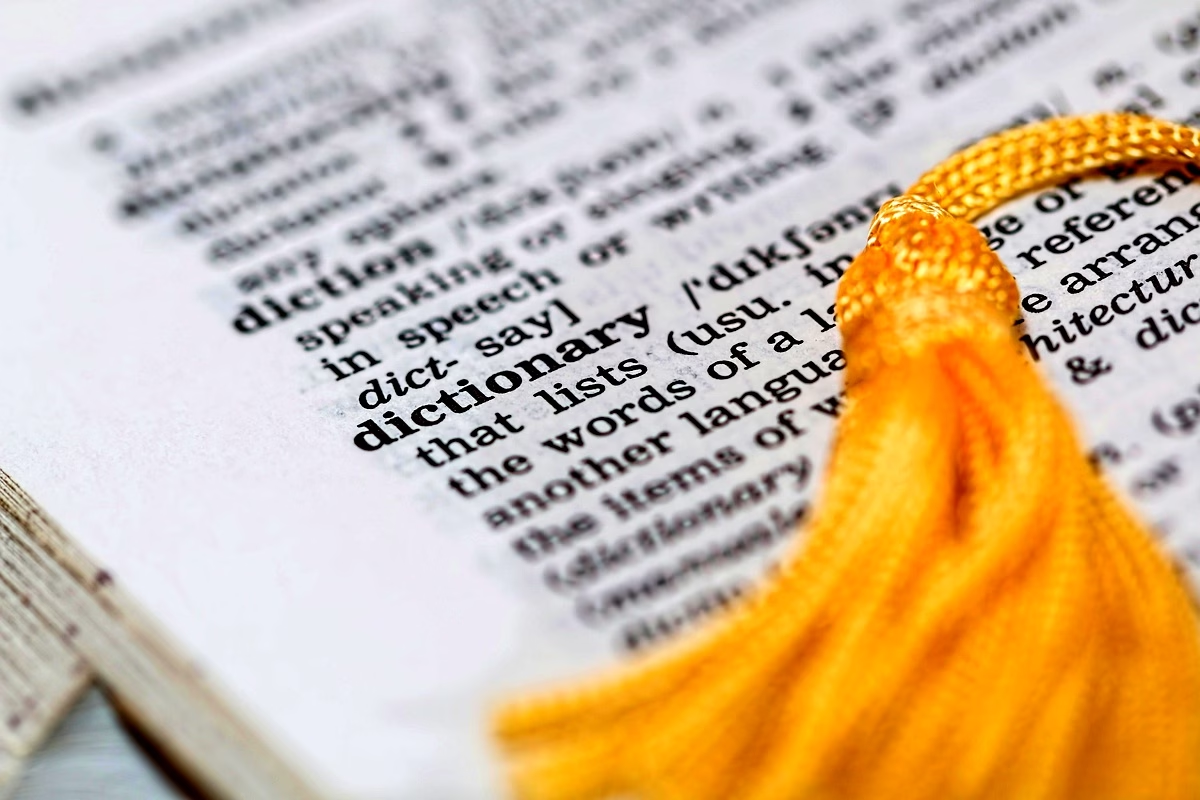
Examen du plan d’action impulsé
[img_2]
Source : Gasparini, N. (2021c, 3 mars). La langue est politique a [Diapositive]. Formation « La langue est politique », Masters Francophonie, Université Jean Moulin Lyon 3.
A-Une politique linguistique française en rupture avec les précédentes
Caractériser une politique linguistique
Avant de détailler les attributs de la politique linguistique à la source du DDF, il nous semble nécessaire de passer en revue les différents courants théoriques ayant fait état de cette notion. Il s’agit, ce faisant, d’invalider « l’idée préconçue de l’inutilité d’une action concertée sur la langue » (Rey, 2007, p. 22), préjugé d’autant plus coriace que l’« on parle assez peu, en France, de politique ou de planification linguistiques » (Calvet, 1999, p. 246).
Le concept de politique linguistique a été théorisé dans la seconde moitié du XXème siècle. Il tire sa source de l’expression language planning, avancée par Einar Haugen – linguiste américain – lors d’une publication en 1959 faisant état de la situation linguistique en Norvège. Son origine tient également de la tournure language policy, proposée en 1970 par Joshua Fishman, également linguiste américain (Calvet, 1999, p. 154).
La politique linguistique, dans son acception la plus simple, désigne toute intervention sur une langue donnée (Calvet, 2021). Il est question de « l’ensemble des choix conscients effectués dans le domaine des rapports entre langue et vie sociale, et plus particulièrement entre langue et vie nationale » (Calvet, 1999, pp. 154-155). Halaoui élargit cette définition en considérant que la politique linguistique est indissociable de son application. Elle est pour lui « une œuvre de conception, la conception théorique sous-jacente à la réalisation d’un ensemble d’actions entreprises sur la langue » (2011, pp. 20-21). Nous ferons appel à cette définition lors de notre analyse, puisqu’elle permet de lier la création du DDF à sa production.
Chaudenson circonscrit également une politique linguistique à sa mise en œuvre. Si sa mission première est de « prendre les décisions majeures, supranationales ou nationales », il la délimite comme un « étage de l’intervention » gouvernementale (Chaudenson 1989, pp. 100-101, 1996, p. 116, dans Halaoui, 2011, pp. 20-21). Louis-Jean Calvet et de St Robert adhèrent à ce bornage spatial, estimant que loin d’être uniquement visible à l’échelle nationale, une politique linguistique peut transcender les frontières (1999, p. 154 ; 2000, p. 7). Une grille de lecture adéquate pour étudier la francophonie en tant qu’entité territoriale discontinue. Cette perspective rejoint le bornage spatial de notre recherche : le DDF est un objet transfrontalier puisqu’il véhicule sciemment une langue qui se veut déterritorialisée. Ngalasso, quant à lui, préfère – sans toutefois nier l’existence de politiques linguistiques transfrontalières – mettre davantage l’accent sur sa retombée nationale.
Elle est, à ses yeux, partie prenante « de la politique générale d’un pays » et constitue, de fait, « un attribut de la souveraineté des nations » (Ngalasso, 1989, p. 116, dans Halaoui, 2011, pp. 34-35). La dimension politique est mise en exergue par Louis-Jean Calvet lorsqu’il parle de « gestion in vitro » de la langue, laquelle consiste en l’« intervention directe et volontaire du pouvoir politique dans le domaine linguistique » (1999, p. 153). Cette précision nous permet de mettre en relief le choix politique conscient dont le DDF est issu. Le chercheur avance que les choix effectués par le corps politique sont précédés de l’intervention de linguistes, qui ont à charge d’analyser les problèmes inhérents à une langue et d’établir des prospections quant à leur futur (Calvet, 2021).
Les sujets traités dans le cadre d’une politique linguistique peuvent – d’après la distinction établie par le linguiste allemand Heinz Kloss – se scinder en deux grands ensembles : les politiques inhérentes au corpus, et celles inhérentes au statut (1969, dans de St Robert, 2000, p. 9 et Calvet, 2021). Le corpus concerne la forme de la langue, i.e. sa norme standard, sa graphie ou encore son lexique. Le DDF est le fruit d’une politique de corpus puisqu’il concerne les variations lexicales du français. Le statut se réfère au positionnement d’une langue vis-à-vis d’autres langues, dans une société donnée ou au sein d’une organisation internationale. Il est ici question, par exemple, d’octroyer à une langue le statut de langue officielle.
Louis-Jean Calvet s’accorde à dire que les objectifs mobilisés avec le plus de récurrence sont « la modernisation (du lexique, du système graphique), la défense ou l’expansion d’une langue, les rapports entre langues, le développement, la volonté d’unifier linguistiquement un pays, etc. » (Idem)
Halaoui s’appuie sur une autre typologie en conférant à la politique linguistique deux acceptions : la première, législative, relève de la « loi linguistique, texte juridique régissant la langue et voté par une assemblée représentative ou de (la) législation linguistique, ensemble des lois et des règlements concernant la langue et relatif en principe à un pays » (2011, p. 21). Le « versant juridique ou légal » est également reconnu dans les travaux de Calvet (2021). À cela s’ajoute l’acception « large », dirigée vers l’ensemble des actions entreprises sur la langue, qu’elles soient ou non entérinées par un corpus législatif (Halaoui, 2011, p. 23). C’est de ce sens dont il sera question dans notre recherche.
Effectivement, le DDF ne s’inscrit dans aucun corpus législatif. La politique linguistique est alors appréhendée comme « un argumentaire, entendu comme une organisation systémique d’arguments, dont l’objectif est de faire adopter un certain nombre de propositions d’actions » (Ibid., pp. 34-35).
Par ailleurs, Halaoui reconnaît quatre caractéristiques à une politique linguistique : orientation, champ, secteur, durée (2011, p. 37). On distingue l’orientation d’une politique linguistique en la comparant aux politiques antérieures. Le champ consiste en l’« espace géographique d’intervention : international, national, régional, sous-régional ou local » (Idem). Pour le DDF, le champ se borne à la linguasphère francophone. Le secteur désigne le domaine au sein duquel la politique est appliquée; ici la lexicographie institutionnelle. La durée est celle sur laquelle l’État s’engage. Pour le DDF, aucune durée fixe n’a été officialisée. S’ajoutent aux caractéristiques susmentionnées les composantes. Selon Halaoui, une politique linguistique comprend trois éléments majeurs : « les assises, les objectifs et la stratégie » (2011, p. 46). Nous détaillerons le plan stratégique Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme dans la partie A.3 de notre réflexion. Enfin, une politique linguistique peut être explicite ou implicite puisqu’il « n’est pas nécessaire qu’elle soit écrite ou proclamée pour exister » (Ibid., p. 39). Elle est déclarée explicite « quand sont clairement présentés, dans le cas le plus simple, ses objectifs, la justification de ceux-ci et les modalités de leur réalisation » au sein de « plusieurs documents rendus publiques » (Ibid., p. 40). C’est le cas du DDF qui s’inscrit dans plusieurs discours officiels. Alain Rey rejoint cette position. Selon lui, une politique linguistique peut-être « masquée ou explicite, souple ou institutionnelle » (2007, p. 22).
Une politique linguistique ne peut avoir cours sans portage économique. C’est pourquoi il est primordial de « décider des moyens logistiques (en argent, en matériel, en personnel) à mettre en œuvre pour rendre opérationnels des choix ainsi faits (Ngalasso 1986, p. 7 dans Halaoui, 2011, p. 24). Marie-Josée de Saint-Robert fait valoir la dimension transversale d’une politique linguistique, qui, loin d’être le fait d’un seul ministère, est associée « aux politiques économique, sociale, culturelle » (2000, pp. 24-25).
Les termes aménagement linguistique, planification linguistique, glottopolitique sont parfois employés comme variations terminologiques de la locution politique linguistique (Ngalasso 1989, p. 111, dans Halaoui, 2011), « non sans quelques nuances » comme le souligne De St Robert (2000, p. 9). À titre d’illustration, Guespin et Marcellesi entendent par glottopolitique « les diverses approches qu’une société a de l’action sur le langage » (1986, p. 5, dans Calvet, 2021).
Notre revue de littérature s’enrichit de deux schémas illustrant les débats théoriques susmentionnés. Le premier, conçu par Halaoui, décrète trois composantes à une politique linguistique : les assises, les objectifs et la stratégie (2011, p. 46). Le second, présenté par Calvet, accentue la distinction à faire entre politique et planification linguistique (1999, p. 157) :
[img_3]
Source : Calvet, L.-J. (1999). Politique linguistique [Schéma]. La guerre des langues et les politiques linguistiques, 157.
[img_4]
Source : Halaoui, N. (2011). Les composantes de la politique linguistique [Schéma]. Politique linguistique : faits et théorie, 46.
À la lumière de l’état de l’art réalisé ci-dessus, force est de constater que la langue – ici le français – peut faire l’objet d’un programme d’action (Rey, 2007, p. 72). Si l’on s’en tient à la lecture de Rey et d’Halaoui, qui mentionnent tous deux l’existence d’une « politique […] du dictionnaire » (2007, pp. 260-261) et d’actions portées sur certains « ouvrages de référence (grammaires, dictionnaires (…)) » (2011, p. 48), le Dictionnaire des francophones peut-être analysé au prisme de la politique linguistique l’ayant porté. Il est le fruit d’une « conception » et « d’un ensemble d’actions entreprises sur la langue » (Halaoui, 2011), transcende les frontières nationales selon la conception de Calvet et St Robert, résulte d’une « intervention directe et volontaire du pouvoir politique » (Calvet, 1999), se définit comme une politique de corpus selon la classification de Heinz Kloss, n’est pas entériné par un corpus législatif (2011, p. 23).
