La comparaison des dictionnaires francophones révèle les atouts du Dictionnaire des francophones (DDF) face à ses homologues, notamment en matière de gouvernance linguistique et de lutte contre la glottophobie. Cette analyse met en lumière les différences clés avec le dictionnaire Usito et souligne l’importance de cet outil numérique.
- Rendre compte de la plus-value du DDF sur ses homologues
Les entretiens que nous avons menés permettent d’identifier les similitudes et différences présentes entre le DDF et d’autres dictionnaires. Une analyse comparative qui démontre la pertinence d’avoir introduit un nouvel outil numérique en 2018. Nous tirons de notre entrevue avec l’OQLF une différence essentielle entre le dictionnaire Usito, porté par l’Université de Sherbrooke et le DDF.
Tandis que le premier « vise essentiellement à recenser la langue standard en usage au Québec », le second « vise plutôt à tenir compte du français en usage dans toute la francophonie, et constitue un ouvrage collaboratif » (2022, p. 80). Pour Jean-Marie Klinkenberg, un point de connexion entre le DDF et les maisons privées Larousse et Robert se trouve dans la volonté d’inclure les variations géographiques de français.
Le Larousse a introduit des belgicismes dès les années 1980, alors que le linguistique y siégeait en tant que conseiller permanent. Néanmoins, les variations diatopiques relèvent davantage de l’exception et de l’anecdote alors que le DDF en a fait son axe central.
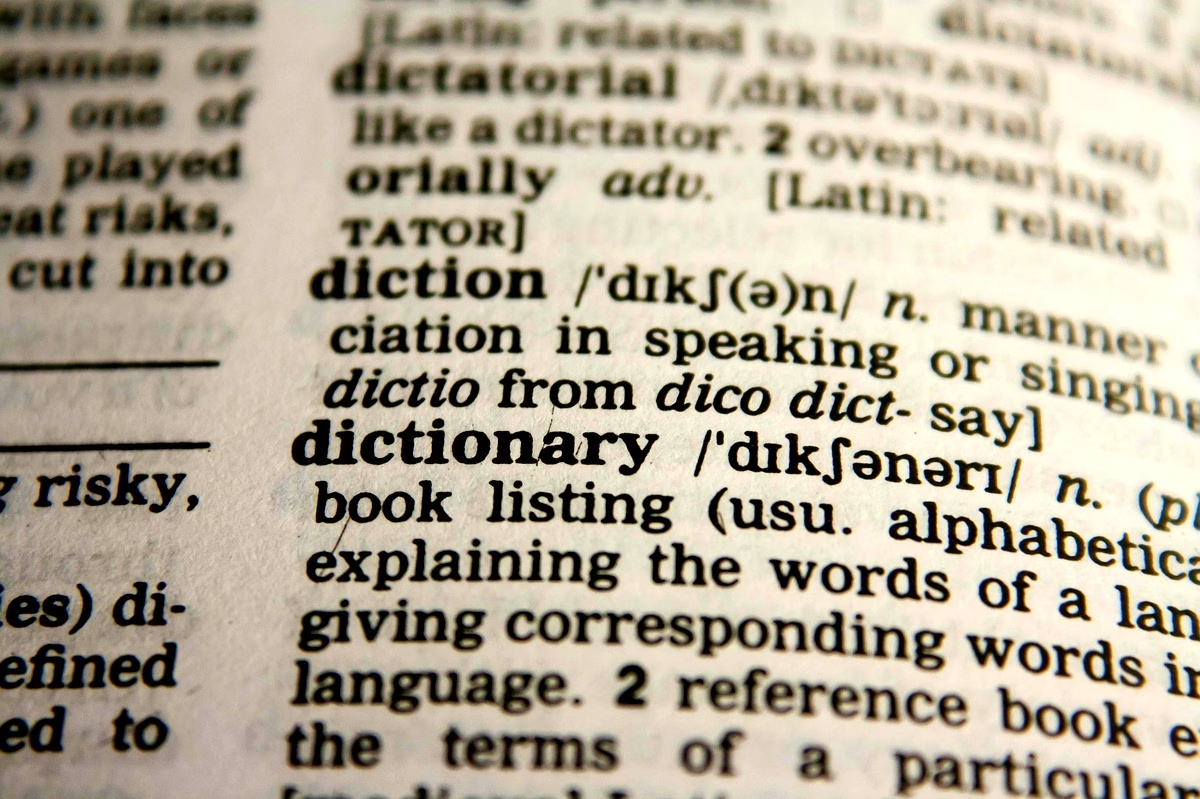
Cette section se focalise également sur le rapprochement fait entre le DDF et la BDLP – qui est une des bases de données intégrée au DDF –. Loin d’en discerner les contrastes, Michel Francard inscrit le DDF « dans le droit fil de la BDLP » (2022, p. 125). Si l’on se réfère à son analyse, il ressort que « l’essentiel de la documentation hors France du DDF » est une reproduction de la BDLP (Idem).
Néanmoins, les lignes éditoriales de chaque projet sont à distinguer : « Le DDF est ouvert à tous parce que c’est un dictionnaire participatif, ce que n’était pas la BDLP » (Ibid., p. 126). Il se fait également le vecteur de différences méthodologiques notoires : « Pour la BDLP, nous avions formé dans le Nord les équipes du Sud pour qu’ils puissent bénéficier d’une bonne méthodologie et, ainsi, réaliser leur propre travail d’enquête dans les pays du Sud.
Dans le DDF, n’importe qui peut avancer sa définition, son exemple, etc. » (Idem)
De même, le Dictionnaire des belgicismes est mentionné au cours de notre entretien. On relève la présence dudit dictionnaire au sein de la BDLP et donc, par voie de conséquence, au sein du DDF. Le linguiste belge fait remonter que l’origine présidentielle du DDF entre en résonance avec le projet de la BDLP « dont, là aussi, la France était partie prenante » (Ibid., p.
125). Force est de constater que la voie de la BDLP était plus scientifique que politique car « c’était la France des collègues linguistes comme Bernard Quémada » (Ibid., p. 126). Les enjeux politiques du DDF engendrent, selon notre interlocuteur, une discordance notable entre les deux projets : « […] cela signifie que se mettent en jeu d’autres logiques, d’autres règles de fonctionnement.
[…] Il y a clairement une visée politique derrière tout ça, ce que n’avait pas la BDLP. » (Idem)
Dans la continuité des propos de Michel Francard, Jean Tabi-Manga perçoit le DDF comme un « prolongement » et un « approfondissement » de l’Inventaire des particularités du français en Afrique – également intégré au DDF dès ses débuts – (2022, p. 53). La différence majeure recensée est que le DDF est « plus enrichi et plus vivant » que l’IFA (Idem). Mona Laroussi reconsidère la dimension novatrice du numérique en citant « les sites dictionnaire.fr et synonymes.fr qui existaient en ligne depuis assez longtemps. » (2022, p. 45) Pour l’informaticienne membre du Conseil scientifique, la grande avancée du DDF réside dans le fait qu’il s’agisse d’« application mobile » (Idem). Il se distingue également en n’étant pas constitué « d’une seule base de données comme Larousse ou Robert » :
On dit que le DDF est cumulatif puisqu’il a regroupé plusieurs bases de données. C’est aussi lié au fait que les interfaces ne sont pas figées. Les gens ont l’opportunité de soumettre leur avis, d’être force de proposition, chose qu’on ne peut pas faire dans les autres dictionnaires. (Ibid., pp. 45-46)
Enfin, Lucas Lévêque, rapproche le DDF du Wiktionnaire, qu’il considère comme détenteurs d’« une vision assez proche […] sans être identique. » (2022, p. 47) Il allègue que tous deux ont comme point commun de ne pas être normatifs :
On ne peut pas se positionner en tant que norme en décrivant tous les français donc on ne peut pas avoir le même aspect normatif que le Dictionnaire de l’Académie française qui est ultra-normatif ou que Le Larousse et Le Robert qui le sont quand même aussi un peu […]. (Ibid., pp. 47-48)
Bien que le DDF et le Wiktionnaire s’évertuent tous deux à « décrire au mieux les usages », une différence persiste – comme pour la BDLP – entre le fait que « […] le Wiktionnaire décrit au mieux en partant de zéro alors que le DDF intègre des bases de données déjà existantes. » (Idem) Par ailleurs, mention est faite de l’IFA, de la BDLP et du Dictionnaire des régionalismes de France qui sont tous trois des dictionnaires normatifs intégrés au DDF. La dimension descriptive du DDF et du Wiktionnaire n’est donc – sur une base théorique et empirique – pas du même acabit, même si tous deux sont les défenseurs d’une connaissance ouverte.
