Les choix éditoriaux du DDF sont analysés à travers les ambitions et les principes directeurs du projet, mettant en lumière leur impact sur la gouvernance linguistique et la lutte contre la glottophobie. Cette étude révèle les enjeux politiques sous-jacents à la création d’un dictionnaire francophone polycentrique.
Section 2. Ambitions du DDF : ce que disent les acteurs de la ligne éditoriale
[img_1]
Source : Gasparini, N., Sefiane, N. (2022b, 7 février). Principes directeurs du projet [Diapositive]. Conférence Dictionnaire des francophones, un commun citoyen, forum « Innovation, Technologies et Plurilinguisme ».
A-Circonscrire les choix éditoriaux du dictionnaire
1. Appréhender les fondations du DDF : approche théorique
Le DDF ne se cache pas d’être détenteur – au même titre que ses homologues – d’une ligne éditoriale. Selon les membres de 2IF en charge du projet, « un dictionnaire représente une manière de penser, de voir le monde, de se le représenter. En ce sens, il véhicule des principes et des valeurs » (Meszaros et Gasparini, 2021).
La lecture d’un dictionnaire peut être abordée sous un angle théorique, comme l’a fait l’historien de la langue Jean Pruvost, auteur d’une littérature étoffée sur les dictionnaires de langue française (2021). Il démontre que leur diversité s’explique en premier lieu par des lignes éditoriales singulières. Chaque dictionnaire véhicule ainsi un contenu chargé de sens : Dictionnaire du français québécois, Dictionnaire du français acadien, Dictionnaire universel francophone, Dictionnaire des belgicismes, Dictionnaire de la zone…
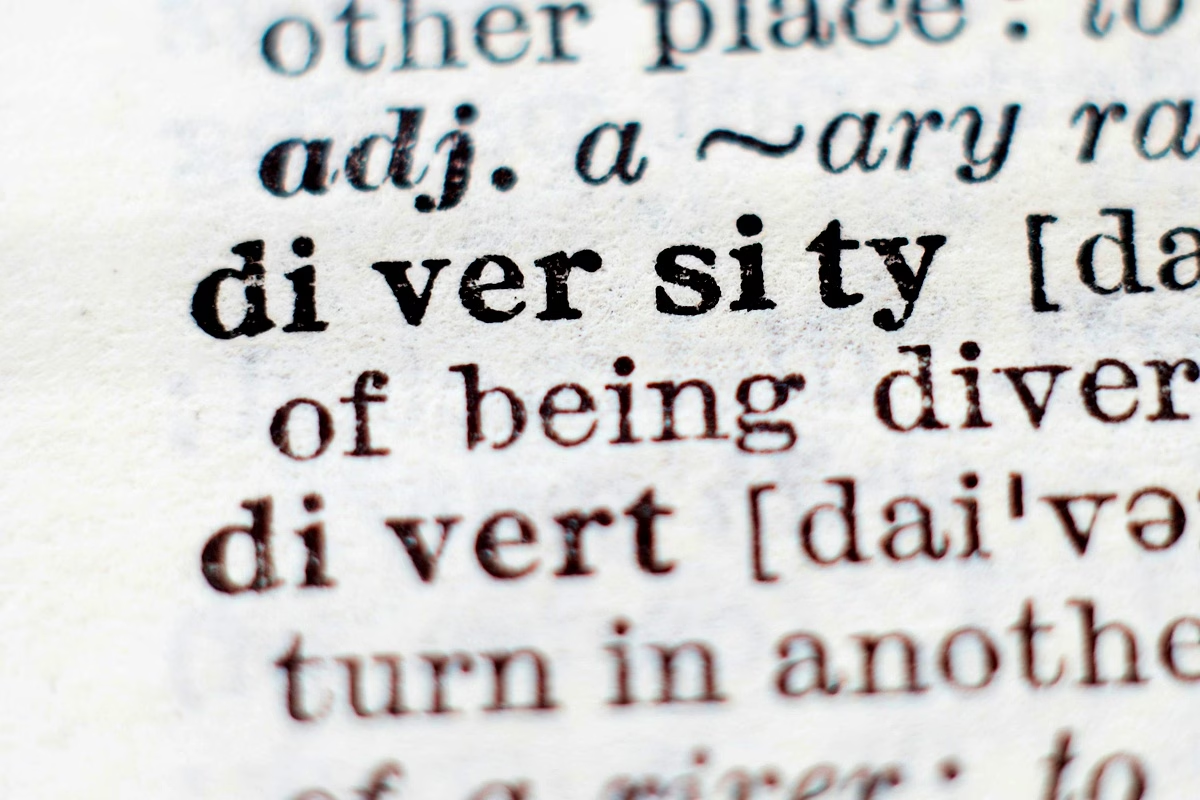
Cette multitude de perceptions a été mise en exergue par Maniez qui, en 2017, publie une Étude comparée de quelques dictionnaires de français en ligne. Maria Candea et Laélia Véron corroborent ses propos dans Le français est à nous !. Pour elles « il n’y a pas un, mais plusieurs dictionnaires.
Ils se distinguent par des choix éditoriaux, mais aussi idéologiques, voire politiques » (2019, p. 15). Elles encouragent chaque lecteur à effectuer des recherches « sur les équipes éditoriales, leur politique, leur public cible » (Ibid., p. 30) avant de se procurer un dictionnaire et d’en faire un référent en matière de langue. Il est établi qu’un dictionnaire est souvent utilisé comme un arbitre auquel s’en remettre lorsque survient un doute quant à la validité d’un usage (Pruvost, 2021, p. 142).
Afin de déchiffrer un dictionnaire, il sied de se soucier de la période dans laquelle il s’inscrit puisqu’elle est le reflet de courants de pensée spécifiques. Jean Pruvost fait, à ce titre, mention de l’importance d’être conscient des « filiations historiques » (2021, p. 117), permettant de cerner les moments où le dictionnaire est tantôt véhicule de réglementations, tantôt vecteur d’ouverture. Pour ce faire, l’analyse du paratexte est requise, i.e. la démarche dans laquelle s’inscrivent ses concepteurs (Ibid., p. 14).
Pour mettre en lumière les axes structurants d’un dictionnaire, la discipline de la métalexicographie peut venir en appui. Elle est dépeinte dans le Dictionnaire des sciences du langage comme « […] une discipline dont l’objectif est l’étude des types de dictionnaires de langue et des méthodes qui président à leur constitution. » (Neveu, 2004, dans Pruvost, 2021, p. 124)
L’historien de la langue rappelle l’importance de consulter un dictionnaire de manière « […] éclairée, c’est-à-dire réinterprétée en fonction de la connaissance des motivations des lexicographes d’une part, et du contexte d’autre part. » (Ibid., p. 207) Aucune partie constituante d’un dictionnaire – qu’il s’agisse de sa nomenclature, de son organisation, des définitions apportées ou encore des mots qui ont été occultés – ne doit être prise pour argent comptant (Idem).
Chaque ouvrage dispose d’une « grande influence symbolique (et idéologique) » (Véron et Candea, 2019, p. 27). Pour démontrer la subjectivité des dictionnaires, les autrices prennent l’exemple de celui publié en 1694 par l’Académie française, reposant sur des « choix orthographiques opposés, allant tous dans le sens de la différence maximale avec la forme prononcée des mots » (Ibid., p. 29). Elles invitent alors les lecteurs à choisir leur dictionnaire de manière éclairée, car « ils ne se valent pas et ne sont pas identiques ». (Ibid., p. 30)
Riches de ces constats, nous tâcherons, dans cette partie, de nous renseigner sur la stratégie éditoriale du DDF, véritable indicateur des intentions politiques sous-jacentes. Il conviendra donc, non seulement de nous questionner sur la langue elle-même, mais également sur « les discours qui la concernent et ceux qui sont tenus en son nom » (Ibid., p. 220).
2. Rencontre avec le numérique : le DDF dans le droit fil de l’esprit Wiki
La caractéristique fondatrice du DDF est sa dimension numérique puisqu’il se présente sous la forme d’une application mobile. Paul Petit présente l’association de « la langue français à la mutation numérique de type Wiki » comme l’« originalité » du projet (2022, p. 93) et relève l’omniprésence du numérique dans les opérations mises en place par le sommet de l’État :
[…] c’est présent dans toute l’action intergouvernementale, il n’y a pas un objet qui ne soit pas associé au numérique. Donc, nous aussi, on voulait du numérique et de l’innovation. Chez les linguistes, la rencontre du numérique et de l’objet dictionnaire est très originale. C’est venu accroître une étincelle qui existait déjà avec le Wiktionnaire. (Ibid., pp. 93-94)
Tandis que François Grin prête l’essentiel du travail à l’« architecture de bases de données » (2022, p. 21) – symbole de la prépondérance du numérique au sein du projet –, la facilité d’accès permise par le numérique est mise en exergue par Mona Laroussi :
Le fait que le DDF soit numérique, qu’il se consulte sur un portable, fait en sorte qu’il véhicule une vision futuriste nourrie d’un usage interactif, convivial, immédiat. […] Cette immédiateté répond aux besoins des jeunes. Donc, le premier point, c’est cet aspect immédiateté, jeunesse, rapidité. (2022, p. 43)
Par-delà la dimension numérique, la ligne du DDF reflète l’esprit Wiki. Pour Lucas Lévêque, « le DDF est largement inspiré de l’esprit Wiki parce que Noé est issu du milieu. » (2022, p. 49) Jean Pruvost démontre que le mode du Wiktionnaire tient sa singularité au formulaire de contribution élaboré pour que chaque usager puisse participer. Les fonctionnalités d’un dictionnaire de type Wiki se démarquent donc de celles d’un dictionnaire classique, « l’important n’étant pas tant le travail définitoire que le recueil précis du maximum de données lexicales. » (2021, p. 111)
Aux prémices de l’opération, la DGLFLF a opté pour un dictionnaire « collaboratif et évolutif, sur le modèle Wiki » (2019, p. 2). La note ayant circulé en interne révèle que l’option d’un dictionnaire édité à l’écrit – dépeint comme « classique » – a été écartée (Idem). L’argument avancé pour justifier ce choix est l’impossibilité d’organiser des rassemblements fréquents entre lexicographes de l’espace francophone. De plus, il est avéré que la surabondance d’offres dictionnairiques rend la possibilité d’être édité beaucoup plus complexe et incertaine.
La réponse du numérique a donc été présentée pour enrayer trois contraintes : la contrainte géographique, la contrainte temporelle ainsi que la contrainte méthodologique (Idem). La « révolution numérique » est offerte pour contourner ces limites majeures puisque ses « modes de diffusion, d’accès » s’ajustent à la réalité de la territorialité discontinue de l’espace francophone (Idem).
Dès février 2019, le modèle numérique est entériné via la note interne rédigée par la DGLFLF et justifié de la sorte :
- Pour permettre la combinaison et le traitement automatisé de corpus, déjà constitués, reconnus et bien identifiés, ou rapidement évolutifs et à même d’être nourris au fur et à mesure ;
- Pour interagir avec le plus large public, où qu’il soit à travers le monde, et de la façon la plus simple, dans l’esprit qui prévaut dans les communautés qui interagissent sur la Toile, qu’elles soient scientifiques (échange de données, science ouverte), d’amateurs éclairés, ou de contributeurs individuels intéressés au sujet. (p. 2)
L’accomplissement du DDF tient à la numérisation des « nombreux dictionnaires, ouvrages ou bases de données décrivant la langue française dans sa diversité » (Idem). Une ambition qui fait suite au constat de l’impossibilité de trouver sur le Web ces travaux clés. Dans ce sens, la DGLFLF ambitionne de numériser les travaux de l’AUF (Idem).
Une opération qui permet de lier l’opérationnalisation numérique du projet et la réunion des différentes institutions de la francophonie en tant que partenaires. L’intégration d’un conglomérat de bases de données repose sur la nécessité de placer les ressources sous licence libre. Le principe des « données ouvertes » s’inscrit de nouveau dans la lignée du modèle Wiki et est présenté comme un « […] impératif à cette circulation des connaissances dans la nouvelle économie en ligne. » (Idem)
Une autre particularité calquée sur le Wiktionnaire est la dimension collaborative du dispositif numérique. Néanmoins, il est proposé que le modèle Wiki soit modulé pour permettre aux usagers de disposer d’une plus grande amplitude d’action. Un autre dictionnaire numérique est pris pour exemple : l’Urban Dictionary. La note interne à la DGLFLF fait remonter sa « souplesse » et son « attractivité », qui permettraient de pallier les limites de contribution identifiées pour le Wiktionnaire.
La collaboration se décline aussi au niveau institutionnelle puisque la DGLFLF est ouverte à la coopération avec d’autres initiatives dictionnairiques, à l’instar du « lancement récent du portail numérique de consultation du Dictionnaire de l’Académie française » (2019, p. 4).
Quant à la gestion de l’outil numérique, le fonctionnement des communautés Wiki est de nouveau pris en exemple. La DGLFLF fait part de son souhait d’élaborer les mêmes formulaires de « validation des contenus », la longévité de la construction Wikipédia mettant en évidence la pertinence des « dispositifs éprouvés d’autorégulation et la faible part statistique de propositions malveillantes » (Ibid., p. 3). Ils proposent néanmoins d’agrémenter les « garde-fous » d’un « réseau d’experts de terrain » ainsi que d’un Conseil scientifique (Idem).
La piste explorée par le biais du DDF est donc celle de l’innovation. Un des arguments principaux avancé pour justifier le développement du numérique est la facilité d’accès que permet une interface en ligne gratuite, consultables « sur les téléphones et terminaux mobiles » partout dans le monde (Idem). En arrière-plan se dessine l’intention de développer plusieurs autres applications pour faciliter l’apprentissage du public allophone (Idem). Une des priorité mise en exergue est celle de « nourrir d’autres outils numériques dérivés ou annexes » (Idem).
Toutefois, il est important de remarquer qu’alors que la DGLFLF fait état d’un « saut technologique avéré dans l’ensemble de l’espace francophone » (Ibid., p. 3), l’OLF relève dans son rapport La langue française dans le monde (2018, p. 26) une fracture numérique persistante dans l’espace francophone du Sud, qui agirait comme un frein à la consultation du DDF.
