Section 2. Analyser l’ancrage institutionnel du DDF dans la Francophonie
[img_1]
Source : Gasparini, N. (2022a, 13 mai). Consortium institutionnel [Diapositive]. Conférence Dictionnaire des francophones, séminaire de l’ATILF, Nancy.
A-Une coordination multilatérale : dialogue avec les instances de la Francophonie
1. Différencier francophonie de Francophonie
Pour rendre compte de la dimension institutionnelle de la Francophonie, un distinguo doit être fait entre la Francophonie dotée d’un « F » majuscule et la francophonie dotée d’un « f » minuscule.
La Francophonie dotée d’un « F » majuscule désigne le corps institutionnel francophone. François Grin la définit comme « l’ensemble des États unis dans l’OIF » (2022, p. 18). Les pères fondateurs en sont Norodom Sihanouk – ancien roi du Cambodge –, Habib Bourguiba – premier président de Tunisie –, Hamani Diori – ancien président de la République du Niger –, ainsi que Léopold Sédar Senghor – premier président du Sénégal –. Ce dernier dit avoir voulu façonner une « communauté organique francophone » (Conférence franco-africaine, Nice, 1980), matérialisée avec la création en 1970 de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) à Niamey, Niger. 21 pays y adhèrent alors.
Devenue l’Organisation internationale de la Francophonie en 2005, elle est actuellement composée de 88 États et gouvernements membres – dont 27 observateurs et 7 membres associés –. Depuis le Sommet d’Érevan en 2018, sa Secrétaire générale est Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères au Rwanda. L’organisation actuelle de la Francophonie est fixée par la Charte d’Antananarivo (2005).
La Francophonie peut être qualifiée de « mouvement francophone » (de Saint-Robert, 2000, p. 83). Selon la chercheuse, il réunirait « plus du quart des pays du monde » et se caractérise par la tenue de Sommets bi-annuels entre chefs d’États membres (Idem). De Saint-Robert souligne les défis qu’engendre une prise de décision commune.
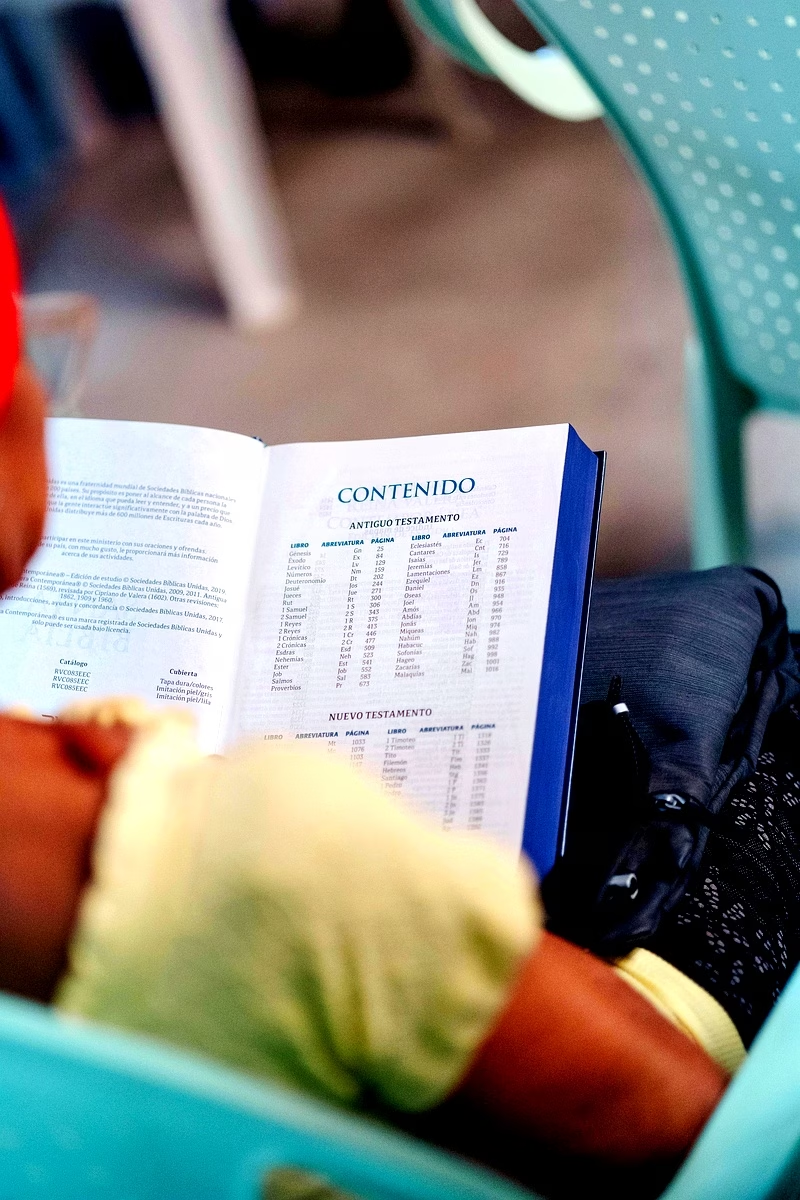
En 2000, elle estimait « que les contraintes qu’impose l’irruption d’acteurs dans la conception et la mise en place de ce qui devrait être une politique francophone du français sont encore largement ignorées. » (Idem) Des propos qui entrent en résonance avec la volonté de l’OIF de promouvoir une géopolitique de la coopération et de la mutualité.
Elle se veut le pivot du système multilatéral francophone.
La francophonie avec un « f » minuscule désigne quant à elle une réalité sociolinguistique (Grin, 2022, p. 18), celle de l’ensemble linguistique couvrant les peuples qui utilisent le français à des degrés divers. Le français peut être, au sein des pays francophones, « langues maternelle, nationale, la langue officielle ou l’une des langues officielles, ou encore une langue étrangère très largement ou couramment utilisée ».
(Idem) D’après l’Observatoire de la langue française, le français est langue officielle ou co-officielle de 32 États et gouvernements membres de l’OIF. Par ailleurs, les mots et expressions répertoriés au sein du DDF proviennent de 52 pays et 112 localisations (Délégation à l’information et à la communication du ministère de la Culture, 2021, p. 12).
La section 2 de notre premier chapitre fait référence à la dimension institutionnelle de la Francophonie. Elle est donc empreinte du terme doté d’un « F » majuscule. En parallèle, nous optons pour un « f » majuscule dès que le DDF est abordé au prisme de la francophonie en tant que réalité sociolinguistique.
2. Instaurer un pilotage francophone
La volonté d’instaurer un pilotage francophone est formalisée dès 2018 où, lors du Sommet d’Érevan, Emmanuel Macron explicite son intention de « conduire et porter ensemble » le Dictionnaire des francophones. Bien que reconnaissant l’origine française du projet : « La France a commencé », il témoigne de son souhait de « multiplier les initiatives ensemble » (Idem).
La demande d’une gouvernance mutualisée se manifeste également dans les entretiens que nous avons menés. Selon Jean Tabi-Manga, « Ce projet émane des instances francophones et le Président français lui a donné une configuration politique qui permet aux opérateurs francophones de l’inscrire dans leur programmation respective. » (2022, p. 54) De même, Mona Laroussi nous révèle avoir été contactée par le président du Conseil scientifique pour « que l’on pense tous ensemble à une version mobile » (2022, p. 42).
Poursuivant ce dessein, le comité de pilotage a été constitué de sorte qu’il soit transnational et polyphonique. Le dossier de presse réalisé par la Délégation à l’information et à la communication du ministère de la Culture ainsi que le Compendium rédigé par l’équipe lyonnaise en font part. Sont dénombrés les acteurs principaux suivants : la DGLFLF, 2IF, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – tous trois français –, ainsi que l’OIF et l’AUF – institutions francophones –.
Loin d’être occultée, la dimension francophone du portage se traduit différemment. En premier lieu, on recense les organismes ayant contribué au contenu, à l’instar de l’AUF, qui se démarque en « tiss[ant] des liens avec […] les plateformes pédagogiques en ligne telles que IDNEUF » (Gasparini et al, 2021, p. 6).
Le DDF bénéficie également de l’accompagnement du réseau OPALE, qui lui permet de s’inscrire comme « un outil supplémentaire dans la panoplie éducative et interculturelle francophone » (Ibid., p. 7). En second lieu, nous déchiffrons les ressources présentes au lancement de l’outil. La pluralité des bases de données met en exergue l’essence francophone du dictionnaire.
Son contenu se compose de : l’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire (AUF), le Wiktionnaire francophone, le Dictionnaire des synonymes, des mots et expressions du français parlé dans le monde (ASOM), le Grand Dictionnaire terminologique (OQLF), l’ouvrage l’Inventaire des particularités lexicales du français en Belgique (Conseil International de la Langue Française), le Dictionnaire des régionalismes de France (ATILF), la Base de données lexicographiques panfrancophone (Université Laval) et FranceTerme (DGLFLF).
Ce conglomérat accentue la collaboration mise en place entre les pays de l’espace francophone.
[img_2]
Source : Gathier, S. (2022a, 13 mai). Ressources intégrées au DDF [Diapositive].
Il n’en demeure pas moins que le pilotage francophone tient surtout à l’implication de l’OIF et l’AUF, institutions fondatrices de la Francophonie. La coopération entre la DGLFLF, l’OIF et l’AUF est mise en exergue au sein du communiqué de presse établi par la Délégation à l’information et à la communication du ministère de la Culture : « le DDF est né d’une réunion entre la DGLFLF ; 2IF, l’OIF et l’AUF. » (2021, p. 29) Pour Paul Petit, le projet a été bâti dans une optique de complémentarité et de gouvernance partagée :
[…] les rôles sont complémentaires. […] entre nous – administration – et l’Académie française – lieu prescripteur, symbolique et d’expertise – […]. […] vous évoquiez l’OIF, l’Observatoire. Là, y’a une complémentarité. Et le dialogue avec chacun, et aussi avec nos amis des autres francophonies – donc l’OQLF ou d’autres instances Québec-Canada, les Belges, les Suisses, d’autres mondes associatifs –, offre une contribution, dans l’idée de coordonner ou d’animer ensemble. (2022, p. 90)
Le Compendium du DDF appuie cette déclaration en signalant la forte implication de l’AUF dès 2021 ainsi que la mobilisation des réseaux de l’OIF. De même, Louise Mushikiwabo rédige un éditorial dans le Dossier de presse « Lancement du dictionnaire des francophones» où elle déclare que « c’est parce que le DDF a vocation à regrouper le plus grand nombre possible de variétés du français que l’OIF s’est associée à ce projet » (2021, p. 8). Allusion est de nouveau faite à l’OIF par la Secrétaire générale lors de la cérémonie de lancement du DDF. Elle expose dans son allocution que le vocabulaire des pays africains francophones recueilli représente 32 pays membres de l’OIF (2021).
Par ailleurs, l’implication d’un grand ensemble de médias francophones entérine l’ancrage institutionnel du DDF dans la Francophonie : TV5Monde, RFI International, France 24, Monte Carlo Doualiya et France Médias Monde sont autant de canaux diffusés dans la linguasphère francophone et parties prenantes du projet.
Qui plus est, les délégations politiques de l’espace francophone du Nord ont été intégrées par le biais du réseau OPALE constitué de la DGLFLF, de l’OQLF, de la DLF de Suisse romande et du Conseil de la langue française, des langues régionales endogènes et des politiques linguistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
On compte également le réseau de recherche français du CNRS via l’infrastructure de recherche Huma-Num, ainsi que le réseau d’influence culturelle français, représenté par l’Institut français et la Fondation Alliances françaises. Enfin, on dénombre parmi le comité de pilotage l’Académie des Sciences d’Outre-mer et l’Université Jean Moulin Lyon III – également françaises –.
Les dernières mentions faites permettent d’établir une certaine prépondérance de la France dans la gestion du projet, malgré la présence relevée de la Francophonie. Le portage financier est aussi majoritairement français : le Compendium du DDF révèle que « le financement a été principalement assuré par la DGLFLF et l’Université Jean Moulin Lyon 3 » (Gasparini et al, 2021, p. 29). De plus, notre entretien avec Mona Laroussi nous a informé de l’implication relative de l’OIF, plus partenaire qu’instigateur :
On est partenaire du DDF mais ce ne sont pas nous qui le gérons. C’est sous l’égide de la DGLFLF. Notre mission est plutôt de faire la promotion du DDF au quotidien. Notre créneau, c’est l’application et, en général, on travaille plus sur les langues nationales que sur les variétés de français. L’objectif à l’IFEF, reste l’éducation et la formation. (2022, p. 45)
Le média Le Devoir dépeint également l’AUF et l’OIF comme des contributeurs « sur le plan technique et financier », suppléant la « mise en oeuvre française ». Un déséquilibre perçu comme cohérent sur « le plan symbolique », dans la mesure où la France s’attache à déjouer tout « purisme parigocentriste » (Nadeau, 2019).
3. La DGLFLF : moteur de la coopération francophone
Comme mentionné dans le chapitre 1 (section 1, C, 3, ndlr), la DGLFLF occupe une position centrale dans l’ancrage institutionnel du DDF. Les propos recueillis de Paul Petit démontrent que le service interministériel a officié comme médiateur auprès des instances de la Francophonie :
[…] la DGLFLF peut être à un moment pivot. Et c’est ce qui s’est passé avec le DDF. C’est-à-dire qu’à un moment on parle à l’AUF, à l’OIF, aux Québécois, aux Belges, au secteur universitaire avec Lyon, au CNRS, etc. Donc, la DGLFLF, par son positionnement un peu original, dit à tout le monde : “Les amis, on a eu une bonne idée, avec nos amis de Lyon. On a une commande politique, on a des fonds, mettons nous autour d’une table et voyons si on peut avancer quelque chose de nouveau et de partenarial”. (2022, p. 90)
La France bénéficie ainsi – au travers de la DGLFLF – d’une posture capitale. Elle représente une puissance organisante et rassembleuse. Cette prédominance tient, selon Klinkenberg, à des raisons historiques, sociolinguistiques et économiques qui opposent le fonctionnement de la linguasphère francophone à l’anglophonie et à l’hispanophonie, régies par des dynamiques plus fédérales :
Pour des raisons historiques, la France continue à peser d’un poids important au sein de la Francophonie. Pour des raisons sociolinguistiques aussi puisque le français n’est langue maternelle que d’un petit noyau de population en dehors de la France. […] En outre, la francophonie est encore constituée de pas mal de pays pauvres.
C’est le Nord, et notamment la France, qui continue – pour des raisons à la fois économiques, démographiques, linguistiques et anthropologiques – à peser d’un poids considérable. C’est une donnée qu’on ne peut absolument pas court-circuiter et donc il est logique, il est en tout cas compréhensible – même si à un moment, sur le plan politique, les extra-hexagonaux ont demandé que l’on mette des balises – qu’en matière de langue, la France prenne des initiative.
(2022, p. 33)
En étant force de proposition, la DGLFLF – et donc la France – s’est imposée comme l’intermédiaire entre les différentes instances linguistiques francophones. Un titre symbolique de chef de file entretenant le déséquilibre institutionnel entre les espaces francophones du Nord et du Sud.
