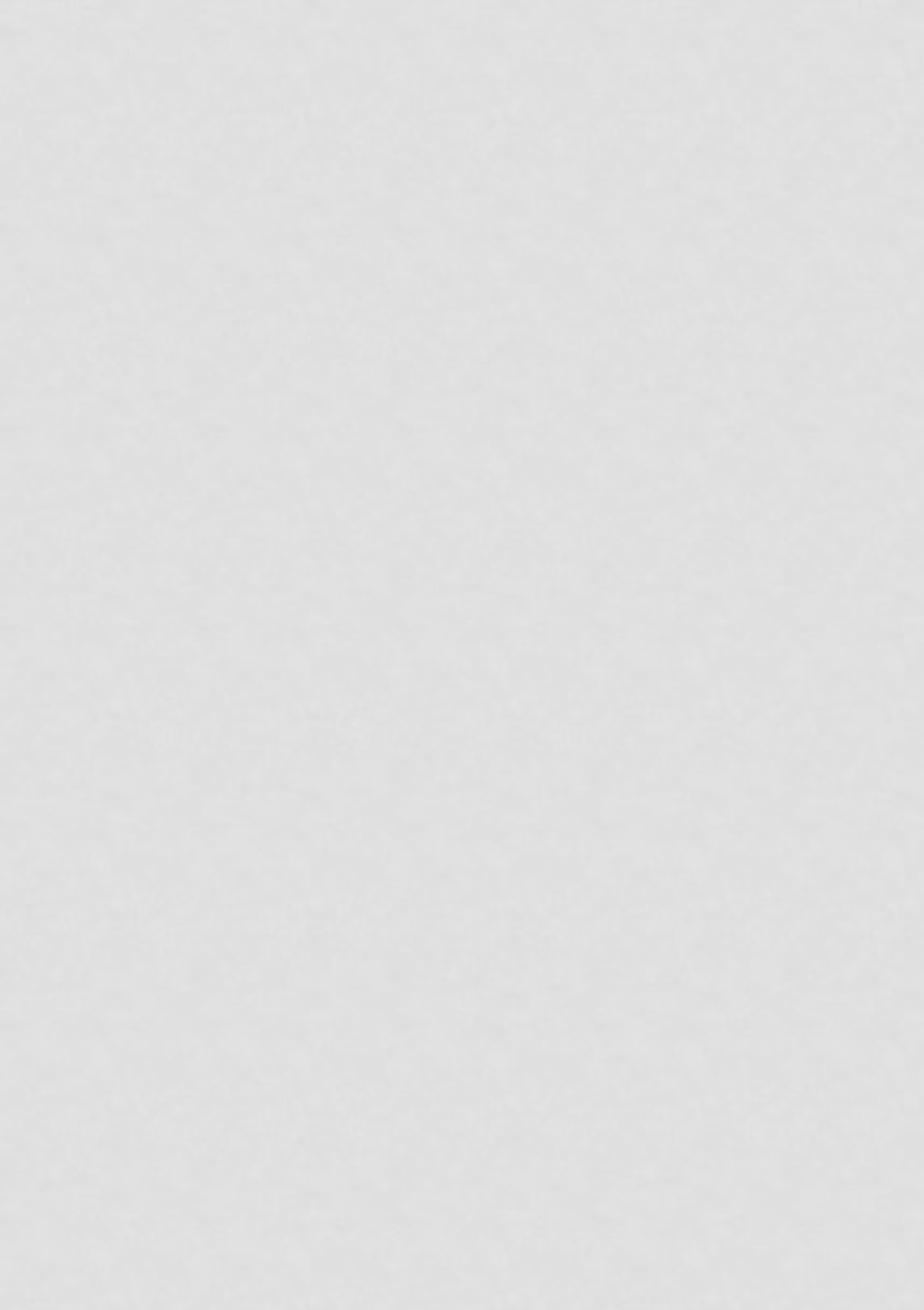L’analyse risque phytosanitaire bois révèle les dangers associés à l’exportation de bois vers le port de Douala, en identifiant les insectes nuisibles et en mesurant leur coefficient d’infestation. Les résultats indiquent un risque accru pour les bois en grume par rapport aux bois débités, variant selon leur provenance.
Analyse du risque phytosanitaire
Présentation générale
L’analyse du risque phytosanitaire (ARP) est un processus scientifique qui a sa logique pour déterminer les mesures phytosanitaires appropriées pour une zone ARP spécifiée. C’est un processus qui évalue les preuves techniques, scientifiques et économiques pour déterminer si un organisme est potentiellement un organisme nuisible aux végétaux et, dans ce cas, savoir comment le gérer.
Selon la CIPV, le terme d’organisme nuisible aux végétaux fait référence à tous les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, y compris d’autres végétaux, bactéries, champignons, insectes et autres animaux, acariens, mollusques, nématodes et virus. Les organismes nuisibles peuvent être réglementés ou non, et la CIVP reconnaît et définit deux catégories d’organismes nuisibles réglementés : les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine.
L’ARP aide à déterminer si un organisme nuisible entre dans l’une ou l’autre de ces deux catégories et, le cas échéant, quelle force donner aux mesures phytosanitaires à prendre contre lui.
Si l’on a déterminé que l’organisme pouvait être un organisme de quarantaine, on évalue la probabilité de l’introduction, de la dissémination et l’ampleur des conséquences potentielles en utilisant des preuves scientifiques, techniques et économiques. Si le risque phytosanitaire est jugé inacceptable, l’analyse peut continuer en proposant des options de gestion pour diminuer le risque jusqu’à atteindre un niveau acceptable. Ces options de gestion du risque phytosanitaire peuvent être utilisées pour établir des réglementations phytosanitaires.
Dans la plupart des cas, le risque phytosanitaire ne vient pas de la marchandise elle-même, mais des organismes nuisibles aux végétaux qu’elle peut véhiculer.
L’ARP peut être considérée comme un processus permettant de répondre aux questions suivantes :
- L’organisme est-il un organisme nuisible ?
- Quelle est la probabilité de son introduction, établissement et dissémination ?
- Quel degré de dommage économique (y compris environnemental et social) cause-t-il ? (Impact inacceptable)
- Que peut-on faire pour atténuer un impact inacceptable
Étapes de l’analyse du risque phytosanitaire
L’analyse du risque phytosanitaire consiste à :
- Examiner des données scientifiques en vue de déterminer si un organisme est nuisible.
- Dans l’affirmative, l’analyse évalue la probabilité d’introduction et de dissémination de l’organisme nuisible, et l’ampleur des conséquences économiques potentielles dans une zone déterminée, sur la base de données biologiques, ou autres données scientifiques et économiques.
- Si le risque phytosanitaire est jugé inacceptable, l’analyse peut être poursuivie afin d’indiquer des mesures de gestion susceptibles de ramener ce risque à un niveau acceptable. Les options de gestion du risque phytosanitaire peuvent ensuite être utilisées pour mettre en place une réglementation phytosanitaire.
Le processus d’ARP comporte trois étapes :
- Étape 1: MISE EN ROUTE : La mise en route est la phase d’identification des organismes et des filières susceptibles de faire l’objet d’une analyse du risque phytosanitaire dans la zone ARP identifiée. À la fin de l’Étape 1 du processus, les organismes nuisibles et les filières visés auront été identifiés et la zone ARP définie.
Étape 2: ÉVALUATION DU RISQUE PHYTOSANITAIRE : comporte plusieurs phases :
- Catégorisation de l’organisme nuisible : processus visant à déterminer si un organisme nuisible présente les caractéristiques d’un organisme de quarantaine ou d’un ORNQ (Organisme Règlementé Non de Quarantaine).
- Evaluation de l’introduction et de la dissémination :
- Organismes examinés comme éventuels organismes de quarantaine : identification de la zone menacée et évaluation de la probabilité d’introduction et de dissémination
- Organismes examinés comme éventuels ORNQ : évaluation de la possibilité que les végétaux destinés à la plantation soient ou deviennent la principale source d’infestation, par comparaison avec les autres sources d’infestation dans la zone
- Étape 3: gestion du risque phytosanitaire. Identification des options de gestion visant à réduire les risques identifiés à l’étape 2. On évalue leur efficacité, leur faisabilité et leur impact pour choisir celles qui sont appropriées.
Étape 1 de L’ARP : mise en route
La mise en route est la phase d’identification des organismes et des filières susceptibles de faire l’objet d’une analyse du risque phytosanitaire dans la zone ARP identifiée.
Un processus d’ARP peut être déclenché dans les cas suivants :
- Une demande d’examen d’une filière susceptible de nécessiter des mesures phytosanitaires est présentée ;
- Un organisme nuisible susceptible de justifier des mesures phytosanitaires est identifié :
- Une décision d’examiner ou de réviser des mesures ou politiques phytosanitaires est prise :
- Une invitation à déterminer si un organisme est nuisible est faite.
La mise en route comporte quatre opérations :
- détermination d’un organisme comme étant ou non nuisible
- définition de la zone ARP
- examen des éventuelles ARP effectuées
- conclusion
Étape 2 : Évaluation du risque phytosanitaire
La NIMP n° 11 (Analyse du risque phytosanitaire pour les organismes de quarantaine, incluant l’analyse des risques pour l’environnement et des organismes vivants modifiés, 2004) présente les directives pour approfondir l’analyse des organismes considérés comme des organismes de quarantaine. Si les organismes ne sont pas des organismes de quarantaine, la norme n° 21 (Analyse du risque phytosanitaire pour les organismes réglementés non de quarantaine) peut s’appliquer.
L’étape 2 de l’ARP concerne l’évaluation du risque phytosanitaire. Elle comporte trois phases :
- Phase 1 : catégorisation de l’organisme nuisible
- Phase 2 : évaluation de la probabilité d’introduction (entrée et établissement) et de dissémination
- Phase 3 : évaluation des incidences économiques potentielles de l’introduction et de la dissémination
Bien que les étapes de l’évaluation du risque phytosanitaire soient généralement documentées l’une après l’autre, il n’est pas obligatoire de les réaliser dans cet ordre. L’évaluation du risque phytosanitaire est un processus itératif qui demande un examen répété des différents éléments qui ont une incidence sur le risque phytosanitaire, au fur et à mesure de la disponibilité des informations. Les résultats de la phase 2, évaluation de la probabilité d’introduction et de la phase 3, évaluation des incidences économiques potentielles de l’introduction et de la dissémination, sont combinés pour arriver à une appréciation globale du risque.
L’évaluation du risque phytosanitaire ne doit pas être plus complexe que ne l’exigent les circonstances pour pouvoir prendre la décision finale et réunir les justifications techniques nécessaires à la prise de décision relative à des mesures phytosanitaires. L’évaluation doit s’appuyer sur des connaissances solides, être transparente et cohérente avec les autres évaluations menées par l’ONVP. Pour cette raison, il est souhaitable de disposer d’un système national qui donne un cadre normalisé complet et des critères pour évaluer tous les facteurs potentiels de risque.
L’évaluation du risque phytosanitaire doit prendre en compte tous les aspects de chaque organisme nuisible comme sa dispersion géographique, sa biologie et ses conséquences économiques dans les régions où il est déjà présent. On a ensuite recours au jugement des experts pour évaluer la probabilité de son introduction, de ses possibilités d’établissement et de dissémination, et son importance économique potentielle dans la zone ARP.
En caractérisant le risque, la quantité d’informations disponibles variera pour chaque organisme nuisible et la complexité de l’évaluation variera selon les outils disponibles. Par exemple, une ONPV peut disposer de bases de données sur les organismes nuisibles et de systèmes d’informations géographiques élaborés ; une autre peut s’appuyer sur des livres, des cartes publiées du sol et du climat, et des avis d’experts.
Dans certains cas, il n’existe pratiquement pas d’informations, ou il faut faire des recherches pour les obtenir. Les évaluations seront limitées par la quantité et la qualité d’informations disponibles. Les pays où l’organisme nuisible est présent peuvent fournir, sur demande, des informations au pays qui conduit l’analyse du risque phytosanitaire.
Catégorisation de l’organisme nuisible (phase 1)
La catégorisation de l’organisme nuisible est la première phase de l’étape d’évaluation du risque phytosanitaire de l’ARP et son objectif est de déterminer si l’un des organismes identifiés au cours de l’étape de mise en route satisfait aux critères d’organisme de quarantaine. Elle comprend les principaux éléments d’une évaluation complète du risque phytosanitaire, mais elle va moins en détail et consiste essentiellement en une rapide évaluation qui permet de savoir s’il faut poursuivre l’ARP, pour une ARP par organisme nuisible, ou si une ARP doit être effectuée sur un organisme nuisible particulier dans le contexte d’une ARP par filière. La phase de catégorisation donne l’opportunité d’éliminer des organismes dès le premier stade de l’analyse du risque phytosanitaire, avant de passer à un examen plus approfondi. La catégorisation des organismes nuisibles nécessite relativement peu d’informations, sous réserve qu’elles soient suffisantes pour procéder à la catégorisation.
Au cours de cette phase, il est important d’examiner des questions comme : l’organisme nuisible présente-t-il les critères d’un organisme nuisible de quarantaine ? Quelles sont les possibilités pour l’organisme nuisible d’être associé à la marchandise ou la filière ? Quel est l’impact potentiel de l’organisme nuisible ? Quelles sont les probabilités d’introduction et d’établissement de l’organisme nuisible si aucune mesure d’atténuation n’est appliquée à la (les) filière(s) ?
Évaluation de la probabilité d’introduction (phase 2)
L’introduction d’un organisme nuisible implique à la fois son entrée et son établissement, c’est-à-dire que l’organisme nuisible doit tout d’abord arriver dans la nouvelle zone, puis trouver des conditions favorables et y établir une population si l’on veut respecter la définition de l’introduction. L’évaluation de la probabilité d’introduction nécessite l’analyse de chacune des filières auxquelles un organisme nuisible peut être associé, depuis son origine jusqu’à son établissement dans la zone ARP.
Dans une ARP amorcée par une filière déterminée (généralement une marchandise importée ou des produits associés à une marchandise importée, comme les matériaux d’emballage), la probabilité d’entrée de l’organisme nuisible est évaluée à la fois pour cette filière déterminée et pour les autres filières possibles pour chacun des organismes nuisibles examinés dans l’ARP. Pour les ARP entreprises pour un organisme nuisible déterminé, toutes les filières probables sont évaluées pour cette espèce particulière d’organisme nuisible.
Étape 3 – gestion du risque phytosanitaire
La dernière étape du processus d’ARP est la gestion du risque phytosanitaire ; ce processus sert à déterminer les options de gestion appropriées pour réduire à un niveau acceptable les risques identifiés à l’étape 2, évaluation du risque phytosanitaire. Selon la NIMP n° 11 (2004), il résulte de l’étape de l’évaluation du risque phytosanitaire que :
- tous ou certains des organismes nuisibles classés par catégories peuvent être considérés comme éligibles à la gestion du risque phytosanitaire ;
- pour chaque organisme nuisible, toute ou partie de la zone ARP peut être identifiée comme zone menacée ;
- une estimation quantitative ou qualitative de la probabilité d’introduction d’un (des) organisme(s) nuisible(s), et une estimation correspondante des conséquences économiques, aura été obtenue et documentée ; ou
- on aura affecté une note globale.
Pour les organismes nuisibles qui présentent des risques inacceptables, les conclusions de l’évaluation du risque phytosanitaire servent à décider de la sévérité et de la nature des mesures à appliquer pour réduire ces risques à un niveau acceptable. Le principe directeur pour la gestion du risque phytosanitaire doit être d’atteindre le degré de protection requis qui soit justifié et réalisable dans les limites des options et ressources disponibles. La NIMP n° 11 (2004) décrit la gestion du risque phytosanitaire comme le processus d’identification des moyens de réagir à un risque perçu, d’évaluation de l’efficacité de ces actions et d’identification des options les plus appropriées d’atténuation pour atteindre le niveau de protection désiré.
Si l’évaluation du risque phytosanitaire conclut qu’un organisme nuisible spécifique présente un risque inacceptable, des mesures phytosanitaires peuvent être proposées pour gérer ce risque et assurer le niveau de protection approprié au pays importateur. Toute mesure phytosanitaire choisie doit être justifiée par l’ARP et le niveau de protection phytosanitaire requis doit être approprié au risque encouru. Le choix des mesures doit être clairement et expressément motivé.
Les options de gestion peuvent être des mesures existantes ou de nouvelles mesures qui ont été ou devront être élaborées spécifiquement pour faire face au risque suscité par l’organisme nuisible ou la filière en cours d’examen. De nouvelles mesures peuvent aussi être le résultat de la requête d’un pays importateur qui souhaite la prise en considération d’une mesure d’atténuation différente, ou de changements survenus dans la situation phytosanitaire du pays importateur ou exportateur.
Les mesures phytosanitaires pour empêcher l’établissement et la dissémination des organismes nuisibles et des maladies peuvent comprendre une combinaison de mesures dont les traitements avant ou après la récolte, l’inspection à différents points entre la production et la distribution finale, la surveillance, la lutte officielle, la documentation ou la certification. On peut appliquer une mesure ou une combinaison de mesures à un ou plusieurs points du continuum entre le point d’origine et la destination finale. (NIMP 11et NIMP 2)